WALTARIUS GAUTIER D’AQUITAINE TEXTE LATIN DU Xe SIÈCLE Revu, traduit et annoté
WALTARIUS GAUTIER D’AQUITAINE TEXTE LATIN DU Xe SIÈCLE Revu, traduit et annoté par ADRIEN VENDEL Membre correspondant. QUELQUES MOTS SUR LE POEME ET SON AUTEUR. Fauriel, au premier volume de son Histoire de la Poésie provençale, a revendiqué, pour la France du Midi, le poème latin qui chante Walther d'Aquitaine. Mais M. Geyder n'a pas eu de peine à réfuter ses assertions mal établies. Il nous suffira de constater que le principal argument de Fauriel, celui auquel il revient à trois reprises, repose sur une erreur de traduction des mots celtica lingua, sur un contresens si flagrant qu'on pourrait le croire prémédité pour les besoins de la cause. Et, il y a quelques années (19 septembre 1890), un érudit bordelais, associé-correspondant de la Société des Antiquaires de France, a présenté à l'Académie des Inscriptions un mémoire dans lequel il affirme que le manuscrit parisien du Waltarius provient de l'abbaye de Fleury (Saint- Benoît-sur-Loire), dont un moine, Géraud, serait l'auteur du poème. C'est dans un sentiment patriotique et, par haine pour les Francs et les Germains, que ce moine aquitain aurait célébré les exploits d'un prince aquitain. N'ayant pu vérifier les assertions de M. G.-B., à qui j'ai vainement demandé communication des preuves qu'il devait avoir, je lui objecterai seulement que le patriotisme aquitain ne peut être intéressé aux exploits d'un prince... Visigoth. Car, au temps d'Attila, époque où se place l'action du poème, les Visigoths tenaient l'Aquitaine et l'Espagne, et le fils du roi Alpher, — si ce roi était un personnage historique, eût été un Visigoth de sang germain et non gallo-aquitain. L'épopée incontestablement germanique des Nibelungen, où figurent deux des principaux personnages du Waltarius, Hagen et Gunther (sans compter Attila), ne fait même mention que d'un Walther d'Espagne, soit à l'avant-dernière strophe de l'Aventure XXVIII, soit à la strophe 2344 (Aventure XXXIX), où un vieux guerrier, se querellant avec Hagen, lui reproche son attitude passive dans le combat où le héros qui nous occupe extermina ses agresseurs Francs : Des antwurte Hildebrant : « Zwiu verwizet ir mir daz? nu wer was der ufme schilde vor dem Waskensten saz do im con Spanje Walther so viel der friunde sluoc? » Hildebrandt répondit: « Comment me reprochez-vous cela? Qui était donc celui qui resta assis sur son bouclier devant le Wasgenstein, Pendant que Walther d'Espagne lui tuait tant de ses amis? » Le Nibelungenlied nous emporte un peu loin de l'abbaye de Fleury. Et il faut espérer que le patriotisme d'aucun érudit espagnol ne va s'émouvoir et revendiquer pour l'Espagne le poème qui chante Walther. — Parlons sérieusement. Depuis sa découverte ou du moins sa première édition par le professeur Fischer, de Halle (1780), le Waltarius a été généralement considéré comme l'œuvre d'un ou de plusieurs moines allemands, lecteurs familiers de Virgile et des poètes latins de la décadence, de Prudence surtout. Nous verrons tout à l'heure que cette opinion est assise sur un faisceau de preuves solides. Plusieurs commentateurs sont allés plus loin et ne voient, dans le poème latin qui nous reste, que l'imitation, presque la traduction d'un original allemand perdu, peut-être un de ces vieux chants héroïques que Charlemagne avait fait recueillir avec un soin pieux, et que son dévot fils laissa ou fit détruire. C'était la conviction du noble et regretté poète Scheffel, qui essaya même de nous rendre cet original en élaguant de sa restitution tous les traits de rhétorique latine dont les versificateurs en froc avaient cru embellir la vénérable légende primitive. Qu'il ait existé, au Xe siècle encore, un manuscrit allemand de l'histoire de Walther, rien ne défend de le croire, mais rien ne le prouve. Au moins n'y a-t-il guère lieu de douter que cette histoire se soit conservée oralement jusqu'à cette époque, soit dans les récite des veillées, soit dans des chants populaires. Et l'on pourrait y voir le canevas du Waltarius, dont le latin a gardé plus d'un germanisme, et dont l'auteur avait tellement présente à la mémoire, sinon sous les yeux, une narration en langue vulgaire, qu'il a maladroitement essayé d'en conserver un jeu de mots, lequel n'a plus de sel ni même de sens en latin (au vers 1351). Si nous admettons cette origine, nous verrons dans le Waltarius une de ces légendes sans fondements historiques bien précis, où se complut la rêverie germanique, quand prirent fin les assauts livrés par le monde barbare au monde romain. Dans l'âge de pacification relative qui suivit la grande lutte, on se souvint des exploits des aïeux, on se plut à les célébrer, à les exalter, en mêlant les temps et les lieux, sans grand souci de la vérité chronologique et historique. Ce que la guerre de Troie avait été pour les Grecs, la conquête et le dépècement de l'Empire Romain le furent pour les Germains de toutes nations, une source presque inépuisable de récits guerriers, de retentissantes épopées. Mais on n'a presque rien conservé des poèmes qui furent chantés alors qu'une langue nationale ne s'était pas dégagée de la diversité des dialectes. La légende de Walther aurait donc eu cette singulière fortune de périr sous sa forme populaire en langue allemande, pour revivre en langue latine sous une forme littéraire, et, selon l'ingénieuse expression de Wilhelm Bertz, elle ressemble, sous cette parure d'emprunt, à un Germain du temps de la grande migration des peuples affublé des dépouilles d'un Romain. — Quel est l'auteur de cette transformation? Le poème lui-même ne fournit pas d'indications certaines sur ce point intéressant; à la fin seulement, une comparaison avec la cigale qui n'a pas encore pris son essor nous apprend que le Waltarius fut composé par un jeune homme. Suivant les historiens de la littérature allemande, c'était un jeune moine de Saint-Gall, Ekkehard, premier du nom, lequel devint doyen de son couvent, conseiller d'Othon-le-Grand, et mourut en 973. Voici, en effet, ce qu'écrivait sur lui le principal auteur de l'inappréciable Chronique intitulée: Carus sancti Galli, Ekkehard IV, moine de Saint- Gall, mort vers 1000 : Scripsit et in scholis metrice magistro, vacillanter quidem, quia in affectione, non in habitu, erat puer, vitam Waltarii manu fortis, quam Maguntiae positi, Aribono archiepiscopo jubente, pro posse et nosse nostro correximus : barbaries enim et idiomata ejus Teutonem adhuc affectantem repente Latinum fieri non patiuntur. (Casus sancti Galli, cap. 9). Ce qui peut se traduire ainsi : Et, à l'école, il écrivit en vers pour son professeur, — un peu gauchement, il est vrai, étant encore, non d'extérieur mais d'âme, un enfant, — la vie de Walther à la main vaillante. Moi, dans mon séjour à Mayence, sur l'ordre de l'archevêque Aribon, j'ai corrigé son travail selon mes moyens et mon savoir ; car, à raison de son origine barbare (non latine) et de sa langue particulière, l'homme qui a encore l'âme d'un Allemand ne se laisse pas tout à coup transformer en Latin. Ainsi, c'est dans sa jeunesse d'écolier (vers 930), que le premier des Ekkehard aurait composé le Waltarius, revu et corrigé par le quatrième Ekkehard entre 1021 et 1031, dans les années où se place l'épiscopat d'Aribon à Mayence. Ce fut bien l'opinion généralement admise tant qu'on ne connut pas le prologue dédicatoire que donnent trois manuscrits seulement, ceux de Paris, de Bruxelles et de Trêves. Dans cette Poesis de Gualtario, un certain Geraldus, s'adressant à un évêque du nom d'Erchambold, lui dit en lui offrant le Waltarius : Prœsul sancte Dei, nunc accipe munera servi Quia tibi decrevit de larga promere cura Peccator fragilis Geraldus nomine vilis. Saint évêque de Dieu, acceptez ce présent d'un serviteur, Présent qu'a décidé de vous offrir sans ménager sa peine Le fragile pécheur Gérald, de nom très humble. En lisant cela, qui ne serait porté à voir dans ce donateur l'auteur même de l'œuvre qu'il présente? Pourtant, un peu de réflexion met, croyons-nous, cette conclusion à néant. Tout d'abord remarquons que l'intitulé du prologue est : Poesis Geraldi de Gualtario, ce qui est l'affirmation de la paternité de Gérald pour cette pièce de vers, mais pour elle seulement : car le poème proprement dit, qui porte différents titres, soit, dans le manuscrit de Paris: Versus de Waltario, soit, dans celui de Trêves : Liber Waltarii, soit enfin, dans celui de Karlsruhe (ou de Hirschau): Hystoria Waltarii regis, — reste anonyme et n'est revendiqué par personne. Puis, il est évident que ces vingt-deux vers léonins, alambiqués, pénibles, obscurs, ne sont pas de la même main que les vers du poème, faciles, coulant d'abondance, très souvent élégants, souvent aussi d'une latinité médiocre, mais non compassée, encore vivante aujourd'hui. Celui qui martela le prologue n'a certes pas chanté le Waltarius. Et enfin, pourquoi y voir, dans ce prologue, autre chose que ce qu'il contient réellement, à savoir la présentation d'un manuscrit que Gérald a fait exécuter avec grand soin, de larga promere cura, d'un libellus qui charmera les loisirs d'un prélat ami des lettres. L'évoque Erchambold occupa le siège de Strasbourg de 905 à 991. Gérald, moine et écolâtre à Saint-Gall durant toute sa vie (a subdiaconatus sui principio... ab uploads/Litterature/ waltarius.pdf
Documents similaires





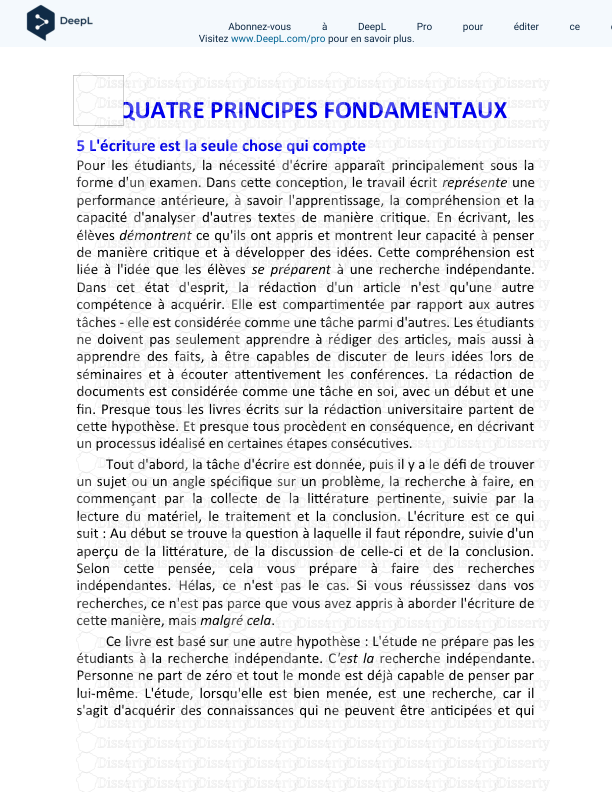




-
78
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 26, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.7365MB


