Bernard Gardin G. Lefèvre Michel Tardy Marie-Françoise Mortureux A propos du «
Bernard Gardin G. Lefèvre Michel Tardy Marie-Françoise Mortureux A propos du « sentiment néologique » In: Langages, 8e année, n°36, 1974. pp. 45-52. Citer ce document / Cite this document : Gardin Bernard, Lefèvre G., Tardy Michel, Mortureux Marie-Françoise. A propos du « sentiment néologique ». In: Langages, 8e année, n°36, 1974. pp. 45-52. doi : 10.3406/lgge.1974.2273 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458-726X_1974_num_8_36_2273 В. GARDIN, G. LEFÈVRE, G. MARCELLESI, M. Fr. MORTUREUX. Paris X Nanterre et Université de Rouen A PROPOS DU « SENTIMENT NÉOLOGIQUE » 1. De la néologie au néologisme. 1.1. — Pourquoi cette enquête ? Prendre comme sujet d'étude la néologie c'est, dans une première étape (peut-elle être sautée ?), se donner un objet nommé — non défini — dans la problématique structurale de l'homogénéité de la langue : au sens où l'intervention de cette théorie dans les faits de langage détermine un domaine soumis à la théorie et un domaine nommé mais non défini, c'est-à- dire un pseudo-concept. On se trouve donc condamné à un travail sur les restes. Ce travail originellement ne peut donc être qu'a-théorique. Aussi l'activité de l'équipe a-t-elle été tout d'abord de type lexicographique et simultanément d'essai de constitution d'une théorie. Très rapidement est apparue l'impasse théorique : le constat d'un accord impossible sur une définition des néologismes. Ceci n'a pas fort heureusement arrêté la constitution du corpus ; on en est donc arrivé à ne fournir au dépouilleur que cette seule directive : relevez les unités qui vous paraissent néologiques, c'est-à-dire à fonder la constitution du corpus sur un postulat : l'existence chez les dépouilleurs d'une intuition qui renverrait à une certaine compét ence, à adopter une problématique générativiste. L'hypothèse était donc que, mis à part les ratés de la performance (ignorances individuelles...) le corpus serait représentatif d'un sentiment néologique universel saisi ici à travers les jugements portés par les dépouilleurs de l'équipe. Recueillir des objets non définis, la pratique parut scandaleuse à de nouveaux arrivants qui proposèrent une enquête sur ce sentiment néolo gique de l'équipe. Huit pages de l'hebdomadaire Le Point furent soumises à tous les membres avec les consignes suivantes : (1) soulignez les néolo gismes ; (2) indiquez les contextes qui vous paraissent nécessaires à leur explicitation ; (3) faites une liste des unités sur lesquelles vous hésitez. Dix-sept réponses furent collectées ; les deux dernières consignes n'ayant pas été entièrement suivies, nous n'étudierons pas les résultats qu'elles ont fourni (ces refus ne sont certes pas dus au hasard, et mériteraient une étude spéciale). 45 1.2. — Principes ayant guidé V interprétation de V enquête. Pour que fût vérifiée à ce niveau l'hypothèse de l'homogénéité du corpus recueilli selon la pratique du dépouillement collectif, il aurait fallu que les résultats du test fissent apparaître une grande proportion d'unités recueillant un large consensus face à deux ensembles réduits d'unités recueillant pour l'un un consensus général, constitué pour l'autre d'unités relevées par un petit nombre d'informateurs. Ce n'est pas le cas. 1.3. — Dispersion générale des résultats. Au total, 500 segments ont été soulignés par les membres de l'équipe, correspondant à 240 segments différents du texte proposé : pour l'équipe, en tant que dépouilleur collectif, et à ne considérer que les jugements positifs, il y aurait donc dans ce texte 240 segments néologiques. Si nous considérons le degré d'accord manifesté par les membres de l'équipe sur le caractère néologique d'une unité, il est donc de deux membres en moyenne sur 17. Ce coefficient est faible. Ces chiffres sont cependant moins significatifs que le tableau suivant, qui classe les segments différents en fonction du nombre d'informateurs qui les ont relevés. Nombre d'info rmateurs Nombre de se gments diffé rents relevés . . 152 34 19 12 10 11 12 13 14 15 16 0 17 0 = 241 segments Ainsi, 152 segments différents (soit plus de la moitié des segments relevés) n'ont été relevés que par un seul observateur. Un seuil très net existe entre ces derniers et ceux qui ont été relevés par deux informateurs. Cinq segments différents seulement, sur 250, sont relevés par la moitié ou plus des informateurs. 1.4. — • Les intermittences du sentiment néologique. A cette dispersion générale des résultats s'ajoutent les incohérences internes à chaque relevé. S'il paraît difficile à ce niveau d'analyse de parler d'une compétence homogène au niveau de l'équipe, on ne peut pas non plus parler d'un sentiment néologique constant de l'informateur au cours de son relevé, mais d'un sentiment à éclipses. Ainsi, pour l'unité leader, qui a 7 occurrences dans le texte, huit informateurs l'ont ressentie comme néologique, mais jamais tous ensemble pour la même occurrence (la ci nquième occurrence n'a d'ailleurs été relevée par personne). 46 Informateurs 1 2 3 Occurrences 4 5 6 7 a + + + b + + + + + с + d + e + + + /г + + Ces résultats seraient plus que décevants — que vaudrait alors le corpus ainsi constitué ? — s'ils s'avéraient véritablement pertinents. Suffirait-il de dire que leur dispersion est imputable aux ratés de la performance et ne met pas en cause la compétence ? Précisons de ce point de vue que cette pratique de constitution du corpus (addition de juge ments positifs sur la valeur néologique des unités) est en contradiction avec les patiques habituelles relevant de la grammaire generative, exercices solitaires de la compétence linguistique. On sait qu'additionner lesrrésultats de ces pratiques à propos des jugements de grammaticalité aboutit à augmenter le nombre des points d'interrogation, des justifications indi viduelles (du type — « ceci est grammatical dans mon dialecte ») propor tionnellement au nombre d'accords. (Les premiers académiciens s'étaient trouvés devant ce problème et avaient adopté la solution suivante : il suffisait qu'un mot soit inconnu de l'un d'entre eux pour être considéré comme n'étant pas courant et donc exclu du dictionnaire. La même règle utilisée dans notre cas aurait donné fort peu d'unités, et dans l'enquête aucune.) De ce point de vue on pourrait dire que leader ayant été à un moment ou un autre repéré par 8 informateurs aurait pu théoriquement être relevé : 7 occurrences x 8 = 56 fois, et que c'est ce chiffre de 56 qu'il faudrait alors considérer (alors qu'il n'a été relevé en fait que 15 fois). Cependant ni ces dernières remarques ni le traitement statistique précédent ne sont véritablement pertinents par rapport à l'objet particulier que nous traitons, non linguistiques au sens où ils neutralisent le processus de constitution de ce corpus précis. Dans ce processus en effet (1) des informateurs se sont trouvés confrontés à un discours qu'il faut entendre à la fois comme énoncé et énonciation ; (2) les résultats individuels ont été recensés et constituent un résultat collectif qu'il faut traiter en tant que tel. Il s'agit donc maintenant d'examiner si, au-delà des deux types d'inco hérences précédemment décrits ; une structuration des résultats apparaît lorsqu'on fait intervenir la relation des divers relevés au discours. Prat iquement, ceci revient à observer l'aspect de l'objet obtenu en reportant tous les relevés sur un même exemplaire du texte. 47 2. Approche qualitative. L'exemplaire ainsi constitué présente à l'analyse visuelle des par ticularités très nettes. On y trouve : 2.1. — Des unités isolées qui présentent souvent les caractéristiques suivantes : (a) Un certain nombre sont des néologismes formels constitués par dérivation ou composition et auxquels la plupart des informateurs ont été sensibles : le Pohérisme, un pré-scrutin, le présidentialisme, les constitu- tionalistes, la bipolarisation, machiavéliser, etc. Mais ce n'est pas tant quantitativement que qualitativement, pourrait-on dire, que s'établit une première constante : ces néologismes, s'ils sont fréquemment repérés et facilement repérables, sont surtout ceux qui le sont avec le moins d'hési tation et sont le moins contestés. (b) Un certain nombre de ces unités sont accompagnées de marques méta-discursives : marques d'énonciation, marques typographiques. La typographie influence certainement l'informateur dans son relevé : guillemets et italiques sont les procédés les plus courants du discours journalistique écrit pour cerner un néologisme ou ne pas en assumer la responsabilité. Ainsi : « Le pohérisme devient alors une sorte de géné ration spontanée... » « A peine masqué sous la bataille des législatives se déroule un préscrutin présidentiel. » Les formules pré- ou post-posées au néologisme sont, elles, des plus variées. Citons : c'est-à-dire (les occasionnels c'est-à-dire) ; ce que X appelle (ce que les anglo-saxons appelleraient son leadership) ; comme dirait X (ce paladin du centrisme, j'allais, comme dirait Monsieur Messmer, me le « farcir »). (c) Certains faits de syntaxe fonctionnent aussi comme marques : on peut ainsi supposer que dans le syntagme « le playboy Colgate des pré sidentielles de 65 », c'est la lemmatisation par le qui est responsable du fait que le syntagme a souvent été relevé. Le cas de leader fait nettement apparaître le rôle de toutes ces marques : c'est dans la phrase : « Ce poste nouveau dans la vie politique française : celui de leader populaire de l'oppo sition », que l'unité a été le plus souvent relevée ; c'est-à-dire dans une phrase uploads/Management/ a-propos-du-sentiment-neologique.pdf
Documents similaires
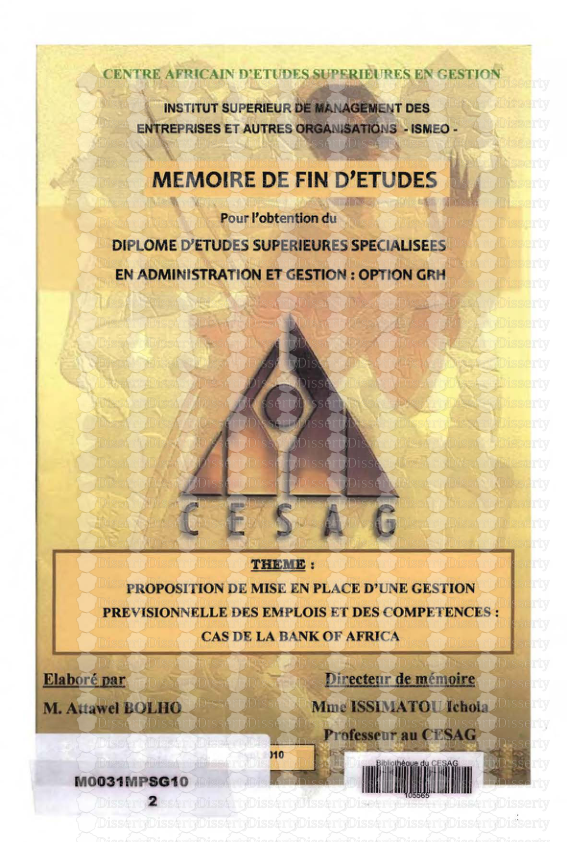









-
27
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 15, 2022
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 0.8479MB


