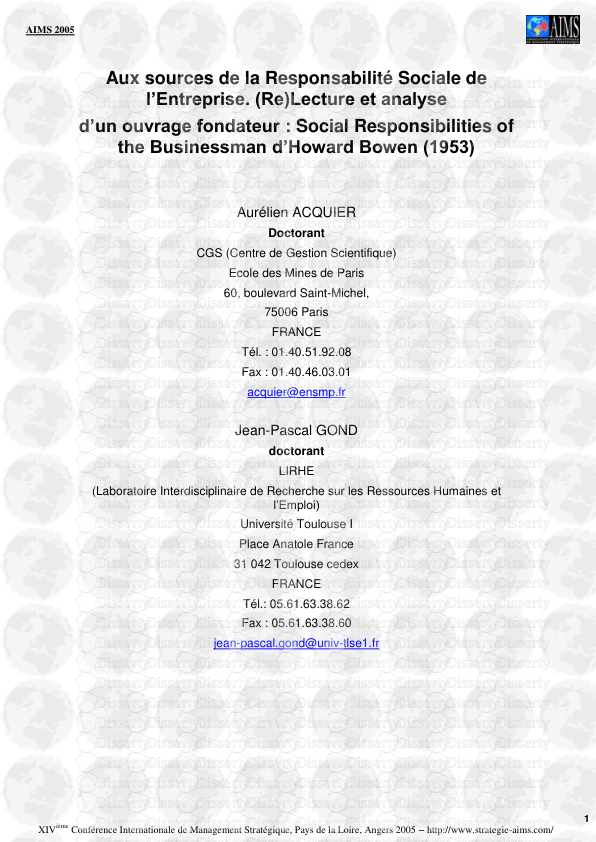AIMS 2005 XIVième Conférence Internationale de Management Stratégique, Pays de
AIMS 2005 XIVième Conférence Internationale de Management Stratégique, Pays de la Loire, Angers 2005 – http://www.strategie-aims.com/ 1 Aux sources de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise. (Re)Lecture et analyse d’un ouvrage fondateur : Social Responsibilities of the Businessman d’Howard Bowen (1953) Aurélien ACQUIER Doctorant CGS (Centre de Gestion Scientifique) Ecole des Mines de Paris 60, boulevard Saint-Michel, 75006 Paris FRANCE Tél. : 01.40.51.92.08 Fax : 01.40.46.03.01 acquier@ensmp.fr Jean-Pascal GOND doctorant LIRHE (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur les Ressources Humaines et l’Emploi) Université Toulouse I Place Anatole France 31 042 Toulouse cedex FRANCE Tél.: 05.61.63.38.62 Fax : 05.61.63.38.60 jean-pascal.gond@univ-tlse1.fr AIMS 2005 XIVième Conférence Internationale de Management Stratégique, Pays de la Loire, Angers 2005 – http://www.strategie-aims.com/ 2 Résumé : Le livre d’Howard Bowen, Social Responsibilities of the Businessman (1953) a un statut paradoxal. Reconnu comme l’un des ouvrages fondateur sur la notion de Responsabilité Sociale de l’Entreprise, il est très fréquemment cité alors même qu’il semble avoir été très peu lu et analysé et qu’il est devenu aujourd’hui quasiment introuvable. Cet article, en proposant d’analyser cet ouvrage et d’en présenter les grandes idées, s’inscrit dans une démarche visant à appréhender la dynamique de la notion de Responsabilité Sociale de l’Entreprise et à en reconstituer la généalogie. Une lecture critique de l’ouvrage met en évidence la nature et la vigueur des débats relatifs à la Responsabilité Sociale aux Etats-Unis durant les années 50 et témoigne de l’importance des religions protestante et catholique dans les discours de l’époque. Elle permet aussi d’identifier les voies d’actions alors proposées pour opérationnaliser la Responsabilité Sociale. Au delà du témoignage historique, Social Responsibilities of the Businessman a une résonance théorique importante et préfigure un grand nombre de recherches ultérieures. Enfin, l’ouvrage s’appuie sur un cadre d’analyse particulièrement fécond, particulièrement adapté à l’étude de l’émergence « d’espaces d’action collectifs », qu’il est intéressant de confronter aux travaux ultérieurs. Mots-clefs Responsabilité sociale de l’entreprise – Histoire des idées – Howard R. Bowen – Construction théorique AIMS 2005 XIVième Conférence Internationale de Management Stratégique, Pays de la Loire, Angers 2005 – http://www.strategie-aims.com/ 3 Aux sources de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise. (Re)Lecture et mise en perspective d’un ouvrage fondateur : Social Responsibilities of the Businessman d’Howard Bowen (1953) Introduction On peut analyser le champ de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) comme un nouvel espace d’action pour les entreprises, ou apparaissent de nouveaux acteurs et s’élaborent simultanément une rhétorique et de nouvelles pratiques managériales (Capron et Quairel-Lanoizelée 2004; Aggeri, Pezet et al. 2005). Si les discours et les pratiques d’entreprises explicitement labellisés « RSE » paraissent relativement émergents en Europe (Matten et Moon 2004), ces constructions empruntent largement aux développements nord-américains sur la RSE, qui remontent au début du 20ème siècle dans le milieu des affaires et accompagneront la dynamique d’institutionnalisation des disciplines de gestion à partir des années 50 (Carroll 1999). Dans la construction d’un champ dédié à la RSE, Howard Bowen semble avoir joué un rôle majeur. Son ouvrage Social Responsibilities of the Businessman (Bowen 1953) est présenté comme un ouvrage séminal, anticipant et structurant l’ensemble des approches théoriques en matière de RSE, et contribuant à la construction d’un nouvel espace académique Business and Society aux Etats-Unis (Carroll 1979; Wood 1991a, b; Carroll 1999). Mais si l’ouvrage est devenu l’une des quelques références bibliographiques obligées de tout travail gestionnaire en matière de RSE, il est aujourd’hui difficilement accessible en Amérique du Nord et quasiment introuvable en Europe. Partant de cette situation paradoxale – un travail fondateur, unanimement cité, mais très peu lu et analysé – nous proposons d’effectuer une mise en perspective et une analyse détaillée de l’ouvrage. Un tel travail nous semble constituer une contribution importante à plusieurs titres : il participe à une analyse historique de la dynamique de l’objet Responsabilité Sociale de l’Entreprise. Ce détour historique nous semble avoir une valeur particulière dans un contexte où la notion de RSE reste floue et où la signification de cet objet reste en partie à construire (Acquier, Aggeri et al. 2004; Gond et Mullenbach 2004; Aggeri, Pezet et al. 2005). Ainsi, ce travail s’inscrit dans une volonté plus générale de mieux cerner la nature et la dynamique du concept de Responsabilité Sociale de l’Entreprise ainsi que les pratiques d’entreprise associées à cette notion. L’ouvrage de Bowen accordant une large place aux pratiques et déclarations des managers américains des années 50, il permet ensuite de mettre en évidence les conditions d’émergence d’un débat autour de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise dans la société américaine dans les années 40-50 et de comprendre dans quelle mesure la nature de ce débat s’est AIMS 2005 XIVième Conférence Internationale de Management Stratégique, Pays de la Loire, Angers 2005 – http://www.strategie-aims.com/ 4 transformée au cours du temps, en fonction des contextes institutionnels nationaux et internationaux ; il participe à un travail de fidélité et de vérification empirique : au delà des quelques phrases qui ont traversé les années et que l’on retrouve dans les articles et ouvrages sur la RSE1, cette analyse de Social Responsibilities of the Businessman ambitionne de fournir une relecture plus globale et fidèle de la manière dont Bowen problématise la notion de RSE : quelle place accorde-t-il à l’éthique ? Quelle est la place des considérations normatives et religieuses dans son analyse ? enfin, en raccrochant l’ouvrage de Bowen à l’ensemble des développements académiques qui vont suivre, notre travail devrait permettre de comprendre dans quelle mesure les analyses de Bowen structurent effectivement l’ensemble des problématisations et développements ultérieurs en matière de RSE. Après avoir resitué l’ouvrage dans son contexte historique et dans le parcours biographique d’Howard Bowen (1), nous en présenterons les principaux thèmes de réflexion (2), avant de les mettre en perspective avec les développements ultérieurs de la recherche consacrée à la notion de responsabilité sociale (3)2. 1. D’où vient Social Responsibilities of the Businessman ? La compréhension du contenu et de l’impact de SRB implique de resituer cet ouvrage dans l’histoire du concept de la Responsabilité Sociale et des pratiques d’entreprises qui lui sont associées (1.1), dans le parcours biographique de son auteur (1.2), et dans son contexte de publication (1.3). PETITE GÉNÉALOGIE DE LA NOTION DE RS Il serait trompeur de croire qu’en matière de responsabilité sociale, la temporalité académique coïncide avec celle de la société. Ainsi, les premiers ouvrages académiques traitant des relations entre entreprise et société datent des années 50. Ils posent les fondements du champ académique « Business and Society », qui s’affirmera progressivement aux Etats-Unis pour devenir une composante de l’enseignement à la gestion à partir des années 70. Par contraste, les travaux s’inscrivant dans une perspective historique montrent que le concept de Responsabilité Sociale se diffuse dans la société et les milieux d’affaires de manière bien plus précoce (Heald 1961, 1970; Miller et O'Leary 1989; Epstein 2002). 1 Par exemple la définition de la responsabilité sociale des managers comme consistant à « poursuivre les politiques de prendre les décisions ou de suivre les orientations qui sont désirables en terme d’objectifs et de valeurs de notre société » (notre traduction, Bowen, 1953 : 6) 2 Afin d’alléger la rédaction du texte, nous utiliserons dans les développements de l’article le système d’abréviation suivant : RS pour Responsabilité Sociale ; RSE pour Responsabilité Sociale de l’Entreprise ; SRB pour désigner l’ouvrage qui est au centre de l’analyse, à savoir Social Responsibilities of the Businessman. AIMS 2005 XIVième Conférence Internationale de Management Stratégique, Pays de la Loire, Angers 2005 – http://www.strategie-aims.com/ 5 Avec l’accroissement radical de la taille des entreprises industrielles américaines (Chandler 1977) et l’avènement progressif d’« une ère des organisateurs » (Burnham 1947), le début du 20ème siècle marque une transformation très profonde du visage et du statut de l’entreprise. La grande entreprise est un objet nouveau, les modalités de son contrôle restent largement à conceptualiser, son acceptabilité et sa légitimité au sein de la société américaine ne sont pas établies. Par exemple, alors que le concept de hiérarchie est un élément central de la grande entreprise, sa légitimation dans la société américaine est un exercice difficile (Miller et O'Leary 1989), dans la mesure où la notion de hiérarchie entre en contradiction complète avec les idéaux américains de l’époque (notamment la liberté d’initiative et la liberté individuelle). Dans cette perspective, Miller et O’Leary (1989) montrent comment les premières conceptualisations de la grande entreprise (via Taylor, puis Follett, et enfin Mayo et Barnard) sont structurées par la question de l’acceptabilité sociale de la grande entreprise et contribuent à légitimer le concept de hiérarchie. Ainsi, chacun de ces développements théoriques fait écho aux critiques du moment à l’égard de la grande entreprise. Si au début du siècle, l’acceptabilité et la légitimation constituent des enjeux importants pour l’entreprise, la structure de cette nouvelle institution – en particulier la séparation entre propriété et management, la dispersion de l’actionnariat et la professionnalisation du management – va fournir un terreau favorable à la notion de Responsabilité Sociale (Heald 1970; Epstein 2002) : Premièrement, elle diminue le contrôle que les actionnaires exercent sur les dirigeants. Ainsi, au cours uploads/Management/ aims2005-716-pdf.pdf
Documents similaires










-
47
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 18, 2021
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 0.5405MB