êüt, JlMí Commission des Communautés européennes environnement et qualité de la
êüt, JlMí Commission des Communautés européennes environnement et qualité de la vie ANALYSE DESCRIPTIVE ET PROJET PILOTE PREPARATOIRE A UNE STRATEGIE POUR LA CONSERVATION DU PHOQUE MOINE EN MEDITERRANEE (MONACH US MO NACH US) Rapport EUR 13448 FR Agrandissement à partir d'un original microfiche Commission des Communautés européennes environnement et qualité de la vie ANALYSE DESCRIPTIVE ET PROJET PILOTE PREPARATOIRE A UNE STRATEGIE POUR LA CONSERVATION DU PHOQUE MOINE EN MEDITERRANEE (M ON ACHUS MONACH US) A. ANSELIN, M.d.N. VAN DER ELST R.C. BEUDELS, P. DEVILLERS Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique Belgique Contrat n° 6611/28 RAPPORT FINAL - AOUT 1988 REVISE-AVRIL 1990 Direction générale Environnement, sécurité nucléaire et protection civile 1991 PARI E U R O P B.blitth. N.CEUR 13448 FR Publié par COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Direction générale Télécommunications, Industries de l'Information et Innovation L-2920 LUXEMBOURG AVERTISSEMENT Ni la Commission des Communautés européennes, ni aucune personne agissant au nom de la Commission, n'est responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations ci-après Numéro de catalogue: CD-NA-13448-FR-C © CECA — CEE — CEEA, Bruxelles - Luxembourg, 1991 III TABLE DES MATIERES I. INTRODUCTION Page 1 EVOLUTION DES POPULATIONS ET STATUT ACTUEL 5 1. Introduction 7 2. Atlantique Z 3. Méditerranée occidentale ,Q 4. Méditerranée orientale . 5. Conclusion III. ACTIONS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA CONSERVATION DU PHOQUE MOINE (MONACHUS MONACHUS) : PREMIERE PHASE 1985-1988. 13 1. Causes de déclin 15 2. Justification de la straégie de conservation 15 3. Présentation de la stratégie de conservation 16 A. L'établissement d'un réseau de zones de protection 16 B. Système d'information, récupération,sensibilisation 16 C. Etudes et recherches I 7 D. Recherche de techniques appropriées de détention 1 7 E. Coordination 17 4. Résultats des activités 1 8 A. Etablissement d'un réseau de zones de protection 18 a. Le Parc Marin des Sporades du Nord 18 a.1. Situation et description générale 18 a.2. Evolution de l'idée d'un Parc Marin 1 8 a.3. Les actions communautaires * ' b. Les Iles Ioniennes 2 2 b.1. Situation et description générale 2 2 b.2. Evolution de l'idée de zone de protection 2 2 b.3. Les actions communautaires 2 2 c. Golfe d'Orosei 25 c.1. Situation et description générale 2 5 c.2. Evolution de l'idée de zone de protection 2 5 C.3. Les actions communautaires 2 5 d. L'archipel de Madère 2 7 d.1. Situation et description générale 2 7 d.2. Evolution de l'idée de zone de protection 2 7 d.3. Les actions communautaires 29 e. Autres 30 I V B. Système d'information et de récupération, sensibilisation 31 a. Introduction 31 b. Système d'information 32 b.1. La Grèce 32 b.2. La Sardaigne 35 b.3. Madère 35 c. Le système de récupération/sauvetage 3 7 c.1. Résultats généraux 3 7 C.2. Le sauvetage de deux jeunes phoques 37 3 8 d. Sensibilisation 38 d.1. Introduction 38 d.2. Sensibilisation en Grèce ^ d.3. Sensibilisation en Sardaigne 3 9 d.4. Sensibilisation à Madère 3 9 C. Etudes sur la biologie du Phoque moine et sur les interactions 40 entre pêcheurs et phoques a. Etudes sur la biologie du Phoque moine 40 a.1. Introduction 40 a.2. Méthodes 40 a.3. Résultats 40 b. Etudes sur les interactions phoque/pêcheurs 4 1 b.1. Introduction 41 b.2. Aanalyse des dégâts 41 b.3. Mise à mort délibérée de phoques 43 b.4. Morts accidentelles dans les filets 43 b.5. La surpêche et la diminution des ressources alimentaires du phoque 43 b.6. Conclusions 44 c. Etudes sur la législation de pêche 4 5 c.1. Introduction 45 C.2. Rassemblement des données 45 C.3. La pêche en Grèce 45 C.4. La pêche à Kephallonia-lthaque 46 c.5. Application de la législation 48 D. Recherche de techniques appropriées de reproduction en captivité 5 0 a. Introduction 5 0 50 51 b. Programme d'actions 50 c. Résultats 50 c.1. Mission en Tunisie C.2. L'Algérie 51 C.3. Le Maroc 5 53 E. Contacts et coordination genérale IV. STRATEGIE FUTURE 5 7 Bibliographie 5 9 I. INTRODUCTION I. INTRODUCTION Il y a quelque 2800 ans, l'Odyssée mentionnait déjà l'existence de phoques en Méditerranée. Mais il fallut attendre longtemps pour que le Phoque moine vienne à la connaissance du monde scientifique. Sa première description sous le nom de Phoca monacha, est due à J. Hermann en 1779, à partir d'un exemplaire provenant de l'Adriatique. Plus tard, en 1822, ce nom fut changé en Monachus monachus (résumé dans AVELLA, 1986). Le genre Monachus est le seul genre tropical et subtropical des Phocidae. Il ne comprend que trois espèces, dont le statut est précaire: Monachus tropicalis, ou Phoque des Caraïbes, récemment disparu, Monachus schauinslandi des îles Hawai et Monachus monachus, le Phoque moine de la Méditerranée, tous deux actuellement en danger de disparition. Le Phoque moine de la Méditerranée était autrefois largement répandu autour de la mer Noire, dans tout le bassin méditerranéen, sur la côte atlantique de l'Afrique du nord (jusqu'au 20ième parallèle), et dans les archipels des Canaries, des Açores et de Madère. Mais il a progressivement disparu de la plupart des côtes qu'il fréquentait en Méditerranée et en Macaronésie. Actuellement sa population est estimée entre 500 et 1000 individus. Les premiers efforts en faveur de la conservation du Phoque moine furent entrepris principalement par le Professeur K. Ronald (Université de Guelph, Canada) qui, dès 1973 fonda la "League for the conservation of the Monk Seal". La publication régulière de "Newsletters" permit de mettre en contact les scientifiques travaillant sur cette espèce, et de collecter de nombreuses données provenant de tous ceux qui s'intéressaient à sa sauvegarde. En 1978, les Ministères grecs de Coordination, de l'Agriculture et de la Culture et des Sciences, l'United Nations Environmental Programme (UNEP), l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Resources (UICN) et l'Université de Guelph organisèrent la première conférence internationale sur le Phoque moine à Rhodes (Grèce). Le but était de faire le bilan des connaissances sur l'écologie, la distribution et la protection de l'espèce ainsi que de mettre au point et d'adresser aux gouvenements concernés un "Plan d'Action" pour la conservation du Phoque moine. Les recommendations prioritaires étaient l'établissement d'un réseau de zones de protection, la mise en route de campagnes de sensibilisation destinées en particulier aux communautés de pêcheurs, la réduction de la pollution et l'étude approfondie de la biologie de l'espèce (voir RONALD, 1978). Dès le début des années '80 la Commission des Communautés Européennes s'est engagée dans la conservation du Phoque moine en initiant plusieurs projets en Méditerranée, principalement en Grèce, où subsistent les plus importantes populations de Phoque moine de la Communauté. Des études furent entreprises sur la distribution et l'habitat de l'espèce en particulier dans les Sporades du Nord, en Grèce, et des investigations furent menées sur les possibilités d'établir des zones de protection (e.a. SCHULTZE-WESTRUM, 1984; VERRIOPOULOS, 1984; ANTIPAS et BROUSSALIS, 1984; MATSAKIS era/., 1985). Un rapport de la Commission des Communautés Européennes publié en 1984 (HARWOOD er al., 1984) formulant les recommandations prioritaires pour la conservation du Phoque moine dans la Communauté européenne, fut à la base des actions futures. En février 1984 une Résolution sur la protection des Phoques moines (Monachus monachus) est adoptée par le Parlement, grâce aux interventions du parlementaire H. Muntingh. Dans cette résolution, le Parlement européen demande instamment à la Commission d'examiner quelles mesures doivent être prises pour garantir la survie du Phoque moine, d'arrêter les mesures visées dans le cadre du programme d'actions à long terme et d'assurer à longue échéance le financement de ce programme. En plus, elle lance un appel pressant aux gouvernements de tous les Etats sur le territoire desquels le Phoque moine est encore présent pour que, en étroite collaboration avec la Commission, ils accordent une haute priorité à sa sauvegarde et qu'ils engagent des crédits suffisants à cette fin (J.O. C77/112). L'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB) fut alors chargé de préparer pour la Commission un programme d'actions pour la protection de l'espèce. Ces actions furent présentées par l'IRSNB lors de la Deuxième Conférence Internationale sur le Phoque moine à La Rochelle (France), en octobre 1984. L'IRSNB a par la suite élaboré, avec l'aide d'experts consultants, un projet de "Programme d'Actions à long terme" qui fut soumis aux services de la Commission. En 1985, la Commission lance un programme d'urgence pour la conservation du Phoque moine et charge l'IRSNB de sa coordination. Ce projet, qui a duré trois ans, a impliqué les Ministères grec, italien et français de l'Environnement, le Parque Natural de Madère, les Universités d'Athènes, de Thessalonique et de Munich, le Sea Mammal Research Unit de Cambridge, Le Parc National de Port-Cros, le Rijksinstituut voor Natuurbeheer à Texel, la Société Hellénique pour la Protection de la Nature et le Zeehondencrèche de Pieterburen. Ce rapport final présente un résumé de l'état des connaissances sur l'évolution et le statut du Phoque moine, les actions menées pendant ces trois années de travail et leurs résultats. Une stratégie élaborée au cours de ces trois années, qui pose les jalons des actions à entreprendre ou à poursuivre pour la conservation du phoque moine, est également uploads/Management/ cdna13448frc-001.pdf
Documents similaires





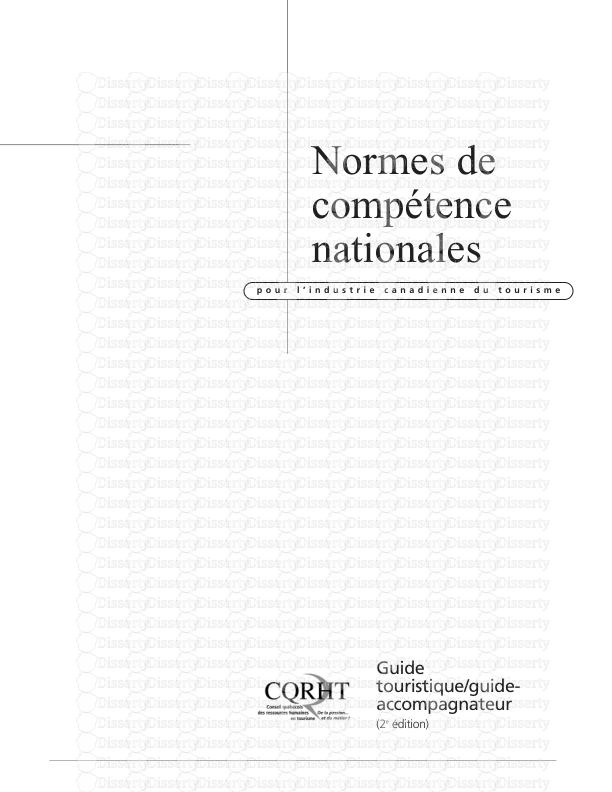




-
48
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 20, 2021
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 1.4612MB


