L’enseignement-apprentissage de la grammaire : de l’approche communicative à la
L’enseignement-apprentissage de la grammaire : de l’approche communicative à la perspective actionnelle, le cas de la classe de Terminale en Tunisie Synergies France n° 12 - 2018 p. 49-66 49 Reçu le 15-04-2018 / Évalué le 09-07-2018 / Accepté le 26-11-2018 Résumé S’il est une approche qui a marqué l’enseignement-apprentissage des langues c’est bel et bien l’approche communicative, en vogue dès les années soixante-dix, et dont les soubassements se font ressentir de nos jours. Avec sa reconsidération pour la grammaire, les actes de parole et la portée sémantique des items grammaticaux acquièrent une place primordiale dans la classe de langue. Ainsi, l’apprentissage de la langue s’effectue désormais par la communication, en d’autres termes par la mise en œuvre situationnelle des actes de langage dans un discours, réel ou fictif. La pédagogie de l’action et du projet a redistribué encore les rôles de l’activité de la langue, qui a finalement regagné plus d’importance à côté d’autres composantes de la compétence communicative, et ce avec l’avènement de la perspective action nelle, reposant essentiellement sur la communication et l’action. Mots-clés : approche communicative, perspective actionnelle, grammaire séman tique, tâche, CECR The Teaching and Learning of Grammar: From the Communicative Approach to the Task-Based Approach, the Case of the Baccalaureate Classes in Tunisia Abstract If there is an approach that has marked the teaching and learning of languages, it is the communicative approach, which has been in vogue since the nineteen seventies and continues to influence pedagogy today. By reconsidering grammar, the acts of language and the semantic value of grammatical items acquire an essential role in the language class. Thus, language learning now occurs through communication, the situational implementation of acts of language in a speech, either real or fictional. Action-based and project-based pedagogy have further redistributed the roles of the language activity, which have finally regained more importance along with other components of the communicative competence with the advent of the task-based approach, which is based essentially on communication and action. Keywords: communicative approach, task-based approach, semantic grammar, task, CEFR Mhadeb Boudabous Laboratoire Philab, Groupe de recherche : Éducation et culture, Tunisie mhadebboudabous@yahoo.fr GERFLINT ISSN 1766-3059 ISSN en ligne 2260-7846 Synergies France n° 12 - 2018 p. 49-66 Introduction L’avènement de l’approche communicative (AC) en didactique du français langue seconde ou étrangère (FLE ou FLS) s’est opéré grâce à de nouvelles orien tations et à des choix méthodologiques reposant entre autres sur la grammaire sémantique (GS). La centration s’effectue désormais sur l’apprenant, autre notion prônée par l’AC ; en effet, la langue, qui était envisagée comme objet à apprendre, est devenue un moyen pour communiquer un message à un interlocuteur, de même que la grammaire, « la vieille dame », selon D. Coste, « rôde » toujours autour de la classe de langue ; elle est envisagée de façon fonctionnelle. Le passage au paradigme de l’action avec la perspective actionnelle (PA) a permis, quant à lui, de mieux adopter les apports de l’AC, et de faire en sorte que l’apprenant soit un usager de la langue, qu’il est en train d’apprendre, d’où l’appellation d’« acteur social », ramenée par le CECR. Nous étudierons d’abord l’une des soubassements de l’AC, à savoir la grammaire du sens, pour nous intéresser par la suite de près à la manière dont est abordée la grammaire avec la perspective actionnelle avant d’aboutir à une mise en œuvre et un examen concis d’une expérimentation, une tentative de garantir un va-et-vient entre la réflexion théorique et la pratique de terrain. 1. La grammaire du sens A travers un questionnaire élaboré en 2012 pour décrire les représentations des élèves tunisiens sur l’activité grammaticale, et son intérêt, nous nous sommes rendu compte que cette dernière ne motive pas vraiment l’apprenant ; elle est enseignée pour ainsi dire de manière systématique, inductive1, en appelant l’étu diant à produire parfois de courts énoncés sinon des phrases hors contexte, et donc vides de sens. Par conséquent, la grammaire est perçue négativement par les élèves, ressentie comme une activité stressante, sans intérêt. C’est ce qui a amené à réfléchir à la mise en œuvre d’une grammaire sémantique (GS), c’était comme une nécessité si l’on veut que l’élève reprenne goût à cette activité fondamentale pour l’apprentissage d’une langue. Alors qu’est-ce qu’on entend par la GS ? Quels en sont les fondements ? Quels intérêts a-t-elle pour l’enseignement-apprentissage des langues ? 1.1. Place de la grammaire du sens dans l’approche communicative La définition suivante de l’AC met l’accent sur des facteurs autres que linguis tiques dans l’enseignement-apprentissage de la grammaire : 50 L’ enseignement-apprentissage de la grammaire « Elle (l’AC) met l’accent sur la situation de communication, et plus spécia lement sur le message, utilise de préférence des documents authentiques, propose des activités réalistes (parce que calquées sur les situations de la vie quotidienne), a pour objectif de rendre progressivement l’élève (qu’elle appelle apprenant) autonome dans son discours oral et écrit (parce qu’elle l’intègre très tôt dans son processus d’apprentissage » (Robert, 2008 : 36). Cela dit, les actes de parole, les simulations et le contexte situationnel permettent la mise en œuvre des particules grammaticale qui seront actualisées lors de toute communication, aussi minime soit-elle. Réduire l’activité grammaticale à des manipulations stériles n’a presqu’aucun intérêt pour les apprenants puisqu’elles s’apparentent à des règles à retenir de façon mécanique sans qu’ils aient le temps d’assimiler les concepts qui les sous-tendent. La lourdeur du métalangage est gênante ; cela nécessite un effort parfois consi dérable afin d’en assimiler les notions et les concepts. L’enseignant s’efforce de faciliter à ses élèves l’accès à un savoir académique qui n’est pas à leur portée, et qui est en mesure de les empêcher de consolider leurs savoirs et savoir-faire antérieurs et d’en acquérir d’autres en vue d’affiner ainsi leurs compétences et les développer. Ainsi, ces efforts n’auraient pas les effets escomptés vu les blocages qui peuvent être causés par le recours à un métalangage repérable avec des expres sions comme « support, conjonctive, complétive2 » etc. Cela a poussé certains linguistes, à l’instar de P. Charaudeau, à penser à une grammaire dont la principale orientation est celle d’aborder la langue par le critère sémantique. Afin de justifier ce choix, Charaudeau¹ recourt, entre autres, à l’exemple suivant : « De même qu’il n’est point besoin d’être mécanicien pour conduire une voiture, il n’est pas nécessaire de savoir analyser une langue pour bien s’exprimer » (Charaudeau, 1992 : 2). A l’étude par exemple du discours rapporté, qu’est-ce qui oblige l’élève à analyser le discours, à décrire ce qui relève du style direct, du style indirect, ou encore de cette spécificité de la langue soutenue, à savoir le discours indirect libre ? Qu’est-ce qui l’amène à retenir les caractéristiques de chacun, à maîtriser les mécanismes de transposition, la concordance des temps, etc. ? Est-il contraint de manipuler un métalangage lourd et parfois hermétique ? Si l’on a l’intention d’amener l’élève à reconnaître le discours rapporté, à en produire à son tour, il suffit de l’exposer à des situations de communication où il peut observer le déroulement réel d’un acte de communication (réel ou simulé). Il pourra constater sans peine ces genres de discours, reconnaître leurs spécificités, leurs rôles dans les échanges, mais aussi la manière dont le locuteur les organise, les emploie, de même que leur actualisation situationnelle puisque les interlocuteurs 51 Synergies France n° 12 - 2018 p. 49-66 échangent et communiquent devant l’élève, en temps réel. L’enseignant aura ainsi la possibilité, s’il le veut, de mettre l’apprenant en situation de communication lui aussi. De cette manière, par l’observation d’actes communicatifs, puis par l’impli cation effective de l’élève, l’apprentissage pourrait devenir intéressant et efficace pour ce dernier, qui réalise que ce qu’il s’approprie a du sens, et sert à quelque chose dans la vie, scolaire ou sociale. D’ailleurs, dans sa langue de socialisation, il a l’habitude soit d’observer de pareilles situations où l’on recourt au discours pour rapporter des paroles directement ou indirectement, soit d’être lui-même en posture d’interlocuteur ou de locuteur, où une grammaire « fondée sur le sens », selon l’expression de M-C. Fougerouse (2001 : 5) est de rigueur. L’on constate ainsi l’aspect fondamental du sens dans la classe de langue, c’est ce qui a amené P. Charaudeau à nous fournir l’exemple de la cheminée, voulant illustrer son choix d’une telle grammaire, qu’il a justement nommée Grammaire du sens et de l’expression. Si « communiquer consiste à transmettre une intention pré-construite », nous pouvons affirmer que l’AC est ainsi fondée sur la grammaire du sens dans la mesure où tout doit être organisé autour d’un message à faire passer en L23 et non d’un contenu à apprendre sur cette langue, comme dans les anciennes méthodes les « tableaux structuraux ou encore les drills de substitution ou de transformation » (Capré, 2002 : 1). Il est toujours question de grammaire, mais abordée autrement, selon un critère sémantique, qui ne nie en aucun cas les unités et formes classiques de langue, traditionnellement appelées classes de mots (adverbe, nom, adjectif, …). L’exemple de la cheminée uploads/Management/ l-x27-enseignement-apprentissage-de-la-grammaire-de-l-x27-approche-communicative-a-la-perspective-actionnelle-le-cas-de-la-classe-de-terminale-en-tunisie 1 .pdf
Documents similaires








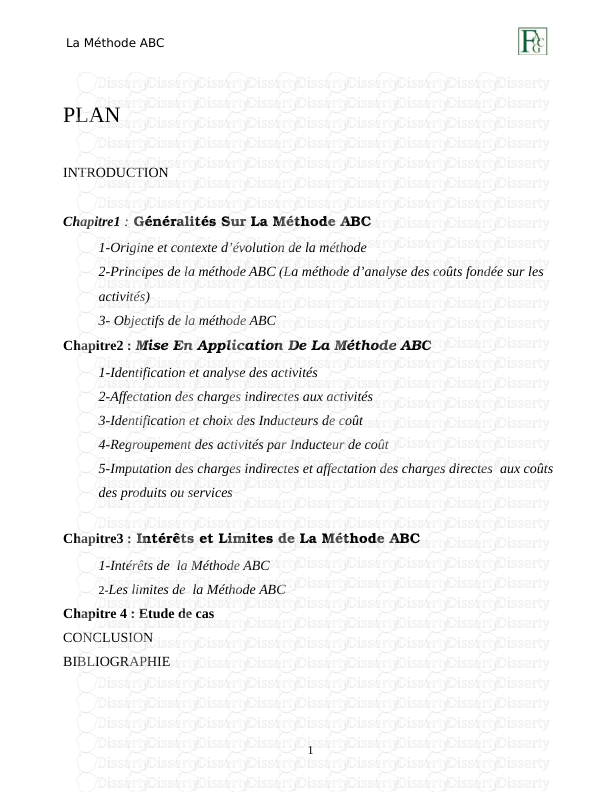

-
99
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 07, 2022
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 0.3211MB


