HUMAIN, TROP HUMAIN II Opinions et sentences mêlées Le Voyageur et son ombre Du
HUMAIN, TROP HUMAIN II Opinions et sentences mêlées Le Voyageur et son ombre Du même auteur dans la même collection AINSI PARLAIT ZARATHOUSTRA. L’ANTÉCHRIST. AURORE. LE CAS WAGNER. CRÉPUSCULE DES IDOLES. ECCE HOMO. NIETZSCHE CONTRE WAGNER. LE GAI SAVOIR. GÉNÉALOGIE DE LA MORALE. HUMAIN, TROP HUMAIN I. HUMAIN, TROP HUMAIN II. Opinions et sentences mêlées. Le Voyageur et son ombre. LE LIVRE DU PHILOSOPHE. LA NAISSANCE DE LA TRAGÉDIE. PAR-DELÀ BIEN ET MAL. SECONDE CONSIDÉRATION INTEMPESTIVE. De l’utilité et de l’inconvénient des études historiques pour la vie. SUR L’INVENTION DE LA MORALE. Généalogie de la morale, deuxième traité (édition avec dossier). © Flammarion, Paris, 2019. ISBN : 978-2-0812-8008-3 NIETZSCHE HUMAIN, TROP HUMAIN II Traduction inédite de Éric BLONDEL, Ole HANSEN-LØVE et Théo LEYDENBACH Présentation, notes, bibliographie et index de Éric BLONDEL GF Flammarion Für Ole, meinen Haberer und lieben Freund, k.u.k : « Radetzskymarsch » auf ewig ! É. B. PRÉSENTATION « Un azur profond enivrait mes yeux. » Proust, Le Temps retrouvé. Une œuvre de la « maturité » Présenter les deux ouvrages qui composent la seconde partie d’Humain, trop humain — Opinions et sentences mêlées et Le Voyageur et son ombre — est en vérité une tâche malaisée, pour ne pas dire ingrate. D’abord, le titre d’ensemble, Humain, trop humain. Deuxième partie, peut faire penser qu’il ne s’agit en l’espèce que d’un supplé- ment, d’un appendice, voire d’une « rallonge » ou d’une « resucée », c’est-à-dire de la simple reprise de sujets déjà traités, d’un délayage. Plus grave pour le lecteur poten- tiel : alors que Nietzsche fait preuve d’un art consommé dans le choix de titres scandaleux, accrocheurs et percu- tants, riches de connotations qui frappent l’imagination et de promesses mystérieuses qu’on est pressé de voir se réaliser, il semble ici avoir renoncé à l’originalité pour tomber dans la banalité et même la platitude : Opinions et sentences mêlées, c’est un titre qu’on oublie sur-le- champ, en se demandant même si c’est bien un ouvrage de l’auteur de Par-delà bien et mal, d’Ecce homo ou de la Généalogie de la morale… On en oublierait presque, aussi, la seconde division de cette deuxième partie, que Nietzsche appelait justement le « second supplément » d’Humain, trop humain : Le Voyageur et son ombre. HUMAIN, TROP HUMAIN II 8 Pourtant, ils sont bien de Nietzsche, et en outre indiscu- tablement marqués au sceau de sa pensée telle qu’elle se développe à partir de ce grand livre qu’est Humain, trop humain, qui ouvre la deuxième période de sa pensée, jus- qu’à Aurore (1881) et à la première édition du Gai Savoir (1882). Mais quelle est cette pensée de cette période dite de « maturité », authentiquement nietzschéenne, mais pas encore parvenue à ses notions, concepts, images et sym- boles définitifs, tels qu’ils apparaissent avec éclat et même pompe, emphase et grandiloquence dans Ainsi parlait Zarathoustra (1883-1885) avant d’être rassemblés dans un ensemble cohérent et plus conceptualisé dans la dernière période, depuis Par-delà bien et mal (1886) et la Généalogie de la morale (1887) jusqu’aux grands textes de 1888 ? C’est là qu’il est intéressant et fécond de définir la spécificité des grands textes de cette période « intermé- diaire », dont Nietzsche conservera et accentuera cer- taines caractéristiques, même une fois qu’il aura précisé l’objet et trouvé la problématique et la méthode qui seront plus tard les siens dans sa « mise à découvert de la morale chrétienne 1 », sa généalogie de la morale et sa critique du christianisme. L’objet de la pensée de Nietzsche, c’est, depuis le début et jusqu’à la fin, la culture, la civilisation (Kultur). La définition et le traitement de cet objet changent, mais il s’agit toujours de l’ensemble des idéaux, des mœurs, des institutions, des œuvres caractéristiques d’un peuple, d’une époque, d’une histoire, d’une civilisation, dont Nietzsche cherche à cerner l’unité et dont il finit par trouver le principe en parlant par exemple dans ses derniers ouvrages de la « morale platonico-chrétienne » 1. Ecce homo, IV, § 7 et 8. PRÉSENTATION 9 ou de la « morale » tout court, dont la domination com- mence par Socrate le « décadent 1» et se poursuit jusqu’au pessimisme, la morale de la « compassion » et la négation du vouloir-vivre schopenhaueriens. Mais qu’en est-il de la méthode d’analyse de Nietzsche dans la période qui nous intéresse ici, étant admis qu’elle se constitue petit à petit et, du même coup, fait varier plus ou moins sensiblement aussi bien la définition de son objet que ses principes et modes d’analyse ? Qu’en est-il, en outre, du style d’écriture et de réflexion, du mode de pensée de Nietzsche dans ces ouvrages de la « deuxième période » et en particulier dans le second volume d’Humain, trop humain ? En d’autre termes, et plus brutalement : s’agit-il ici d’un discours philoso- phique ? Cette interrogation est ancienne et classique, et elle a souvent débouché sur des réponses aussi péremp- toires que tranchées, qu’il se soit agi d’exclure Nietzsche de la philosophie telle qu’on la concevait, en quelque sorte par défaut ou par excès, ou qu’on ait jugé ses ouvrages dignes d’entrer dans le champ philosophique — là encore au prix d’une réduction à une certaine conception de la philosophie, ce qui avait pour consé- quence de laisser de côté comme accessoires et non phi- losophiques de grands pans de sa pensée. Or il se trouve que le style, la méthode et l’objet de la réflexion de Nietzsche dans ces ouvrages de la période dite de « maturité » sont déjà typiques de son mode d’analyse : si l’on excepte le « bateau ivre », le monument baroque qu’est le Zarathoustra, il n’en changera pas par la suite et 1. L’astérisque placé à la suite d’italiques signale les termes et for- mules cités par Nietzsche en français. Cette expression se trouve dans le Crépuscule des idoles, « Le problème de Socrate », § 3. HUMAIN, TROP HUMAIN II 10 ils permettent de caractériser sa pensée avant même et indépendamment de la constitution de sa « doctrine » et de sa stratégie définitives, qu’on pourrait appeler, en rac- courci, la « généalogie de la morale platonico-chrétienne ». Il vaut la peine de décrire les grands traits caractéristiques de cette pensée dans sa période intermédiaire, tant du point de vue du style d’exposition que de celui de son objet, en analysant séparément, pour des raisons de clarté de l’exposé, ces deux points de vue, sans oublier que, sur- tout chez Nietzsche, ils sont intimement et par principe liés et que leur distinction ne peut être qu’artificielle. Une pensée par touches successives Le lecteur qui fonde sa conception du discours philoso- phique sur les grandes œuvres de la tradition, d’Aristote à Hegel, voire Schopenhauer, en passant par Descartes, Spi- noza et Kant, ne peut qu’aboutir à la conclusion que l’œuvre de Nietzsche est, au sens propre, excentrique. Au lieu d’une architectonique conceptuelle, d’une construc- tion selon l’ordre des raisons, d’un exposé dogmatique, continu, progressif et démonstratif, les ouvrages de Nietzsche se présentent au moins formellement comme une succession discontinue de paragraphes « séparés » (ce qui correspond à la définition de l’aphorisme, du verbe grec aphorizein, « séparer », « délimiter ») et « concis » — même si tout paragraphe, bref ou long, n’est pas tou- jours un « aphorisme » au sens strict et propre, c’est-à-dire une sentence brève, un apophtegme ou une maxime à la manière, par exemple, des moralistes français 1. On pour- rait parler en l’occurrence non seulement de discontinuité 1. Cf. D. Astor (dir.), Dictionnaire Nietzsche, Robert Laffont, « Bou- quins », 2017, article « Aphorisme » (Blaise Benoit). PRÉSENTATION 11 mais d’éparpillement de l’exposé, chaque paragraphe étant séparé de celui qui le précède et de celui qui le suit par un blanc, qui rompt l’enchaînement logique, méthodique, discursif d’un développement, bref ou long, articulé en plusieurs phrases ou bien laconique et ramassé. Ces blancs ne constituent pas des alinéas, qui sont pour ainsi dire comme les marches successives d’un escalier, les étapes d’une démonstration : ce sont plutôt des pauses, des rup- tures, voire des solutions de continuité dont la pensée du lecteur peut profiter pour méditer et, comme dira Nietzsche plus tard, pour « ruminer 1 ». Cet éparpille- ment, qui n’est pas une faiblesse ou une négligence de la part de Nietzsche, mais correspond à une intention et un style de pensée délibérés, peut être défini comme une pensée par touches successives, qu’on peut compléter, cor- riger, renforcer ou nuancer. Nietzsche l’a expressément définie et revendiquée comme une pensée de l’expérimen- tation, de la tentative, de l’essai, c’est-à-dire, pour employer le mot allemand, du Versuch 2. Or il se trouve que c’est ce mot qui est utilisé pour traduire en allemand le titre des Essais de Montaigne, et il est tentant de reprendre pour Nietzsche la célèbre formule de Montaigne visant à caractériser le style et la composition de son livre, « à sauts et à gambades 3 ». Qu’on jette cependant un coup uploads/Philosophie/ humain-trop-humain-incomplet.pdf
Documents similaires

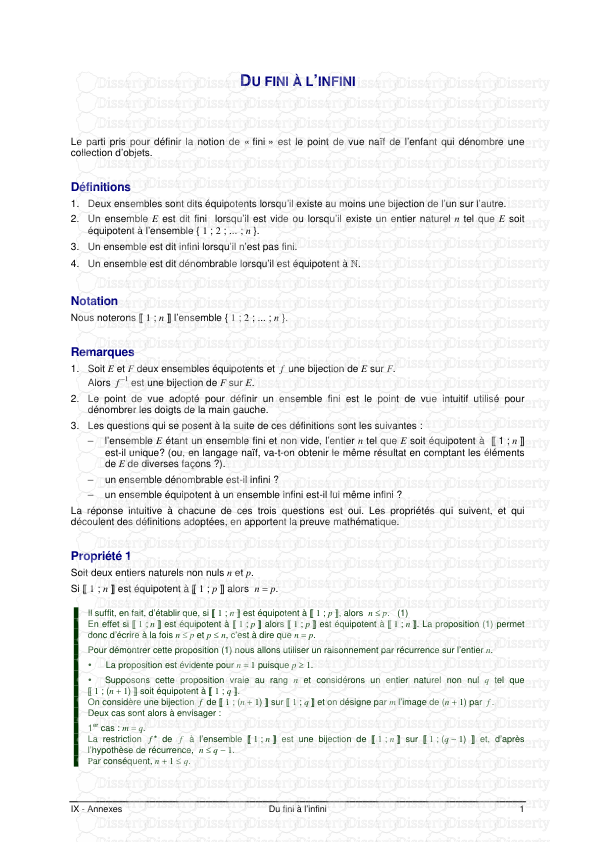








-
54
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 25, 2022
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.7383MB


