ESH – ECO1 Chapitre 6 C. Rodrigues Analyse économique de l’entreprise C. Rodrig
ESH – ECO1 Chapitre 6 C. Rodrigues Analyse économique de l’entreprise C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 1 Première partie : Les théories économiques de la firme 1.1. La firme dans le modèle néoclassique C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 2 1. Les premières approches théoriques de la firme C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 3 Le modèle de la « firme-point » John Hicks (1904- 1989) Paul Samuelson (1915-2009) C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 4 L’équilibre du producteur en CPP Voir cours d’EA, chapitre 4 ! Première partie : Les théories économiques de la firme 1.1. La firme dans le modèle néoclassique 1.2. La firme dans la théorie schumpétérienne C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 5 1. Les premières approches théoriques de la firme Joseph Aloïs Schumpeter (1883-1950) • Economiste autrichien difficile à classer dans une école théorique sinon qu’il est en rupture avec la conception néoclassique. • Son objectif principal était d’expliquer la dynamique économique là où les économistes orthodoxes cherchaient à rendre compte des situations de déséquilibre ou d’équilibre. Ses travaux l’ont conduit à mettre l’accent sur le rôle de l’innovation dans la croissance économique. • Bibliographie principale : • Business cycles (1939) • Capitalisme, socialisme et démocratie (1942) C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 5 6 L’entreprise dans l’analyse de Schumpeter • La fonction de l’entrepreneur dans le capitalisme voir chapitre 5 • Dans Capitalisme, socialisme et démocratie, Schumpeter défend la thèse politique du crépuscule de l’entrepreneur • Le développement des grands groupes industriels dans le courant du XXème siècle transforme en profondeur le capitalisme qui cesse d’être basé sur l’innovation et les risques individuels qui caractérisent l’entrepreneur. • Le système se dépersonnalise, se professionnalise et la propriété privée se fonde désormais sur l’actionnariat. Ce sont alors les managers salariés qui deviennent les dirigeants des firmes. C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 7 Première partie : Les théories économiques de la firme 2.1. La firme comme alternative au marché : la théorie des coûts de transactions C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 8 2. Les théories contractuelles de la firme Les théories contractuelles de la firme // • Deux hypothèses centrales : ①La firme est une organisation économique alternative au marché. Elle se développe lorsque celui-ci est défaillant. ②La firme s’appuie sur un cas singulier de relation contractuelle. C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 9 Définition • Contrat C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 10 Ronald Coase (1910-2013) • Ronald Coase est considéré comme le père fondateur de la théorie des coûts de transaction. Étudiant à la London School of Economics où il rencontra Lionel Robbins, il fut professeur un temps dans son pays natal puis aux universités américaines de Buffalo, Michigan et enfin Chicago à partir de1960. Il fut le rédacteur en chef du Journal of Law and Economics. • Bibliographie sélective : • 1937, "The nature of the firm", Economica, • 1972, "Durability and Monopoly", Journal of Law and Economics. • 1988, The Firm, the Market and the Law, C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 11 The nature of the firm // • Une question surprenante : • Pourquoi les firmes existent-elles ? • Hypothèse de Coase : à chaque fois que deux agents économiques ont recours au marché pour coordonner leurs transactions, cela implique des coûts spécifiques supportés par les deux agents. Coase nomme ces coûts des coûts de transactions. C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 12 Définition • Coordination • Coût de transaction C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 13 Coase distingue 3 types de coûts de transaction // ①les coûts de recherche et d’information ②les coûts de négociation et de décision ③les coûts de surveillance et de contrôle C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 14 The nature of the firm • « Un ouvrier ne passe pas d’un service Y à un service X parce que le prix dans le service X a suffisamment augmenté, comparé au prix dans celui de Y, jugeant ainsi que son déplacement en vaut la peine. Il se déplace de Y vers X parce qu’il en a reçu l’ordre ». • R. Coase, The nature of the firm, 1937. C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 15 The nature of the firm • Deuxième question proposée par Coase : • Pourquoi l’économie n’est-elle pas constituée d’une firme unique ? La prise en charge d’une activité par la firme implique des coûts de production singulier : les coûts d’organisation. C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 16 Définition • Coût d’organisation C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 17 C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 18 Coûts de transactions et coûts d’organisation Contrat Contrat commercial Coûts de transaction Marché Contrat de travail Hiérarchie Coûts d’organisation Arbitrage : coût d’opportunité Taille critique de la firme C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 19 L’arbitrage entre coûts de transactions et coûts d’organisation selon Coase Les limites de l’article de R. Coase // • Trois limites principales : 1. Comment évaluer les coûts de transaction et d’organisation ? 2. A quel rythme les coûts d’organisation progressent-ils avec le développement de la firme ? A quel rythme les coûts de transactions baissent-ils ? 3. Comment la firme peut-elle influer la progression et/ou la baisse de ces coûts ? C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 20 Oliver Williamson (né en 1932) • Professeur émérite à l’Université de Berkeley (Californie). • Lauréat du Prix Nobel d’économie en 2009 • Bibliographie sélective : • Williamson O., Markets and hierarchies. Analysis and antitrust implications. 1975 • Williamson O., « The Modern Corporation : Origins, Evolution, Attributes », Journal of Economic Literature, vol. 19, décembre 1981 • Williamson O., « The New institutional Economics », Journal of Economic Literature, vol. 38, 2000). • Site Internet personnel : • http://groups.haas.berkeley.edu/bpp/oew/ C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 21 Williamson : continuités et ruptures dans la théorie contractuelle • En accord avec les enseignements de Coase, Williamson pose deux hypothèses fondamentales : ①les agents économiques adoptent des comportements rationnels même si leur rationalité est limitée ; ②les firmes se développent dès lors que le marché devient inefficient. • En rupture avec la théorie de Coase, il considère que : ①Les agents disposent d’une rationalité limitée ; ②Les agents évoluent dans un contexte d’avenir incertain et passent des contrats incomplets. C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 22 Williamson : continuités et ruptures dans la théorie contractuelle • Sous quelles conditions les agents rationnels sont-ils incités à adopter des comportements opportunistes ? • Rappel // • Il existe deux cas types de comportements opportunistes : ➠L’opportunisme ex ante (sélection adverse) ; ➠L’opportunisme ex post (hasard moral). C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 23 Williamson : continuités et ruptures dans la théorie contractuelle • Les contrats régulés par le marché incitent aux comportements opportunistes ex ante et ex post. • Williamson montre que deux stratégies rationnelles typiques s’offrent à la firme pour réduire ces comportements opportunistes : ①Elle peut internaliser les contrats (passage du contrat commercial au contrat de travail) ; ②Elle peut opter pour des contrats commerciaux « personnalisés » : filiale ou sous-traitance. ➠Dans les deux cas, Williamson montre que les comportements opportunistes décroissent : processus d’intégration verticale des firmes. C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 24 Les limites du modèle de Williamson 1975 // a) Quelle corroboration empirique à l’hypothèse de comportement opportuniste dans une relation de marché ? b) A quel rythme les coûts de transaction baissent-ils lorsque la firme internalise sa production ? c) Comment expliquer que certaines firmes continuent de préférer le marché à la hiérarchie ? C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 25 Exemple : Renault / Michelin C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 26 Contrat commercial sans filiale ou sous- traitance Quelle incitation à des comportements non opportunistes ? Première partie : Les théories économiques de la firme 2.1. La firme comme alternative au marché : la théorie des coûts de transactions 2.2. La firme comme « nœud de contrats » C. Rodrigues / Lycée Militaire ESH - ECO1 / Chapitre 6 27 2. Les théories contractuelles de la firme La firme : un « nœud de contrats » • A. Alchian et H. Demsetz. Production, information coasts and economic organization, 1972. • Question : quelle est la forme organisationnelle, marché ou firme, qui assure les uploads/Philosophie/ theories-de-la-firme1.pdf
Documents similaires





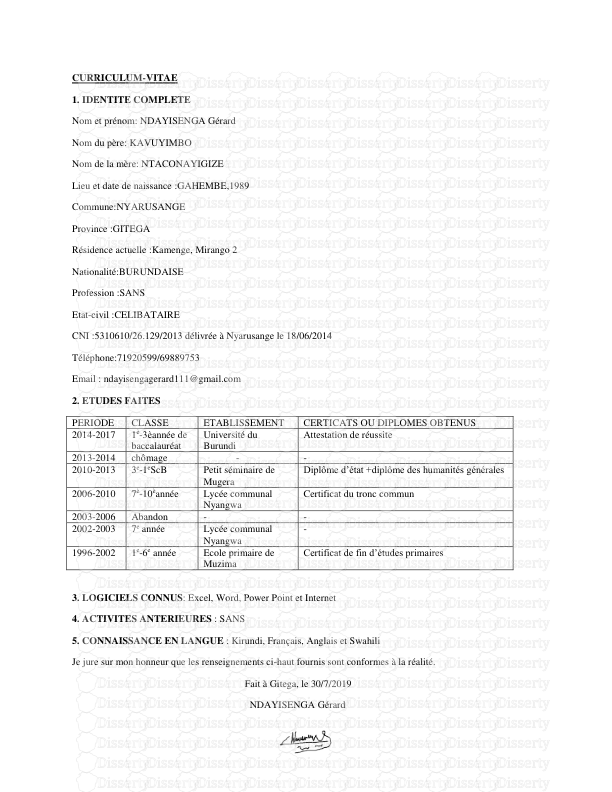




-
61
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 20, 2021
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 2.0377MB


