Méthodologie de recherche S5 2018-2019 Méthodes quantitative et qualitative Le
Méthodologie de recherche S5 2018-2019 Méthodes quantitative et qualitative Le mot méthode désigne une tentative d’explication servant de cadre à une recherche. Il peut se rapporter à une façon d’envisager un travail La méthode dicte alors une manière de concevoir et de planifier une recherche sur un objet d’étude en particulier. Il désigne un ensemble organisé d’opérations qui permettent d’opérer un choix parmi les techniques en vue d’atteindre des objectifs précis La méthode répond à la question du « comment ». On ne peut pas étudier les transformations socio- économiques et les microsystèmes sans s’approcher du terrain se faire plus inductif et se laisser imprégner par l’aire du temps. MÉTHODES LA RECHERCHE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE La première quantifie les données et les traite par tests statistiques La seconde qualitative est plutôt intensive, en ce sens qu’elle s’intéresse surtout à des cas et à des échantillons plus restreints mais étudiés en profondeur. Elle désigne la recherche qui produit et analyse des données descriptives, les comportements observables des personnes et décrypte leurs perceptions. RECHERCHE (OU MÉTHODE) QUANTITATIVE Celle qui fait appel à des mesures numériques Elle fait appel à une mathématisation de la réalité Elle mesure les phénomènes sociaux Elle donne une expression chiffrée aux données Elle analyse les données à l’aide des méthodes statistiques en mettant l’accent sur les mesures et le contrôle des variables. Ce type de recherche peut s’appliquer au grand nombre. La recherche quantitative est généralement plus extensive. Elle a été souvent considérée au départ comme plus rigoureuse, plus scientifique que la méthode qualitative. Mais les phénomènes humains ne se prêtent pas toujours à la quantification. Il faut alors se servir de méthodes qualitatives qui font appel davantage à l’observation et à la compréhension du vécu des personnes. Les phénomènes, quelles que soient les mesures quantitatives les plus sophistiquées utilisées pour les mesurer, gardent une dimension qualitative. RECHERCHE QUALITATIVE Elle aide à comprendre le déploiement des processus sociaux en s’attardant à montrer comment les personnes et les groupes les vivent. Elle est phénoménologique. Elle s’attache à la compréhension des phénomènes tels qu’ils nous paraissent. Elle vise à démontrer un phénomène par le biais de descriptions, de classification ou de typologie. Les deux types de méthodes sont considérées comme étant des contributions complémentaires à l’avancement scientifique. Les deux procédés méthodologiques sont des acquis communs aux sciences sociales. LES SIX ÉTAPES DU PROCESSUS DE RECHERCHE 1.1 Objet : étape de définition et de détermination du champs de l’étude : - Il faut définir, dès le départ, même de manière très provisoire, les « objets » sociaux que l’on veut étudier. - Il faut préciser l’envergure et les limites du travail à entreprendre : Quel phénomène touche-t-on ? Dans quelle extension ? Comment l’articule-t-on avec l’environnement social, économique, politique auquel il appartient ? 1- DÉTERMINATION DE L’OBJET ET DE LA NATURE DE L’ÉTUDE 1- DÉTERMINATION DE L’OBJET ET DE LA NATURE DE L’ÉTUDE 1.2 Nature : Il s’agit de préciser la nature de la recherche ou de l’étude que l’on entend développer : • Une étude peut être simplement exploratoire (balayage, tour d’horizon) • Elle peut être descriptive en s’appliquant à énumérer et décrire, sous une forme monographique, les éléments composant une réalité • Elle peut être explicative en tentant de lier entre un certain nombre d’éléments composant la réalité sociale - données et variables – • Ces différentes natures peuvent être présentes en même temps dans une étude 2- ÉTABLISSEMENT DES HYPOTHÈSES DE TRAVAIL Elle correspond à la traduction des éléments de connaissance déjà accumulés en réponse possible et provisoire aux questions que l’on se pose : - Les hypothèses de travail sont les fils conducteurs qui permettent de traverser la réalité en collectant les données appropriées aux objectifs poursuivis - Ce sont des propositions de réponse aux questions que l’on se pose et qui doivent être formulées en termes tels que la collecte de données puisse leur apporter, soit une confirmation, soit une infirmation, soit encore des modifications, enrichissements, nuances… - Elles ont pour raison d’être de guider l’investigation - Elles sont destinées à être abandonnées ou maintenues après observation - Il faut que les hypothèses soient simples, claires et synthétiques et décomposables en éléments observables 3- PRÉPARATION À LA PHASE OPÉRATIONNELLE C’est la phase de décomposition des hypothèses en éléments ou variables observables et la mise au point de techniques de collecte qui permettent de les infirmer ou confirmer : • On peut imaginer des procédures convergentes où on procède à un dosage plutôt qu’à un choix restrictif • Il faut confectionner les instruments de collecte : fiche de statistiques, guide d’observation, questionnaire, guide ou canevas d’interview,… 4- COLLECTE DES DONNÉES Elle englobe autant la collecte de données documentaires que la collecte de données d’observation directe : • Collecte documentaires : documents, chiffres, cartes, tableaux, graphiques,… • Collecte par enquête : utilisation du carnet de bord dans les enquêtes intensives, les réunions quotidiennes de groupes dans les enquêtes extensives. 5- DÉPOUILLEMENT ET TRAITEMENT Cette opération se fait de manière manuelle ou automatique : • Codage : précède le dépouillement pour la mise en forme des données (collectes extensives) • Catégories de classement qualitatives (collectes intensives) • Analyse de contenu Établissement de généralisations, systématisations et construction de « lois » (construction de schémas généraux d’explication d’un phénomène): • Confronter les résultats de recherche à d’autres recherches (comparaison) et avec des systèmes théoriques existants qui ont une vocation d’explication de la réalité sociale • Des comparaisons et des confrontations répétées naissent les nouvelles « théories », modèles ou approches socio-économiques, partielles ou globales. 6- ÉTABLISSEMENT DES GÉNÉRALISATIONS LES TECHNIQUES DE COLLECTE - C’est la collecte systématique de données à travers les documents : recherche bibliographique. Elle se caractérise essentiellement par : - Un constat médiatisé par des documents (traces écrites et/ou documents phoniques photographiques cinématographiques,…) - Une « récupération » de données OBSERVATION INDIRECTE OU DOCUMENTAIRE APPORT DES DONNÉES DOCUMENTAIRES EXTENSIVES - Les données documentaires sont de nature extensive (recensements, Enquêtes nationales, …) - Elles permettent de bien situer les phénomènes expliqués dans l’ensemble social (mise en contexte, cadrage, estimations de grandeur, absolues ou relatives,…) - Elles représentent une base de sondage pour tirage d’échantillons raisonnés, qualifiés pour l’établissement de typologies, pour le choix d’études de cas… - Elles peuvent apporter, à une observation directe extensive, trois formes d’appoints : • Un complément sur des aspects non abordés par l’enquête, • Une confrontation de résultats (confirmer, appuyer ou au contraire contredire, ou encore montrer qu’une population i liè di i d’ l i é é l APPORT DES DONNÉES DOCUMENTAIRES INTENSIVES • Elles donnent de la consistance et une dimension « compréhensive » à une collecte de faits ponctuels ou chiffrés • Le risque à éviter est la confusion en termes de temps, d’espace et catégories de définition propres à la recherche OBSERVATION DIRECTE • C’est la forme la plus répandue de collecte de données dans les études à caractère socio-économique : • C’est une information de « première main », directement collectée pour les besoins de l’étude à réaliser (questions-réponses ; sondages, enquêtes par questionnaires, interviews, etc. ou d’autres formes) • L ’observation directe « silencieuse » : on observe et on consigne les faits et les pratiques • L ’observation participante basée sur l’immersion de l’observateur dans le groupe, la société, l’institution qui font l’objet de l’étude… L’OBSERVATION INTENSIVE • Elle prétend restituer au réel toute sa complexité et sa profondeur, à partir d’analyses individualisantes où les variables sont prises en compte dans leur globalité, par rapport aux groupes ou aux individus faisant l’objet de l’étude et ce, en vue de comprendre leurs articulations. • En raison de cet objectif, qui nécessite un approfondissement important, le nombre de cas sur lesquels on peut collecter cette information reste forcément limité. L’OBSERVATION INTENSIVE (SUITE) • Elle intervient surtout pour : • Décrire des phénomènes dans la méconnaissance actuelle ou le caractère complexe empêche la description par indicateurs superficiels • Décomposer et comprendre le comment et le pourquoi de comportements et pratiques déjà décrits ainsi que le comment et le pourquoi de leurs différences ou similitudes • Différencier des comportements extérieurement homogènes et faire apparaître les hétérogénéités, originalités, spécificités et « anomalies ». Dans le même sens appréhender les comportements non majoritaires. • Évaluer et mesurer l’intensité d’une ou plusieurs caractéristiques présentes chez un individu ou dans un groupe • Analyser le rapport entre comportements et pratiques d’une part et système de perception et de représentation des populations concernées d’autre part. • Comprendre et approfondir des phénomènes relevés et quantifiés par l’enquête extensible. (quantitative) et leur donner une « épaisseur sociologique » CONTENUS DES OBSERVATIONS • Grâce aux techniques intensives et extensives, on peut observer : • Les questions de faits : les individus interrogés fournissent des informations sur des faits concrets, sur des données même parfois chiffrées (âge, statut d’occupation, catégories socioprofessionnelles, lieu de naissance, nombre d’enfants, nombre d’employés, date de la création de l’établissement,…). Les questions de faits concernent le plus souvent les personnes, ménages ou groupes de personnes uploads/Science et Technologie/ cours-methodologie-2.pdf
Documents similaires

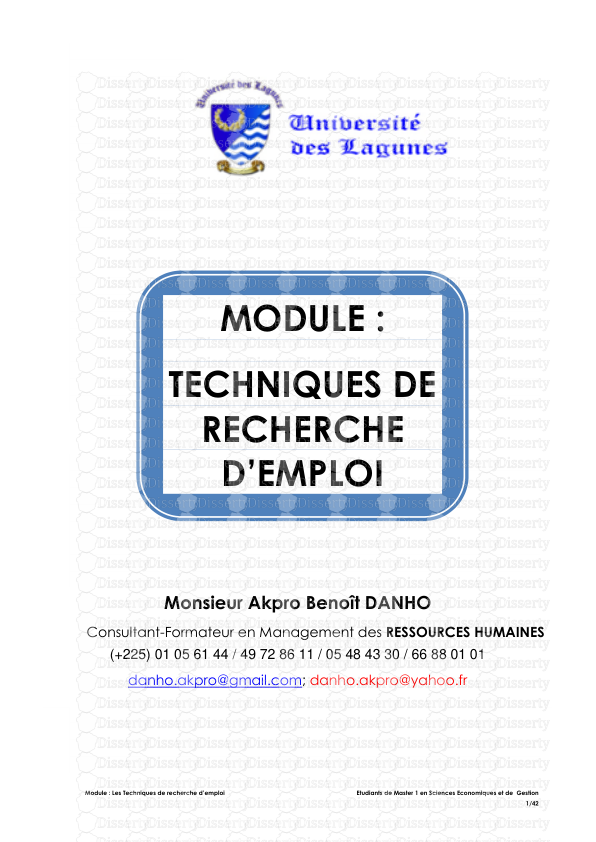








-
82
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 13, 2021
- Catégorie Science & technolo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1583MB


