Rapports sur les mémoires de mai 2009 Page 1 © Organisation du Baccalauréat Int
Rapports sur les mémoires de mai 2009 Page 1 © Organisation du Baccalauréat International 2009 HISTOIRE Seuils d’attribution des notes finales Note finale : E D C B A Gamme de notes : 0 - 7 8 - 15 16 - 22 23 - 28 29 - 36 Remarques générales Malgré le très grand nombre de candidats ayant choisi de rédiger leur mémoire en histoire, la session s’est bien déroulée puisque les candidats, les superviseurs et les examinateurs se sont bien adaptés au nouveau programme et aux nouveaux critères. Quelques centres ont utilisé l’ancienne chemise du mémoire. Nous avons été impressionnés par le nombre de superviseurs qui ont rédigé des commentaires, mais quelques examinateurs ont indiqué que les rapports des superviseurs comportaient peu ou pas de commentaires. Variété et pertinence du travail présenté Les sujets choisis variaient, comme à l’accoutumée, mais la grande majorité d’entre eux méritaient de faire l’objet d’une recherche et d’une étude, et portaient réellement sur l’histoire. Il a toutefois été décevant de constater que certains candidats utilisaient trois questions de recherche ou titres différents dans leur mémoire : une première version sur la chemise, une version différente dans le résumé et une troisième version dans l’introduction. Parmi les mémoires présentés à l’évaluation, très peu excédaient le nombre limite de 4 000 mots, mais un trop grand nombre d’entre eux étaient trop courts puisqu’ils avaient la longueur d’une dissertation faite en classe. Il semblerait que certains de ces mémoires trop courts aient été trop bien jugés par les superviseurs. D’autres avaient de toute évidence été écrits sans enthousiasme et en très peu de temps, en utilisant des sources issues d’Internet ayant toutes été consultées le même jour. Il convient toutefois de signaler qu’il s’agissait d’exceptions puisque la grande majorité des mémoires laissaient transparaître le dur labeur et les efforts fournis par les candidats, tant en ce qui concernait la recherche que l’écriture. Résultats des candidats pour chaque critère d’évaluation A : question de recherche Comme nous l’avons indiqué précédemment, les questions de recherche – ou leur absence – restent un problème. Nous rappelons aux superviseurs qu’il est maintenant obligatoire d’énoncer clairement la question de recherche dans l’introduction. B : introduction Les examinateurs ont constaté avec surprise qu’il y avait des problèmes dans cette section qui empêchaient l’attribution des 2 points disponibles : il était souvent difficile de déterminer où se terminait l’introduction, sauf lorsque le candidat avait utilisé le titre « Introduction » suivi Rapport sur les mémoires de mai 2009 Groupe 3, histoire Page 2 d’un autre titre pour la partie suivante ou au moins un espace pour séparer l’introduction de la partie suivante. Dans les introductions qui avaient tendance à être présentées sous forme de narration du contexte, l’importance et le contexte du sujet n’étaient pas toujours clairs. Il est important que les candidats montrent pourquoi le sujet mérite de faire l’objet d’une recherche. C : recherche La plupart des candidats, y compris les plus faibles, ont été capables de fournir des preuves d’une planification de la recherche et de recueillir des données pertinentes. L’utilisation d’un « éventail suffisant/ingénieux de sources » était plus problématique. Il convient de tenir compte du fait qu’il est difficile de se procurer des sources, surtout en cette époque où les problèmes financiers ne permettent pas d’en acquérir autant, et qu’Internet est très utile pour obtenir des sources primaires. Toutefois, les mémoires s’appuyant uniquement sur des sources générales non évaluées issues d’Internet (par exemple, Wikipédia) n’ont pas obtenu de bons résultats dans ce critère. Les matériaux pertinents n’ont pas toujours été choisis de manière efficace et les candidats ont plutôt eu tendance à les placer dans de longues annexes. D’autre part, d’excellents mémoires s’appuyant sur des sources universitaires récemment publiées, y compris des articles, ont été présentés à l’évaluation. D : connaissance et compréhension du sujet étudié La plupart des candidats ont été capables d’obtenir d’assez bons résultats dans ce critère, et ce, en raison du fait qu’ils connaissaient le sujet sur lequel portait leur mémoire. Beaucoup de mémoires manquaient cependant de preuves et de références pertinentes. Les candidats qui ont démontré une connaissance et une compréhension approfondies, généralement manifestes dans l’analyse, ont obtenu de bons résultats dans ce critère. E : raisonnement Ce critère est lié à la question de recherche. Il est bien plus aisé pour le candidat de construire son argumentation lorsque ce dernier répond à une question portant sur un sujet bien défini. Les meilleurs candidats ont été capables de traiter leur question de recherche de manière cohérente et logique. Les bons candidats ont développé et fait avancer leur argumentation tandis que les plus faibles ont utilisé des généralisations et ont rédigé des comptes rendus narratifs des événements. Trop de mémoires, notamment ceux fondés sur une hypothèse, sont des réponses narratives ou descriptives qui rendent difficile la production d’une argumentation analytique. F : utilisation de compétences d’analyse et d’évaluation adaptées à la matière La plupart des candidats ont démontré une certaine capacité d’analyse, mais les candidats les plus faibles ont souvent utilisé deux sections distinctes pour la narration et l’évaluation, y compris l’évaluation des sources utilisées dans une autre section (comme ils le font dans leurs travaux d’évaluation interne). Rapport sur les mémoires de mai 2009 Groupe 3, histoire Page 3 G : utilisation d’un langage adapté à la matière Étant donné qu’il n’y a pas de vocabulaire technique en histoire, il convient d’utiliser un vocabulaire approprié. Par exemple, il faut éviter d’utiliser « créer » dans tous ses sens (c’est- à-dire « instituer », « fonder », etc.) et d’écrire des généralisations non étayées, notamment des généralisations exagérées dans lesquelles le candidat emploie des termes tels que « tous », « tout le monde », « énormément » pour n’en citer que quelques-uns. Les examinateurs veillent également à ne pas pénaliser les candidats qui rédigent leur mémoire dans une langue qui n’est pas leur première langue. L’obtention d’un très bon résultat dans ce critère n’est toutefois pas aussi aisée qu’il y paraît. H : conclusion À l’opposé de l’introduction, la plupart des candidats ont obtenu 2 points dans ce critère. Les examinateurs ont toutefois relevé trois points faibles : l’introduction de nouveaux matériaux, l’utilisation de la conclusion pour analyser le mémoire dans sa totalité et la rédaction d’une conclusion au sujet plutôt que d’une conclusion au mémoire. Il convient toutefois de noter que la plupart des candidats ont correctement conclu leur mémoire et que leur conclusion était en rapport avec les preuves présentées dans leur mémoire. I : présentation formelle Les mémoires qui ne comportaient pas de références ou de bibliographie et ceux qui excédaient 4 000 mots se sont vus attribuer la note 0 dans ce critère. Chaque transgression mineure a été pénalisée d’un point. La plupart des candidats ont obtenu 2 ou 3 points dans ce critère. J : résumé Le résumé continue à poser problème aux candidats. Un trop grand nombre d’entre eux résume le sujet ou la discipline au lieu de traiter les trois éléments requis, à savoir la question de recherche, l’envergure du mémoire (c’est-à-dire les principaux domaines faisant l’objet de la recherche – à ce sujet, l’utilisation de sous-titres dans la table des matières aide grandement) et la conclusion. K : évaluation globale Bon nombre de superviseurs et d’élèves trouvent ce critère difficile. La note moyenne est, et devrait probablement être, un 2. Les mémoires portant sur des sujets courants traités avec perspicacité, qui démontrent une compréhension approfondie, peuvent obtenir 4 points, et ce, même s’il s’agit de sujets bien connus. Recommandations pour la supervision de futurs candidats Il est évident que les enseignants, les candidats et les examinateurs doivent bien étudier le nouveau guide Le mémoire – Guide pédagogique et prendre note des légères variations par rapport à l’ancien guide. Les candidats ont besoin de davantage de conseils et d’aide pour produire une question portant sur un sujet bien défini. Rapport sur les mémoires de mai 2009 Groupe 3, histoire Page 4 Les séances de groupe sur les références et la bibliographie, ainsi que sur les techniques de recherche et la recherche de sources, sont utiles. Une seule version préliminaire du mémoire doit être minutieusement examinée et critiquée par le superviseur. Ce dernier peut toutefois fournir des conseils verbaux à tout moment, pourvu qu’il n’y ait pas de supervision excessive du candidat. Le rapport du superviseur est l’occasion d’expliquer le contexte dans lequel le candidat a réalisé son travail (par exemple, en commentant le processus et la qualité de la recherche). Il est également très utile d’y faire référence à la soutenance (le cas échéant). L’échéancier fixé par l’établissement doit être publié et respecté. uploads/Science et Technologie/ may-2009-ee-report 1 .pdf
Documents similaires



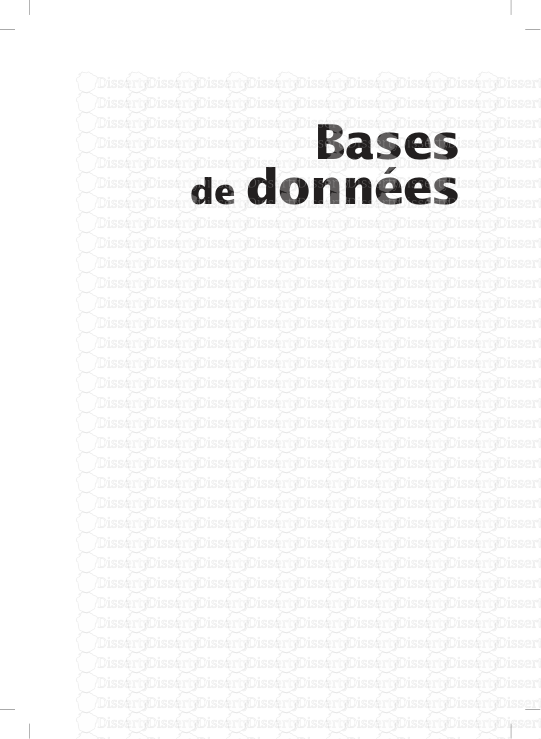






-
100
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 09, 2021
- Catégorie Science & technolo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1089MB


