Michael KAMBALE KYANDA Licencié en Sciences de l’Information et de la communica
Michael KAMBALE KYANDA Licencié en Sciences de l’Information et de la communication, Communication des Organisations de l’Université Chrétienne Bilingue du Congo (U.C.B.C/Beni) 2015 2016 EPISTEMOLOGIE DE LA COMMUNICATION : Réflexion sur les limites des sciences de l’information et de la communication Michael KYANDA K., Réflexion sur les limites des sciences de l’information et de la communication, 2016 Page 2 EPISTE MOLOGIE DE LA COMMUNICATION : Réflexion sur les limites des sciences de l’information et de la communication 0. INTRODUCTION Plusieurs questions se sont déjà posées par un grand nombre de penseurs sur l’existence des sciences de l’information et de la communication, car donnent-ils des preuves sur le doute qu’ils placent. Les S.I.C1, comme on le dit, se sont elles déjà constitués en Sciences ? Pour présenter notre réflexion sur l’épistémologie de la communication, et en répondant d’une manière à cette question, nous allons commencer par donner un sens s’avérant précis au mot Science. Dans le langage courant, le mot science peut avoir plusieurs sens et il convient, avant de se lancer dans un exposé sur l'épistémologie (du grec épistèmê « science » et logos « étude »), de bien les différencier. Selon Robert (1995, p. 2051), dans son application la plus large, le mot science se confond souvent avec le mot savoir ou même simplement connaissance : « Ensemble de connaissances, d'études d'une valeur universelle, caractérisées par un objet (domaine) et une méthode déterminés, et fondées sur des relations objectives vérifiables.» De l’autre coté, Popper (1985, p.230) avec son critère de réfutabilité va encore plus loin et propose qu'un ensemble de connaissances, pour être qualifié de science, doit non seulement être vérifié ou vérifiable, mais doit de plus s'exposer d'avance à être réfuté par l'expérience (par expérience, nous entendons le résultat d'une interaction avec la réalité). Évidemment, certains penseurs trouvent que cette définition de la science ne fait pas l'unanimité. Jarroson (1992, p. 167-168) présente trois limites quant à l'utilisation du critère de Popper que Martin Riopel a résumé, dans son œuvre : “Épistémologie et enseignement des sciences” (2005) ainsi : 1 SIC: Sciences de l’Information et de la communication Michael KYANDA K., Réflexion sur les limites des sciences de l’information et de la communication, 2016 Page 3 1. Il existe des propositions qui ont un sens, mais qui ne sont pas réfutables. Par exemple, « il existe des hommes immortels » ; il faudrait tuer tous les hommes pour démontrer que cette proposition est fausse. 2. Il est rare qu'une expérience permette de ne réfuter qu'une seule théorie à la fois. Par exemple, quand on observe une bille qui tombe pour étudier la mécanique, on admet aussi la théorie de la lumière qui permet de voir la bille. 3. On ne peut jamais être certain de la validité d'une expérience ou d'un ensemble d'expériences. Il faut toujours faire la conjecture fondamentale de se fier à l'expérience. Il dit alors : « La Science est Corps de connaissances ayant un objet déterminé et reconnu, et une méthode propre; domaine organisé du savoir. » Partant de ces définitions ci-haut présentées, nous pouvons dire que ce qu’on appelle la science est un savoir fondé sur des relations objectives et vérifiables partant de son objet et sa méthode.» Ceci pourrait confirmer les Sciences de l’Information et de la Communication partant même de l’appellation attribuée. Ce qui peut alors faire objet de réflexion sur les champs des sciences de l’information et de la communication ce sont ses limites ou frontières par rapport à d’autres sciences (connexes) se comprenant humaines. En effet, C’est l’élargissement de la pensée que nous sommes en train de faire, nous voulons présenter les limites ou frontières des sciences de l’information et de la communication par rapport à d’autres sciences humaines. Hormis l’introduction, la conclusion et la bibliographie, ce travail s’étant sur trois points structuré comme suit : 1. Synoptique de l’histoire des SIC 2. Les champs des SIC et ses limites 3. Concepts des SIC Michael KYANDA K., Réflexion sur les limites des sciences de l’information et de la communication, 2016 Page 4 Il sied à signaler dans cette introduction qu’à travers ces points, nous allons présenter une brève présentation de la naissance des SIC, son institutionnalisation, son évolution en présentant les champs des SIC, les limites générales des SIC en parlant de l’objet, les méthodes utilisées dans les recherches en SIC et en fin les théories et les concepts usuels des SIC. 1. SYNOPTIQUE DE L’HISTOIRE DES SIC a. Au sujet de la naissance de SIC Les sciences de la communication sont nées à l’intérieur des sciences sociales à partir de la cybernétique de Norbert Winner conçu entre 1942 et 1948. C’est après la seconde guerre mondiale, que le champ de connaissance des SIC a émergée sans que leurs histoires ne se confondent entièrement. Depuis les années 1950, la production et la consommation des informations connaissent un formidable développement. Les différents moyens technologiques de stockage, de traitement, et de diffusion de cette masse d’informations sont en perpétuelle évolution. Face à ce nouvel état du monde, il est naturel qu’une science spécifique s’intéresse à ce nouveau phénomène en œuvre et rassemble toute les connaissances relatives à ce phénomène et produise un corps théorique et conceptuel destinée à les analyser. Ce sont les SIC. L’histoire de SIC s’enracine dans l’évolution et le développement de l’informatique. C’est dans les années 1970 que le projet scientifique concernait également la schématologie, la publicité et l’édition, en France, à partir des années 1990, il y a eu inclusion des nombreuses recherches concernant la technologie de l’information et de la communication, les nouveaux media, l’internet, et les communications organisationnelle. Il y a toujours l’absence de nom collectif pour la discipline, chose qui la rend peu ardue : on parle de communicologue au début des années 80, on essaye la médiologie au début des années 90, on essaye la médialogue depuis peu… Mais, les pratiquant de la science sont souvent confondus et étiquetés Michael KYANDA K., Réflexion sur les limites des sciences de l’information et de la communication, 2016 Page 5 des sociologues, philosophe, des politologues, des historiens ce qui laisse dans le flou l’existence d’une discipline universitaire. b. Institutionnalisation des SIC ? Les sciences de l’information et de la communication existent aussi grâce à la création en 1975, de la 71eme section au conseil national des universités. Une commission interdisciplinaire intitulée : « Science de la communication » ont vus le jour au sein du Conseil National des Recherches Scientifique. Les SIC doivent aussi leurs existences aux sociétés savante comme : Association Internationale des Etudes et Recherche sur l’Information (AIERI), International Communication Association (ICA), Association Canadienne de Communication (ACC), etc. Ces sciences existent aussi scientifiquement grâce à certains groupes d’études de recherche labélisée par la Société Française des Sciences de l’Information et de Communication c. Evolution de SIC Les sciences de l’information et de la communication évoluent parallèlement avec les technologies de l’information et de la communication, car c’est grâce à ces derniers que les SIC connaissent le développement. Les théoriciens des SIC se basaient plus à la transmission linéaire de message ne tenant pas compte d’autres manière de transmission. Avec les apports de SFEZ dans la théorie de circularité et de TED Nelson parlant de l’hyper-textualité, il y a évolution dans la compréhension paradigmatique de la communication. Les SIC ont rencontrées quelques problèmes dans leur évolution, notamment : le problème de méthode, et le problème de divergence d’idées des auteurs sur les concepts. Michael KYANDA K., Réflexion sur les limites des sciences de l’information et de la communication, 2016 Page 6 2. LES CHAMPS DES SIC ET SES LIMITES a. Le champ des SIC et les axes de recherches en SIC Le champ des SIC est résolument interdisciplinaire. Les méthodes mises en œuvre par les études qui en relèvent peuvent être diverses, mais chaque étude doit reposer sur une (des) méthodologie(s) bien identifiée(s). Est donc du ressort des SIC, l’étude des processus d’information ou de communication relevant d’actions contextualisées, finalisées, prenant appui sur des techniques, sur des dispositifs, et participant à des médiations sociales et culturelles. Sont également pris en compte les travaux développant une approche communicationnelle de phénomènes eux-mêmes non communicationnels. Les grands axes de recherche Les Sciences de l’Information et de la Communication traitent d’une grande diversité d’objets qui constituent autant de champs de recherche, parmi lesquels : • les processus de production, stockage, transmission et accès à l’information et au document ; • les rapports entre le langage et la communication ; • la production du sens et l’interprétation des textes et des discours ; • la communication interpersonnelle et celle des organisations publiques et privées ; • les pratiques culturelles et les médiations ; • les lieux, techniques, supports et dispositifs qui les organisent ; • les acteurs et les professionnels de la communication qu’elle soit ou non médiatisée ; • les médias de masse et le travail journalistique ; • les logiques de construction de l’information médiatisée et des contenus audiovisuels et leur réception par les publics ; • les uploads/Science et Technologie/article-michael-kyanda-epistemologie-de-la-communication.pdf
Documents similaires





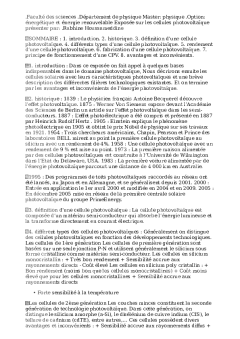




-
66
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 10, 2022
- Catégorie Science & technolo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.8783MB


