Biogeographe insulaire Iles océaniques - ? les continentales A première vue la biogéographie insulaire peut para? tre un domaine somme toute assez restreint réservé à des amateurs de soleil et de milieux enchanteurs Or ce domaine est à l'origine d'un très
Iles océaniques - ? les continentales A première vue la biogéographie insulaire peut para? tre un domaine somme toute assez restreint réservé à des amateurs de soleil et de milieux enchanteurs Or ce domaine est à l'origine d'un très vaste élan de recherches qui a débuté à la ?n des années à la suite d'une proposition d'un modèle général de peuplement des milieux insulaires qui peut être étendu aux écosystèmes terrestres Le morcellement du paysage et la densité des activités humaines sont tels qu'actuellement la plupart des habitats naturels ou semi-naturels sont autant d'? les perdues au milieu d'un environnement fortement modi ?é Ces habitats peuvent être assimilés à des ? les continentales au même titre que les massifs montagneux isolés sur un continent les lacs et étangs dispersés dans une région La ré exion engendrée par la biogéographie insulaire concerne ainsi de très nombreux écosystèmes terrestres La situation d'insularité provoque toute une série de modi ?cations et d'adaptations d'un grand intérêt pour le biogéographe car les ? les o ?rent de nombreux avantages et peuvent être considérées comme de véritables laboratoires naturels Le syndrôme d'insularité Le syndrôme d'insularité résulte de divers ajustements écologiques de l'isolement et des stratégies adaptatives qui en découlent Sur les ? les les peuplements les espèces et les populations présentent di ?érentes caractéristiques ou manifestations du syndrôme d'insularité qui sont propres à leur situation insulaire et qui les distinguent de peuplements espèces et populations similaires sur le continent C Richesse spéci ?que A surface égale il y a toujours moins d'espèces sur une ? le que sur le continent La Corse par exemple ne compte que espèces d'oiseaux nicheurs alors qu'on en observe au moins dans une région équivalente sur le continent Une relation bien connue existe entre la surface d'un élément géographique et le nombre d'espèces qui y est observé Plus la surface est élevée plus le nombre d'espèces est grand Cette relation appelée courbe aire-espèces a la forme d'une courbe croissante monotone qui tend vers une asymptote représentant le nombre maximal d'espèces observé pour l'ensemble du globe terrestre La relation se matérialise par une droite lorsque qu'on utilise une double échelle logarithmique pour la représenter S C Az avec S nombre d'espèces C une constante propre au groupe biologique A aire de la zone considérée et z la mesure de la pente de la droite Cette droite a fait l'objet de très nombreuses discussions car le paramètre z montre une constance remarquable étant habituellement compris entre et CCette relation est aussi observée sur des ? les continentales comme ci-dessus pour des escargots dans des ? lots forestiers isolés Lorsqu'on compare la régression obtenue pour des ? les et celle obtenue pour des zones de surface équivalente sur le continent les ? les ont toujours moins d'espèces mais cette di ?érence s'attenue avec l'augmentation de la surface la croissance est plus rapide sur les ? les que sur le continent Les valeurs du paramètre z sur le continent sont généralement comprises entre et alors
Documents similaires



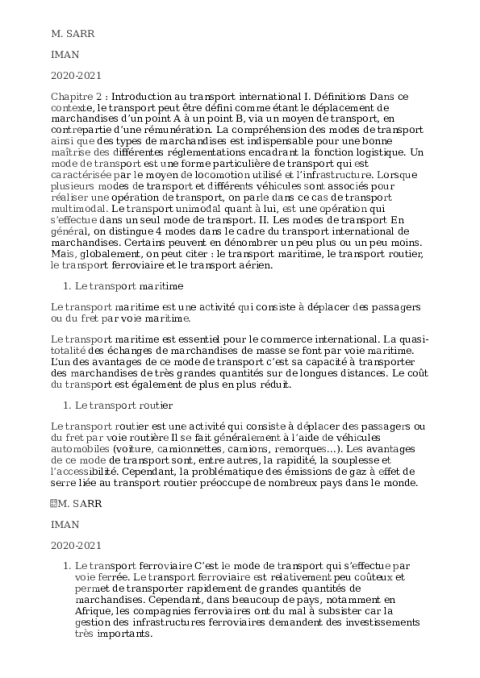





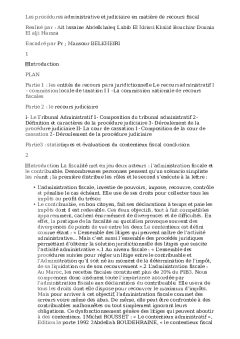
-
91
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 11, 2022
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 46.6kB


