Africa Development, Vol. XXV, Nos. 3 & 4, 2000 La chefferie traditionnelle au C
Africa Development, Vol. XXV, Nos. 3 & 4, 2000 La chefferie traditionnelle au Cameroun: ambiguïtés juridiques et dérives politiques Charles Nach Mback Abstract: It seems that traditional chiefdoms in Africa have never recovered from the trauma caused by their contact with the first European colonisers. The post- colonial state has perpetuated the emasculation of traditional authorities appointed by the colonisers. From devaluing status of servants of colonisation, traditional chiefs were enlisted in single party systems. In both cases, they have lost an important part of their creditworthiness among populations. The latter, however, remain sometimes devoted in spite of all. But these traditional chiefs have never had the opportunity to get back their original autonomy, neither legally, nor politically. As human communities, chiefdoms are sometimes undervalued within the local communities, sometimes equated with existing administrative districts. The new local administration system resulting from the new constitution does not bring any decisive and qualitative changes on these issues, whereas very few possibilities remain open for both constitutional and regulatory standpoints. Introduction Les organisations sociales traditionnelles sont l’une des plus fuyantes aujourd’hui en Afrique. Leur lisibilité pose quelques problèmes de décodage à l’analyste. Peut-être un peu moins au sociologue qu’au juriste, habitué qu’il est à partir de catégories préétablies pour appréhender les données du réel. Mais aucun des deux ne semble à l’abri des interprétations approximatives. L’étude de la chefferie traditionnelle comme élément de l’organisation administrative et territoriale du Cameroun passe par une double considération: la chefferie est d’abord une collectivité humaine établie sur une portion du territoire de l’État. Elle est ensuite le cadre d’exercice de ses compétences par une autorité justement dénommée Africa Development, Vol. XXV, Nos. 3 & 4, 2000 78 Chef traditionnel. Ce dédoublement de la chefferie traditionnelle conduit à une interrogation: s’agit-il alors d’une collectivité locale, d’une circonscription administrative de l’État ou d’une catégorie particulière, sui generis, dans l’organisation administrative et territoriale de l’État? La deuxième interrogation qui ne procède pas forcément de la première porte sur le rôle que joue ou qu’est appelée à jouer la chefferie traditionnelle dans les nouvelles configurations administratives induites par les réformes décentralisatrices en cours au Cameroun. L’étude du régime de la chefferie traditionnelle et du statut de chef traditionnel au Cameroun ne permet pas d’inclure cette institution dans l’un des cadres classiques de l’administration territoriale, sans que l’on puisse à priori lui trouver une camisole originale. Elle reste ce que l’on pourrait appeler un sujet juridique non identifié. La réforme communale (loi n°74/23 du 05 décembre 1974) avait mis fin à la pratique de sièges réservés aux autorités traditionnelles dans les conseils municipaux. La nouvelle législation renoue avec cette tradition introduite par le colonisateur. Ce retour du commandement traditionnel dans le nouveau dispositif institutionnel de l’administration locale s’est cependant opéré au nom des principes qui desservent la démocratie. La chefferie traditionnelle: un sujet juridiquement non identifié L’arrêté colonial de 1933 portant statut des chefs indigènes et le décret n° 77/245 du 15 juillet 1977 distinguent bien le chef traditionnel en tant qu’autorité de la communauté dont il a la direction. Dans le premier cas, l’identification ne pose pas de problèmes juridiques particuliers. Le chef traditionnel est un agent de l’administration. Encore faut-il le classer dans la nomenclature plurielle des personnels administratifs. Mais la difficulté se pose davantage au niveau de la définition juridique de la chefferie entendue comme une collectivité humaine. Ses rapports tant avec le chef qu’avec l’État ne sont ni de ceux que l’on trouve dans le cas de la décentralisation administrative, ni de ceux qu’induirait un système de déconcentration administrative. Charles Nach Mback: La Chefferie traditionnelle au Cameroun… 79 Le problème de la nature juridique de la chefferie traditionnelle Ce que l’on appelle aujourd’hui chefferie traditionnelle est une survivance des formes multiples d’organisations sociopolitiques qu’a connues l’Afrique avant la colonisation. Cette dernière a inventé les expressions de chefferie traditionnelle et de chef traditionnel dans un effort d’uniformiser une réalité dont la complexité lui échappait (Crowder et Ikime 1970:ix et ss.). Ce legs de la colonisation a été bien entretenu par l’État africain indépendant. Dans certains cas, le problème de la chefferie traditionnelle a reçu une solution à la fois radicale et expéditive sous la forme de son éradication formelle (Bénin, Burkina Faso, Mali). Même dans ces cas-là, l’institution n’a pas pour autant cessé de représenter une référence pour une bonne frange de la population. Elle influence les institutions, les autorités politiques et administratives (Agondjo-Okawe 1985:33). Et comme le note Favrod (1985), «là où le village est resté au manioc et au mil, à la seule économie de subsistance, les structures traditionnelles ont conservé leur solidité… les chefs et les notables demeurent les maîtres» (cité par Gonidec 1985:56). Le citoyen africain d’aujourd’hui émarge simultanément à trois registres institutionnels différents et complémentaires: le registre traditionnel, le registre administratif moderne et le registre religieux (Elong Mbassi 1994:15). C’est pourquoi des États comme le Cameroun ont choisi de poursuivre l’effort d’intégration de la chefferie traditionnelle dans leur organisation administrative. Cependant, en reconduisant, sans réel bénéfice d’inventaire, la législation coloniale sur la question, la réforme camerounaise n’a pas fait preuve d’inventivité pour résoudre le problème de la cohabitation, dans un même pays, de structures administratives modernes et d’organisations sociopolitiques traditionnelles. La chefferie traditionnelle n’est finalement identifiable ni à une circonscription administrative déconcentrée, ni à une collectivité locale décentralisée. Africa Development, Vol. XXV, Nos. 3 & 4, 2000 80 Ni circonscription déconcentrée… Le décret de 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles dispose que «les collectivités traditionnelles sont organisées en chefferies» sur une base territoriale. Ce texte appelle quelques remarques sommaires: • la nouvelle législation est marquée à première vue par le réalisme. Elle se borne à constater l’existence des organisations sociopolitiques traditionnelles qu’elle cherche simplement à organiser. Les sociétés traditionnelles ont préexisté à l’État post-colonial. Ce sont parfois des institutions au passé pluriséculaire que le colonisateur a cherché à subjuguer, qu’il n’a pas pour autant réussi à gommer complètement même si dans bien des cas il a réussi à les émasculer (Mbembe 1988:133). L’arrêté de 1933 déjà se bornait lui aussi à organiser une sorte de hiérarchisation des chefs traditionnels en fonction de l’importance que revêtait leur communauté aux yeux du colonisateur (JOC 1950); • la notion de collectivité est une innovation du législateur post- colonial. Elle laisse entendre que le chef traditionnel dispose d’un domaine : la chefferie. Celle-ci est un groupement humain dont les membres sont liés les uns aux autres par des solidarités anthropologiques pour former une communauté historique. Par conséquent, la chefferie, au-delà du chef lui-même est une communauté d’hommes et de femmes qui ont en commun le rattachement à un territoire donné. Il s’agit donc simplement d’articuler au plan juridique ce territoire et ces hommes et femmes à l’ensemble étatique. Cet aspect de la chose n’avait pas retenu l’attention du législateur colonial. Ce dernier était allé directement à la définition des droits et surtout des devoirs du chef (indigène) lui-même. Cette approche se comprend en rapport avec l’unique rôle alors dévolu aux autorités traditionnelles: servir de courroie de transmission des volontés de l’administration coloniale aux populations locales; • cette notion de collectivité met en exergue la dimension territoriale de la chefferie pour mieux l’insérer dans les cadres de l’administration territoriale de l’État. Mais cette ambition pose Charles Nach Mback: La Chefferie traditionnelle au Cameroun… 81 une double difficulté de rationalité: d’abord, baser l’organisation des collectivités traditionnelles sur l’élément territorial, c’est donner à celui-ci une importance qu’il n’a pas toujours eu dans l’existence des sociétés africaines pré-coloniales. S’il est vrai que les sociétés politiques sont établies sur des terres d’accueil, rien n’indique, et surtout pas dans le cas des sociétés africaines, que le territoire soit le socle de leur existence. Elément fondamental du patrimoine collectif, la terre est source de vie pour les membres du groupe pour les ressources qu’elle offre (cultures, pâturage, mines, faune et flore, etc.). Pour autant, sa perte ou son amputation (guerres) ou son hostilité (sécheresse, désertification, inondation) n’a jamais en soi remis fondamentalement en cause l’existence du groupe. L’on a ainsi connu dans l’histoire des vagues migratoires au cours desquelles des peuples entiers ont occupé tour à tour diverses régions du continent. Les liens de sang et de vassalité l’ont très souvent emporté sur la fixation territoriale pour identifier les sociétés politiques africaines pré- coloniales (Nlep 1986:178). Baser la chefferie traditionnelle aujourd’hui sur la notion de territoire ne peut en l’espèce répondre qu’à des préoccupations propres à l’État post-colonial. Il s’agit pour ce dernier d’achever la maîtrise de son territoire en fixant définitivement les communautés traditionnelles sur les espaces qu’ils occupent au moment de la promulgation de la nouvelle législation. C’est une entreprise initiée par le colonisateur qui avait déjà le souci de réaliser un maillage administratif et sécuritaire pour une bonne exploitation économique et humaine de la colonie. Le deuxième aspect de la difficulté se rapporte à la relation entre la collectivité cheffale et les populations. Ce qui lie l’individu à sa communauté traditionnelle, c’est non pas sa présence sur, ou quelque lien qu’il
Documents similaires



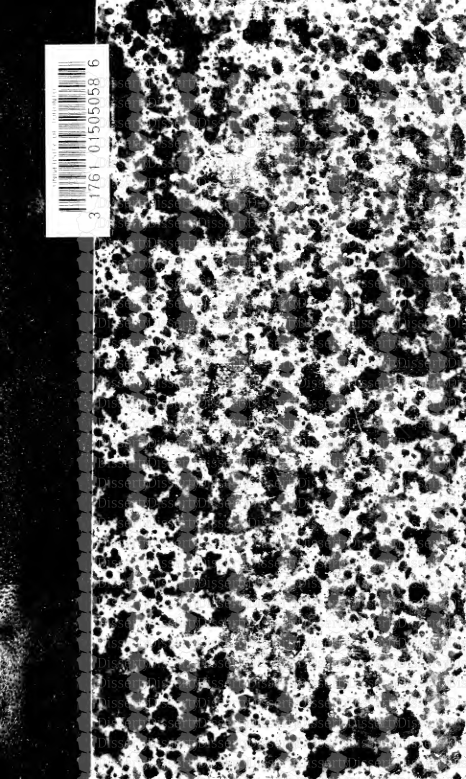






-
61
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 13, 2022
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 0.3509MB


