1 DIRECTION DE LA SÉCURITÉ CIVILE ORSEC DÉPARTEMENTAL Disposition Spécifique Pl
1 DIRECTION DE LA SÉCURITÉ CIVILE ORSEC DÉPARTEMENTAL Disposition Spécifique Plan Particulier d’Intervention P .P .I. ÉTABLISSEMENTS “SEVESO SEUIL HAUT” GUIDE TOME S.1.2 Octobre 2010 2 Remerciements La Direction de la Sécurité Civile (D.S.C.) est à l’initiative de cet ouvrage. Il a été réalisé en collaboration avec l’Institut des Risques Majeurs de Grenoble (I.R.Ma.). Chef de projet et rédacteur : Eric Philip (I.R.Ma.) et Pascal Belin (D.S.C.). Ont apporté leur contribution active à ce projet par leurs réflexions et leurs observations : Commandant Emmanuel Anat et Lieutenant-Colonel Dominique Bonjour (S.D.I.S. de Gironde), Lieutenant-Colonel Patrice Gerber (S.D.I.S. de Haute Garonne), François Fontaine (I.N.E.RIS.), François Giannoccaro (I.R.Ma.), Lieutenant-Colonel Nicolas Jal (S.D.I.S. de l’Isère), Lieutenant-Colonel Jean-Luc Queyla (S.D.I.S. du Vaucluse), et Lieutenant-Colonel Philippe Blanc, Catherine Guénon, Commandant Yannick Petit, Eric Philip, Lucien Quinquis, Capitaine Emmanuel Vial, membres de la sous-direction de la gestion des risques (D.S.C.). La Direction de la Sécurité Civile et l’Institut des Risques Majeurs de Grenoble remercient les personnes sollicitées pour la relecture de ce document. Reproduction à but non commercial autorisée 2ème édition Dépôt légal - août 2007 I.S.B.N. 978-2-11-097332-0 Le présent guide concerne uniquement l’élaboration des P.P.I. pour les catégories visées aux 2° & 3° de l’article 1 du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005. Ces deux catégories relèvent de la directive européenne Seveso mais aussi de la convention O.N.U.-C.E.E. d’Helsinki sur les effets transfrontières des accidents industriels. Les catégories 1°, 4°, 5° et 6°, visées dans l’article 1 du décret, sont traitées par ailleurs, dans d’autres ouvrages. La méthode développée dans ce document intéresse également les mêmes types d’installations que celles définies aux 2° et 3° de l’article 1 et faisant l’objet d’un P.P.I. décidé par le préfet en application de l’article 2 du décret (cf. paragraphe 10). AVERTISSEMENT 3 Extrait de l’article 1 du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 “Les caractéristiques des installations ou ouvrages présentant des risques pour lesquels un plan particulier d’intervention doit être défini sont : 1° Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, qu’elle soit ou non secrète, de type suivant : […] 2° Les installations classées définies par le décret prévu au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ; 3° Les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux,ou de produits chimiques à destination industrielle visés à l’article 3-1 du code minier ; 4° Les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel ; 5° Les ouvrages d’infrastructure liée au transport des matières dangereuses, définis par les décrets prévus à l’article L.551-2 du code de l’environnement . 6° Les établissements utilisant des micro-organismes hautement pathogènes dans le cadre d’une activité soumise aux conditions définies par le décret prévu à l’article L.5139-2 du code de la santé publique“. 4 A.R.S. Agence Régionale de Santé A.S. Installation Classée (I.C.) soumise à Autorisation préfectorale d’exploiter avec Servitude d’utilité publique C.A.D.A. Commission d’Accès aux Documents Administratifs C.I.R.E. Cellule Inter-Régionale d’Epidémiologie C.L.I.C. Comité Local d’Information et de Concertation C.M.I.C. Cellule Mobile d’Intervention Chimique C.O.D. Centre Opérationnel Départemental C.O.D.I.S. Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours C.O.S. Commandant des Opérations de Secours C.R.M. Centre de Regroupement des Moyens C.U.M.P. Cellule d’Urgence Médico-Psychologique D.D.P.P. Direction Départementale de la Protection des Populations D.D.T. Direction Départementale du Territoire D.R.E.A.L. Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement D.O.S. Directeur des Opérations de Secours D.S.C. Direction de la Sécurité Civile E.D.D. Etude De Dangers E.M.A. Ensemble Mobile d’Alerte ETA.RE. ETAblissement REpertorié (dispositions opérationnelles des S.D.I.S. pour les établissements à risques) GLOSSAIRE 5 I.C.P.E. -I.C. Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ancienne dénomination, désormais on parle d’Installation Classée) I.N.E.RIS. Institut National de l’Environnement industriel et des RISques I.N.V.S. Institut National de Veille Sanitaire I.S.O. International Standard Organisation O.R.SE.C. Organisation de la Réponse de SEcurite Civile P.C.A. Poste de Commandement Avancé P.C.O. Poste de Commandement Opérationnel P.C.S. Plan Communal de Sauvegarde P.O.I. Plan d’Opération Interne P.P.I. Plan Particulier d’Intervention P.P.A.M. Politique de Prévention des Accidents Majeurs P.P.M.S. Plan Particulier de Mise en Sûreté P.P.R.T. Plan de Prévention des Risques Technologiques P.S.S. Plan de Secours Spécialisé (ancienne dénomination, désormais on parle de disposition spécifique de l’ORSEC) S.A.M.U. Service d’Aide Médicale d’Urgence S.D.I.S. Service Départemental d’Incendie et de Secours S.G.S. Système de Gestion de la Sécurité S.I.D.P.C. Service Interministériel de Défense et de Protection Civile S.N.A. Signal National d’Alerte S.P.P.P.I. Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles 6 INTRODUCTION 8 A ÉLABORATION D’UN P .P .I., UN PROJET POUR UNE CULTURE PARTAGÉE 10 FICHE A-1 Technique de conduite du projet 13 FICHE A-2 Méthode d’élaboration 21 B DE L’ANALYSE DES RISQUES À LA STRATÉGIE DE PROTECTION DE LA POPULATION 26 FICHE B-1 Regroupement des phénomènes dangereux de l’étude des dangers 29 FICHE B-2 Identification des enjeux 43 FICHE B-3 Stratégies de protection des populations 49 SOMMAIRE 7 C ÉTABLISSEMENT DE LA RÉPONSE OPÉRATIONNELLE 54 FICHE C-1 Assurer le bouclage et la circulation 59 FICHE C-2 Alerter les acteurs et les populations 65 FICHE C-3 Protéger la population et lutter contre les effets 75 FICHE C-4 Informer et communiquer lors d’un événement 83 FICHE C-5 Préparer la phase post-accidentelle 89 D FORMALISATION ET APPROPRIATION DE LA RÉPONSE OPÉRATIONNELLE 96 FICHE D-1 Contenu du P .P .I. 99 FICHE D-2 Processus de consultation et d’adoption du P .P .I. 105 FICHE D-3 Déclinaison de leurs missions par les acteurs 111 FICHE D-4 Exercice, validation ou maintien du caractère opérationnel 113 FICHE D-5 Information et association du public dans la vie du P .P .I. 117 ANNEXES 122 8 Le présent document s’inscrit dans le cadre de la modernisation de la sécurité civile impulsée par la loi du 13 août 2004 et ses décrets d’application du 13 septembre 2005 sur la planification des secours. Ces textes ont introduit de nombreuses évolutions notamment dans le domaine de la planification avec la création du nouveau dispositif ORSEC, outil de base de la gestion d’événements de toute nature. Outre des dispositions générales, ORSEC comprend diverses dispositions spécifiques pour faire face à des risques identifiés. Les Plans Particuliers d’Intervention (P.P.I.) constituent la principale catégorie de ces dispositions spécifiques intégrées à ORSEC. Malgré les progrès réalisés dans l’analyse des risques, un accident tragique comme celui d’A.Z.F. nous rappelle que dans le monde complexe de l’industrie chimique et pétrolière, l’accident auquel nous pouvons nous retrouver confrontés peut ne pas avoir été envisagé dans les études. C’est pour cela, qu’au-delà de l’élaboration de l’outil P.P.I., la démarche proposée vise à développer une culture commune opérationnelle entre l’ensemble des acteurs concernés. L’objectif essentiel consiste à créer une véritable dynamique d’acteurs préparés à faire face à tout événement, même imprévu, lié à l’activité de l’établissement. Pour gérer un événement accidentel à caractère industriel, il est indispensable de se préparer, se former et s’entraîner. Chaque cas, spécifique de par l’activité de l’établissement et son environnement, nécessite un travail de fond pour planifier une réponse adaptée. Ces mesures seront d’autant plus efficaces qu’elles pourront être anticipées et s’appuyer sur un système d’alerte performant à destination des acteurs du plan (maires…) et des populations. INTRODUCTION 9 C’est sur la base de l’analyse des P.P.I. existants, des retours d’expériences des événements passés et des exercices qu’ont été rédigés un mémento et ce guide méthodologique. Ces deux documents complémentaires apportent à chaque partenaire du projet les informations indispensables à la réalisation d’un P.P.I. d’un établissement Seveso seuil haut. Le mémento est destiné à toute personne souhaitant avoir une vision synthétique du cadre dans lequel le dispositif P.P.I. s’inscrit. Après un rappel du contexte réglementaire, des axes de la politique de maîtrise des risques industriels majeurs, des données de base utiles pour l’élaboration du P.P.I., ce mémento précise les rôles et attributions des principaux responsables (exploitants, Directeur des Opérations de Secours -D.O.S., Commandant des Opérations de Secours -C.O.S.) lors de la gestion d’un événement. Il détaille ensuite les principes de la doctrine P.P.I. devant prévaloir pour la réalisation de cette disposition spécifique. Ce guide méthodologique doit, quant à lui, permettre à chaque acteur de trouver les réponses sur son rôle dans le projet d’élaboration et dans la gestion d’un accident industriel. Après une présentation d’une méthode de conduite du projet, il précise la technique permettant d’établir les différentes stratégies de protection des populations. Il détaille ensuite les modalités concrètes pour bâtir la réponse opérationnelle et sa formalisation. Enfin, il apporte des éléments en vue d’atteindre l’objectif principal du P.P.I. qu’est l’appropriation, par la population, du risque et des mesures individuelles pour y faire face. Le guide comporte des exemples, issus de P.P.I. existants, ayant pour but d’illustrer la méthode au travers de pratiques intéressantes. 10 A - ÉLABORATION D’UN P .P .I., UN PROJET POUR UNE CULTURE PARTAGÉE 11 La mise en place d’un P.P.I. nécessite un travail de fond collectif dont les objectifs sont de : ® bâtir un dispositif opérationnel visant à protéger la uploads/s1/ guide-ppi-etablissement-seveso-seuil-haut-pdf.pdf
Documents similaires

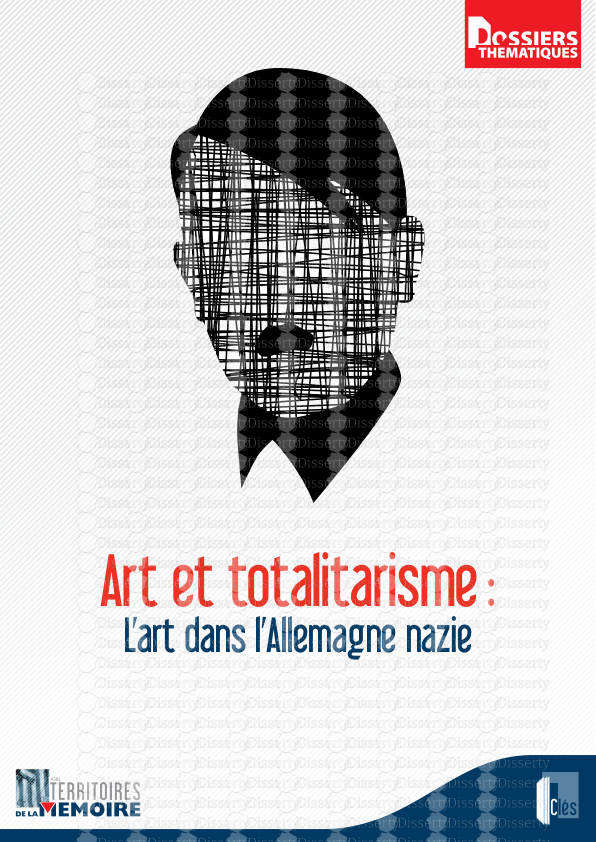








-
77
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 29, 2022
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 4.1773MB


