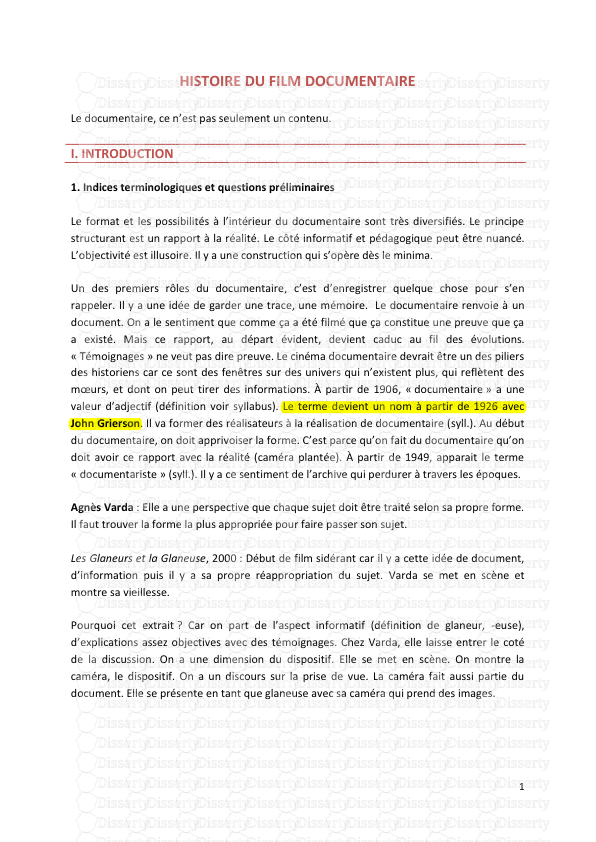1 HISTOIRE DU FILM DOCUMENTAIRE Le documentaire, ce n’est pas seulement un cont
1 HISTOIRE DU FILM DOCUMENTAIRE Le documentaire, ce n’est pas seulement un contenu. I. INTRODUCTION 1. Indices terminologiques et questions préliminaires Le format et les possibilités à l’intérieur du documentaire sont très diversifiés. Le principe structurant est un rapport à la réalité. Le côté informatif et pédagogique peut être nuancé. L’objectivité est illusoire. Il y a une construction qui s’opère dès le minima. Un des premiers rôles du documentaire, c’est d’enregistrer quelque chose pour s’en rappeler. Il y a une idée de garder une trace, une mémoire. Le documentaire renvoie à un document. On a le sentiment que comme ça a été filmé que ça constitue une preuve que ça a existé. Mais ce rapport, au départ évident, devient caduc au fil des évolutions. « Témoignages » ne veut pas dire preuve. Le cinéma documentaire devrait être un des piliers des historiens car ce sont des fenêtres sur des univers qui n’existent plus, qui reflètent des mœurs, et dont on peut tirer des informations. À partir de 1906, « documentaire » a une valeur d’adjectif (définition voir syllabus). Le terme devient un nom à partir de 1926 avec John Grierson. Il va former des réalisateurs à la réalisation de documentaire (syll.). Au début du documentaire, on doit apprivoiser la forme. C’est parce qu’on fait du documentaire qu’on doit avoir ce rapport avec la réalité (caméra plantée). À partir de 1949, apparait le terme « documentariste » (syll.). Il y a ce sentiment de l’archive qui perdurer à travers les époques. Agnès Varda : Elle a une perspective que chaque sujet doit être traité selon sa propre forme. Il faut trouver la forme la plus appropriée pour faire passer son sujet. Les Glaneurs et la Glaneuse, 2000 : Début de film sidérant car il y a cette idée de document, d’information puis il y a sa propre réappropriation du sujet. Varda se met en scène et montre sa vieillesse. Pourquoi cet extrait ? Car on part de l’aspect informatif (définition de glaneur, -euse), d’explications assez objectives avec des témoignages. Chez Varda, elle laisse entrer le coté de la discussion. On a une dimension du dispositif. Elle se met en scène. On montre la caméra, le dispositif. On a un discours sur la prise de vue. La caméra fait aussi partie du document. Elle se présente en tant que glaneuse avec sa caméra qui prend des images. 2 On va distinguer les films documentaires et les films de non-fiction (Angl. « non-fiction films »). 3 principes du documentaire : - Principe de réalité : Le documentaire est ce rapport à la réalité car c’est un point de vue sur la chose. C’est toujours une expérience vécue par le documentariste. Il y a un rapport par le regard et la captation. - Principe de vérité : Il y a un contrat entre le spectateur et le documentariste. Les personnes filmées sont des personnes qui existent dans la réalité. Au fil du temps, on va se rendre compte de ce côté de mise en scène. On peut manipuler le témoignage (mise en situation, répétition, etc.). - Objectivité/subjectivité : On réécrit les évènements, les situations avec le cadrage, le montage. Le documentaire est fragmentaire. Il montre le point de vue de quelqu’un sur quelque chose. On a un tout petit point de vue sur une réalité. Il y a une difficulté de catégoriser le documentaire. Il y a des 3 catégories : thématiques, statut des cinéastes et caractère formel des documentaires. Les catégories liminaires sont les catégories de l’entre-deux. Elles s’éloignent et forment des formes explicatives du documentaire. 2. Principes structurants – révélation, conjuration & temporalité Capter/capturer le réel mène au principe de révélation : C’est quelque chose qu’on serait passé à côté, « invisible à l’œil nu » si le documentariste n’avait pas posé le regard sur tel ou tel point de vue. Cette idée de révélation vient de la photographie d’un point de vue littéral. On amène à la surface une image qui apparait et qui est fixée. « Pour la première fois entre l’objet initial et sa représentation … » (syll.). On est dans l’idée de la reproduction de la réalité. On va capter la réalité et la représenter. On est dans une révélation de la réalité telle que la machine peut la voir. La caméra a une certaine autonomie de la captation. C’est un œil perfectionné qui voit des choses qu’on ne pourrait pas percevoir. De la fonction mémorielle : Est-ce que l’image remplace l’expérience vécue ? Ou non ? A qui va servir le documentaire pour la mémoire ? Il y a un rapport au temps. « La photographie ne remémore pas le passé … » (syll.). On retrouve l’idée de la preuve. Si on a la photo ou le film documentaire, c’est que ça a dû exister avant. 3 Conjurer la mort : Le documentaire renvoie à l’idée que filmer quelque chose c’est conjurer sa mort. Le rapport au temps – « Ce qui a été et ce qui demeure » : On a la représentation de quelque chose qui a existé et à côté, le film qui perdure. Dans le cinéma, on est dans le temps qui s’écoule, dans l’idée de propension du cinéma. On avance avec le film. Dans la photographie, on est figé sur un moment. « La passé lui-même, avec l’accélération continue du changement … » (syll.) : Ce qu’on est en train de voir à travers le documentaire c’est une réalité qui est en train de disparaitre dans le moment cinématographique et dans la réalité. Ce que nous regardons, ce qui nous regarde – lisibilité et conscience du dispositif : Le regard- caméra est une nécessité dans le documentaire. Les gens filmés vont nous regarder. Ils nous font face à travers les films réalisés. On casse l’illusion, les frontières sont brouillées. La personne filmée sait qu’elle est filmée. Il y a une conscience de la caméra. Il y a une prise de conscience aussi de la captation. Il n’y a pas cette transparence comme dans le cinéma de fiction où on ne peut pas voir la caméra. On peut imaginer une sorte d’interaction dans le film documentaire. « La vision est dépourvue d’opinion… » (Syll.) : Percevoir quelque chose à travers une forme de vérité ou de vrai. Raymond Depardon : L’idée que soit-on voit au travers d’une fenêtre avec cette perception unidirectionnelle. Ou alors on a l’idée de miroir où il y a une sorte de réciprocité. 3. Chronologie – origines du film documentaire dans le cinéma primitif La photographie n’est pas seulement l’ancêtre très proche du documentaire mais elle soutient aussi les principes esthétiques et narratifs qui vont se développer dans le documentaire. La révélation photographique est le principe qui les unit. Qu’est-ce qui est révélé au spectateur ? Ce qui intéresse principalement, ce sont les thématiques photographiques. Quand la photographie se démocratise, des thématiques se développent. On retrouve la même chose dans le documentaire : - L’inventaire de la planète : On prouve que les choses existent. Il y a un côté colonisateur. On montre ce qui existe ailleurs. - Le portrait : Idée de portraitiser les gens. Certains cinéastes refusent cette idée et vont sur des représentations plus globale et montrer une société collective. 4 - Les recherches esthétiques (1860-1890) : Ça va être des recherches de forme. On veut faire passer un regard sur un objet, une situation, une personne et marquera la spécificité de cette vision. - Le portrait social (Neue Sachlichkeit en Allemagne et Straight Photography aux USA) : On veut faire bouger les choses en montrant cette information. - Le reportage (1930-1960) Exemples pour montrer ce prolongement de thématique photographique et documentaire : Paysages – Vue des pyramides (1900) Paris, photographie touristique (1900) : Cadre particulier, on montre l’échelle entre les gens et la Tour Eiffel. Portrait – Virginia Woolf par Julia Margaret Cameron (1815-1879) Portrait : Frontalité. Interaction // Documentaire Auguste Sander (1876-1964) : Frontalité sur pied. Il montre tous les métiers de la société et veut qu’ils soient reconnus (tenue, ustensiles, en action). On est dans le geste arrêté. On montre ce qu’il est dans le contexte et dans la pose. Photographie sociale – Lewis Hine (1874-1940) : Il s’est intéressé aux visages de la société qu’on ne voit pas. Valeur collective. Ironie de la pause déjeunée. Power House Mechanic Working on Steam Pump (1920) : On est dans un mouvement arrêté. Ouvrier dans un contexte particulier. Organisation dans l’arrondi. Composition artistique et réfléchie. Mill Girl (1920) – National Child Labor Commitee : On veut montrer les conditions de travail des enfants et prouver leur dur labeur. On voit des enfants dans des environnements de travail. Ils sont généralement en position frontale devant les machines. Composition travaillée (perspective, …). Elle nous prend à témoin de la situation. 5 Avant-garde – Germaine Krull, La Tour Eiffel (1927) : On est dans une recherche plastique. C’est une captation de la réalité mais avec un point de vue différent. Ici il n’y a pas de reconnaissance du uploads/s1/ histoire-documentaire.pdf
Documents similaires










-
23
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 21, 2022
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 0.5896MB