» • • ••.*\ •.:^'^-' ...V .'•• • • • • ^ • . • • > ^ ^:.^^>^i # «g « • • • • »
» • • ••.*\ •.:^'^-' ...V .'•• • • • • ^ • . • • > ^ ^:.^^>^i # «g « • • • • » » • 9 O « 4 . 1^ • • • ••• • . .* • . Ji.:'' > • •' • • • • ^ HISTOIRE COMPAREE DES SYSTEMES DE PHILOSOPHIE. CET OUVRAGE SE TROUVE AUSSI ( PASCHOU , à Genève , ponr toute la Suisse. Chez { DE MAT ^ à Bruxelles. i LE ROUX,àMon8. Ouvrages nouveaux chez les mêmes : Choix de Rapports , Opinions et Discours prononcés à la tri- bune nationale depuis 1789 jusqu'à ce jour , 20 volumes in-S". Prix 160 fr. , vélin le double ; Ja table générale 5 fr. Histoire dd Jury , par M. Aignan , de l'académie française , I vol. in-8". Prix 6 fr. OEuVRES COMPLÈTES de madame la comte$se de Souza , ci- «levant de Flahault, auteur d'Adèle de Sencyige , 6 vol. in-8» , avec gravures, pri_x 36 fr. ; 12 vol. in-12 3o fr. , vélin le double. OEdvres complètes de don Barthélemi de Las Casas, évéque de Chiapa, défenseur de la liberté des naturels de l'Amérique, précédées de sa vie, par M. G.- A. Llorentc , a vol. in-8". Prix i3 fr. 5o cent. .,' CËuvRKs coMPLÈ-çES de M. Je coat]L0ue S«%ur , de l'acadëu^e française. — Histoire ancienne , 9 voL în-i8. Prix i8-ft. romaine, 7 vol. id. i4 du Bas -Empire , 9 vol. id. j8 Les mêmes ouvrages imprimés en 10 vol. in-80 , et Atlas par P. Tardieu 70 — Histoiie de France , i'* époque, 5 vol. in-18. 10 Galerie morale et politique, 3 vol. in-80. 18 Politique de tous les cabinets de l'Europe , 4® edit. , refondue, 3 vol. in-S". ai Romances et chansons , i vol. in-18. -' Tableau historique et politique de l'Europe , 4® édit. , refondue , 3 vol. in-8<'. ai Voyagedr MODERNE, OU extrait des voyages les plus récens dans les quatre parties du monde , publiés en plusieurs langues jusqu'en 1822, 6 vol. in-80 ^ avec 36 belles gra- vures de costumes. Prix ^^' Coloriées -4^ Le même, la vol. in-i 2 , avec gravures 3o idem. fig. coloriées 4° IMPRIMKRIIO DE C0SSO^. i355K HISTOIRE COMPAREE DES SYSTÈMES DE PHILOSOPHIE, CONSIDÉRÉS hÉLATIVEMENT AUX PRINCIPES DES CONNAISSANCES HUMAINES ; PAR M. DEGERANDO, MEMBRE DE l'iNSTITLT DE FRA>CE. DEUXIÈME ÉDITION , REVUK, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE. TOME IL PARIS, ALEXIS EYMERY, LIBRAIRE, RUE MAZARINE . N> 3o. HEY ET GRAVIER, QUAI DliS AUGUSTINS , N» 57. AILLAIT, QUAI VOLTAIRE, N-ai. 1822. 9~ S^ HISTOIRE COMPARÉE DES SYSTÈMES DE PHILOSOPHIE. SUITE DE LA PREMIÈRE PARTIE. CHAPITRE VII. Seconde école d'Élée. SOJMMAIRE. •^.« * "... PttiiRQUoi l'exemple J'Hipi^wcrate e«{ resté à peu près infruc- tueux pour ravancement des sciences physiques dans Tantiquité. Eléatiqiies physiciens : Empédocle; — Sa doctrine pa- raît ^''tre un syncrétisme des systèmes déjà connus ; — En- thousiasme , formes poétiques ; — Théorie singulière sur le* sensations. Leucippe ; — Origine de l'hypothèso des atomes ; — Im portance qu'elle a acquise dans l'histoire delà philosophie; — Sous quel point de vue nous devons ici la considérer; Leucippe est choqué des corollaires auxquels les Eléatiques avaient été conduits ; — Distinction qu'il établit entre lej divers ordres de perceptions ; .— Il rapporte tous les phénp- , mènes à l'étendue , au mouvement , à l'espace ; — Exposi- tion du système de» atomes ; — Comment Leucipp« croit II. 1 (M aroir réconcilié la raison avec l'expérience ; — Applications peu heureuses ;— Sa psycologie imparfaite j matërialisrae. Démocrite j nouveau développement de la distinction introduite entre les divers ordres de perceptions ; — Valeur subjective des perceptions sensibles ; — L'in- telligence réduite à une condition passive;— Hypothèse des images détachées des objets et qui parviennent à l'àme ; Diversité et contradiction apparente des témoignages des anciens sur l'opinion de Démocrite relativement au prin- cipe de la connaissance ; — Explication proposée ; — Sin- gulières idées de ce philosophe sur la divination ; — Ex- plication proposée; —Maximes de Démocrite sur le destin et la nécessité ; — Sa philosophie morale. Métrodore de Chios ; son scepticisme. Parallèle des deux écoles d'Elée ; —Résultats communs ; — Parallèle des Eléatiques et de« Ioniens ; — Des Eléati-" ques et des Pythagoriciens. JLj*EXEMPLE donne par Hippocrate eût pu exercer sur la marcîie des sciences dans l'anti- quité une influence semblable à celle que Galilée a obtenue dans les temps modernes. Mais , les esprits n'étaient point préparés pour une révolution de ce genre ; ils étaient engagés dans un ordre de recherches trop éloigné des voies que leur montrait Hippocrate. Le goût naturel des Grecs pour les idées spéculatives et les déductions subtiles contribuait encore à les détourner de cette route prudente. D'ail- leurs, si le père de la médecine avait enseigne (3) )a melliocïe qui cOQipare les observailons, 1 arl d'expérimenler élait demeure dans Tenfance , il devait y rester par la suite du mépris qu'avaient les anciens pour tous les arts mécaniques ; ainsi, on n'était pas en mesure d'étendre avec succès l'exemple donné par Hippocrate , aux sciences qui ont besoin non- seulement d'obser- ver, mais d'interroger la nature; on ne pou- vait ap[)récier tous les secours que prête l'expé- rience raisonnée et induciive pour s'élever dans la région des découvertes Ces réflexions se confirment, lorsqu'on re- marque comment procédèrent les Eléatiques appelés physiciens, et les résultats auxquels ils arrivèrent. En effet, quoiqu'ils se fussent adon- nés, par réflexion et par choix, à l'étude de la nature, ils furent loin d'obtenir les succès qu'elle pouvait promettre, et ne firent souvent que substituer des conceptions aussi arbitraires à celles que les Eléatiques métaphysiciens avaient imaginées dans l'ordre des spéculations ration- nelles. C'est que , toujours empressés à s'ériger en architectes de la nature , à construire au lieu d'observer , ils voulaient aussi commencer par saisir les premiers élémens des choses, comme si ces élémens primitifs n'étaient pas précisément ce qui est le plus éloigné de nous; seulement. (4) ils puisaient ces élémens à une antre source que leurs prédécesseurs. On np peut même reconnaître à Empédocle le mérite d'avoir présenté sous ce rapport des vues bien nouvelles. Quelle que soit l'idée que ses apologistes aient voulu nous donner des connaissances qu'il avait acquises par l'étude de la nature, c'est en vain qu'on cherche dans sa doctrine quelque découverte qui ait fait faire un pas réel à la science ; on n'y aperçoit guère qu'un mélange visible et une combinaison des idées de ses prédécesseurs. Il admit à la fois les trois élémens des Ioniens, l'air, l'eau , le feu, et leur joignit la terre. ((Les parcelles primitives de ces quatre élémens, indivisibles, inaltérables, éternelles , dérivent dé l'unité , c'est-à-dire y sont d'abord renfermées et confondues , et s'en séparent ensuite ; ainsi sa monade est une sorte de chaos. » iL^amour et la discorde sont les deux forces qui président à l'aggrégation ou à la dissolution; c'est-à-dire que l'attraction et la répulsion sont à ses yeux les deux lois générales de la ftalure ; elles re- présentent même en quelque sorte les deux principes des Orientaux ; car l'amour est la source du bien , comme la discorde celle du mal. Au reste, la suite des transformations n'est (5) «oumise qu'à des causes mëcauiques , l'intelli- gence n'y a aucune part ; un hasard aveugle préside seul à toutes ces combinaisons (i). » Ce n'est pas qu'Empédocle n'admît l'idée de la divinité , comme principe intelligent ; mais il est difficile de découvrir quel rang, quelle action il attribuait à ce princij)e dans l'univers. Suivant Scxtus l'Empirique, il recon- naissait une intelligence divine qui se répand dans le monde entier , dont tous les êtres em- pruntent la vie, dont l'âme humaine et celle même des animaux seraient des parties ou des émanations (2). Lorsqu'il confère d'ailleurs le nom de dieux à ses quatre élémens , on ne doit reconnaître dans ces expressions que les images propres à la langue poétique dont il faisait usage. Suivant les détails que Philostrate, Dio- gène Laërce , Porphyre, Jamblique, Suidas, ont recueillis sur sa vie, le philosophe d'Agri- gente paraîtrait avoir été livré à un enthousiasme habituel, et ses disciples en auraient fait une sorte de thaumaturge 5 Plutarque nous dit (1) Aristole, Physicé 11,4- — Melaphys.yî, Z^; III , 4- De gênerai, et corrupt. I , i. — Plutarque , De Placit. phil. 1,8. — Sextus l'Emp. Jidv. Math.^ IX , 10 , etc. (a) Àdvvrsus Maih. , I , § 3oa , 3o3 ; IX , § 127. (6) qtiHl peu[)lall Tvinivers tle génies actifs, intcîli-' ^ens, nous décrit l'inlervfintion qu'il leur attii-»- Luait , les vicissitudes qu'il leur faisait subir. Oa est surpris du contraste qui s'offre entre l'exalta- tion qui domine sop esprit, elles idées qu'il s'était formées sur les lois de la nature. Ce contraste , uploads/s1/histoirecompar02gr-pdf.pdf
Documents similaires








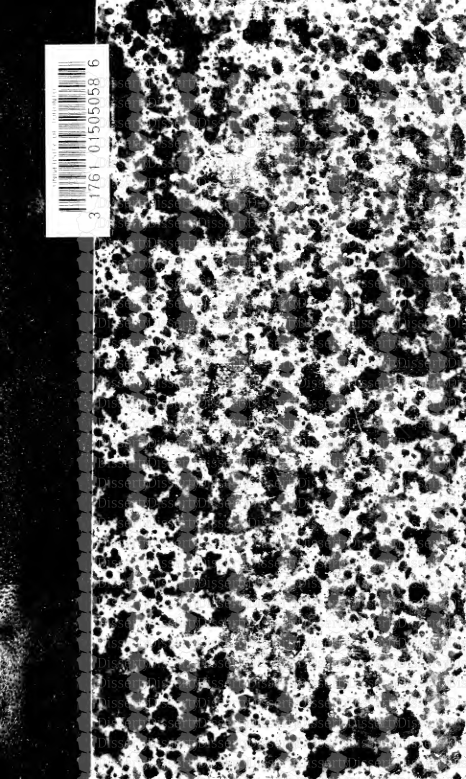

-
86
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 05, 2021
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 20.3425MB


