See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://ww
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/341966822 L'homme et la femme-chemin Conference Paper · June 2020 CITATIONS 0 READS 50 2 authors: Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Coopération scientifique et Développement View project Société lobi View project Jacques Lombard Institute of Research for Development 189 PUBLICATIONS 95 CITATIONS SEE PROFILE Michèle Fiéloux French National Centre for Scientific Research 106 PUBLICATIONS 114 CITATIONS SEE PROFILE All content following this page was uploaded by Jacques Lombard on 06 June 2020. The user has requested enhancement of the downloaded file. 1 L’homme et la femme-chemin L'homme et la femme-chemin Septembre 2001, une exposition internationale d'art contemporain intitulée "Les autels du Monde; De l'art pour s'agenouiller" réunit en Allemagne à Dusseldorf plus de soixante autels appartenant à des univers religieux différents. Un devin et guérisseur lobi originaire du Burkina Faso est invité à cette occasion pour reconstruire son propre autel domestique. Aux termes de ce voyage qui l'a conduit pour la première fois en Europe il entreprend, de retour chez lui , de "fabriquer" une trace de cet épisode, pétrissant en banco une double sculpture, l'homme et la femme-chemin, qui sont à la fois des figures d'un ancêtre et des expressions de sa trajectoire personnelle. On cherchera à décoder, en associant le texte et l'image, le langage non verbal et essentiellement plastique que ce devin utilise pour interprêter et raconter des évènements importants de son histoire propre. Mots clefs: voyage, art contemporain, langage plastique, histoire de vie, lobi (Burkina Faso). Le voyage que nous allons évoquer ici est un voyage virtuel, imaginaire né de la rencontre de plusieurs voyages , biens réels cette fois et qui noués, imbriqués les uns avec les autres, comme on va le voir, vont peut être nous permettre de tirer la morale d’une même histoire. Le premier vrai voyage est celui de Sib Tadjalté, un devin-guérisseur lobi d’une soixantaine d’années originaire du Burkina faso qui quitte son village pour venir à Düsseldorf participer à une exposition internationale d’art contemporain dans l’une des villes les plus importantes pour ce marché mondial particulier qui occupe une place non négligeable dans la globalisation planétaire des échanges. Le second est le « voyage » d’un autel qui sera reconstitué par Sib lui-même grâce à des copies d’un certain nonbre de ses éléments constitutifs préalablement effectuées chez lui au Burkina Faso. Tout sera importé par container de ce pays jusqu’en Allemagne, les sculptures en bois ou en banco, les poteries, les pièces métalliques, la terre…. Le troisième voyage est une sorte d’anamnèse faite par Sib à l’occasion de la construction de cet autel-objet d’art qui l’amène à remonter jusqu’à l’événement fondateur de son alliance avec une puissance du monde invisible ou thil découverte dans son adolescence. Ce voyage est donc aussi un voyage dans l’histoire de vie de Sib que l’on peut lire autant que 2 possible en décodant le langage plastique utilisé dans l’assemblage complexe d’objets les plus divers constituant l’autel original dont il va exposer cette copie-objet d’art. Mais c’est aussi, par la médiation de son ancêtre utérin Manko, figure omniprésente dans tous ses autels, un voyage dans l’histoire de son pays, l’histoire des lobi qui ont traversé la Volta Noire dans la deuxième moitié du XVIII siècle pour s’installer dans la région du Sud- Ouest du Burkina Faso et du Nord-Est de la Côte d’Ivoire où ils vivent maintenant. Enfin, il reste notre propre voyage, que nous avons effectué en deux temps, d’abord à Düsseldorf pour rejoindre Sib et suivre la re-construction de son autel et ensuite chez lui en pays lobi pour découvrir le modèle mais aussi tous les autres autels de sa maison. Tous ces voyages accompagnent ce voyage singulier où Sib, pétrissant des figures, se pétrit lui-même, raconte des moments de sa vie, ses relations aux autres, ce qu’il en ressent et ce qu’il en comprend. Ainsi, l’homme et la femme-chemin, sculptures en terre, façonnées par Sib au retour de Düsseldorf apparaissent comme une étape du pétrissage jamais achevé de son être. Ainsi, depuis son adolescence, Sib élabore des autels qui sont également autant d’enseignes de ses qualifications sociales progressivement acquises invitant de cette manière les patients à le consulter. Pour ceux-là, ces autels témoignent justement d’une compétence et d’une légitimité. En un sens, ils sont lisibles bien qu’ils soient nés de la seule imagination de Sib tout en répondant aux règles de l’art en la matière, à ce qui est attendu et nécessaire pour la communication sociale, une conviction partagée dans la reconnaissance de la force de l’objet. Pourquoi Sib Tadjalté a-t-il accepté cette proposition de voyage et d’exposition, faisant de lui un précurseur dans le domaine de ce que l’on pourrait appeler la « spectacularisation du religieux » hors des frontières du pays lobi ? Comment Sib a-t-il pensé la « reproduction » d’un autel actif, qui engage ses relations avec des puissances surnaturelles et donc son identité sociale? Que revèlent tous ces voyages intriqués, personnes mais aussi objets, sur la représentation du religieux mais aussi sur les stratégies de chacun des protagonistes ? Septembre 2001, le Musée d’art moderne de Düsseldorf est inauguré avec une exposition internationale intitulée « Les autels du monde. De l’art pour s’agenouiller ». Selon son commissaire, J.H. Martin, cette exposition « veut dépasser les clivages qui ont dominé le siècle passé entre art et ethnographie (…) ». Il s’agit de transformer des ensembles très complexes en œuvres d’art qui s’imposent par elles-mêmes et donc sans y adjoindre des 3 données ethnographiques complémentaires. Plus de soixante autels provenant de différentes régions du monde ont ainsi été reconstitués: autel d’un shaman coréen, autels bouddhiste ou hindouiste, autels vodu, autels consacrés à des cultes lignagers et autels chrétiens. Des autels dits laïcs concernant des célébrités de la chanson ou des rituels franc-maçonniques ont également été représentés. C’est ainsi que Sib Tadjalté fut invité à reconstituer son propre autel domestique, retenu, comme beaucoup d’autres, selon des critères d’ordre plastique et esthétique en accord avec les positions qui sont au fondement de cette exposition. Ce voyage présentait bien des aspects inédits. Contrairement à de nombreux Lobi de sa génération, Sib n’avait pratiquement pas quitté son village natal avant de venir en Allemagne, pays dont il ignorait tout y compris sa localisation géographique. Ce voyage fut donc riche de découvertes marquantes de toutes sortes : la capitale Ouagadougou, l’aéroport où les douaniers voulurent lui confisquer un talisman métallique, le vol au dessus de la mer, l’hôtel luxueux, ses petits déjeuners mirobolants et ses ascenseurs, le Rhin et ses péniches, l’autoroute, les tunnels, la nourriture, les chiens tenus en laisse… Et puis la découverte des autres autels présentés témoignant de la grande variété des croyances religieuses et offrant tout à la fois un aperçu concret des différences entre pratiques rituelles et une vision de l’originalité de son propre autel. De plus, pour la première fois et selon le souhait des organisateurs, un autel lobi allait être dévoilé dans son intégralité et non de manière morcelée à travers des sculptures en bois ou en fer dispersées dans les Musées et les Galeries d’Art. Il s’agissait donc pour Sib de reproduire hors de son contexte social un lieu cultuel façonné depuis plus de 30 ans et utilisé quasi-quotidiennement comme un espace de dialogue avec des puissances surnaturelles ou thila présentes par la médiation de différents supports. La reconstruction d’un autel est en effet une pratique courante à l’occasion des déplacements de groupes familiaux qui existent depuis plus de deux siècles sur le territoire lobi du Sud-Ouest du Burkina Faso et du Nord-Est ivoirien. Certains objets, détenant une valeur emblématique pour signaler la relation aux ancêtres et au monde surnaturel, pierre, morceau de fer par exemple, autorisent la reconstitution de l’ancien lieu cultuel dans une autre résidence. Le nouvel autel, fabriqué à partir d’une fraction de l’ancien associée à de nouveaux objets, est donc le produit d’une transformation du précédent qui sera, pour sa part, abandonné sur place. Cette procédure classique explique l’opposition établie par le détenteur d’un autel parmi les différents objets constitutifs entre l’élément reproductible sans déperdition de sens et celui qui doit toujours conserver sa forme et sa matière d’origine. Toutefois, la reconstruction exceptionnelle d’un 4 autel destiné à une exposition temporaire dans un Musée occidental suscite des interrogations inédites puisqu’il ne s’agit pas de transplanter des puissances dans un nouvel habitacle mais au contraire d’aller dans le sens d’une dé-contextualisation, d’une neutralisation d’un lieu de culte conçu en la circonstance comme une œuvre éphémère dissociée de tout lien, religieux et social, avec le véritable autel. D’autre part, la reconstruction muséographique supposait d’ouvrir au public un tel lieu cultuel qui, en principe, appartient à l’espace le plus privé de la maison, une petite pièce, généralement attenante à la chambre de la première épouse, basse de plafond, isolée par une porte très étroite, fermée par un rideau de cauris ou une peau de bœuf. Seul son desservant, certains de ses proches et éventuellement des consultants uploads/s3/ 2005-fieloux-lombard-lhommeetlafemme-bordeaux.pdf
Documents similaires



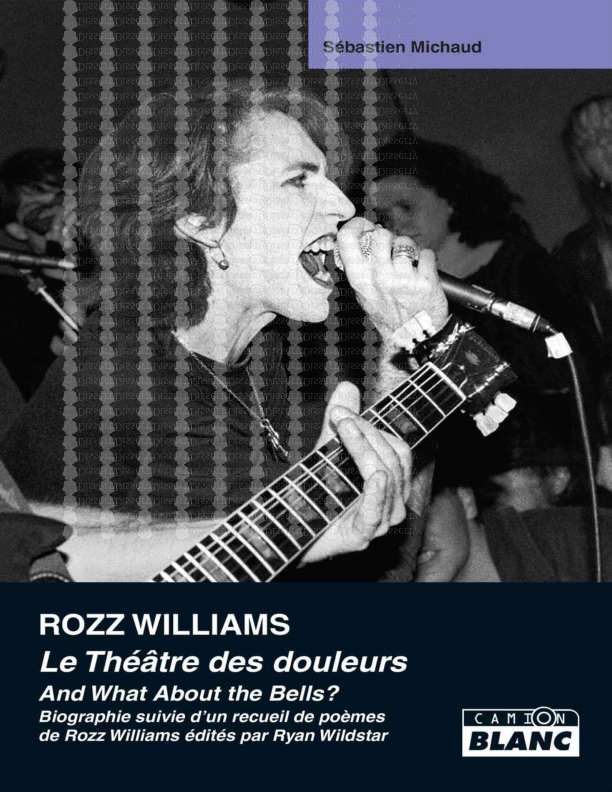






-
56
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 23, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2468MB


