Module I : le monde vivant Généralités : le monde vivant regorge une multitude
Module I : le monde vivant Généralités : le monde vivant regorge une multitude d’êtres vivants que l’on peut regrouper en espèce, genre, famille, classe et embranchement en fonction des caractères de ressemblance et de différence. A la faveur de l’accouplement, les êtres vivants existants donnent naissance aux nouveaux êtres vivants originaux témoignant ainsi de la complexité des mécanismes qui régissent la reproduction. Chap.1 : Éradication des préjugés autour de l’apparition des anomalies et/ou de nouveaux caractères au sein des familles Situation –problème d’entré dans le chap. : Anita est une jeune mariée. Au mois de juin dernier, elle a donné naissance à un garçon nommé « bébé André » après 09 mois de grossesse. La nouvelle de son accouchement s’est répandue comme une trainée de poudre dans sa famille, ce qui a fait l’objet de plusieurs visites dont celle de son frère ainé nommé « Martin ». Quelques temps forts de la conversation entre Martin et Anita sont relevés ci-dessous : - Martin : « bébé André a le nez de notre père, papa Françis » ; - Anita : « moi je constate plutôt qu’il pris les yeux de jean, son père. » ; - Martin : « son teint est aussi clair que le vôtre ! mais comment es-ce possible ? » ; - Anita : « j’espère juste qu’il conservera ce teint même à l’âge adulte ? » ; - Martin : « je pense qu’une bonne alimentation et une bonne hygiène corporelle suffirons à conserver son teint ? » ; - Anita : « les examens faits par son pédiatre révèlent que bébé André est en bonne santé. Cette nouvelle me réjouis. » Problèmes soulevés : - Ressemblances et différences entre les individus ; - Origine et nature des caractères héréditaires ; - Transmission et expression des caractères héréditaires. Recherche des solutions : - Les caractères héréditaires reposent sur une information contenus dans nos cellules sexuelles ; - Des modifications apparaissent lors de la transmission des caractères héréditaires ; - L’expression des caractères héréditaires se fait sous l’influence du milieu. Compétence à développer : Éradiquer les préjugés autour de l’apparition des anomalies et/ou de nouveaux caractères au sein des familles. Lecon.1 : Ressemblances et différences au sein de l’espèce humaine Situation –problème d’entré dans la leçon : Ivan et Roméo sont deux frères. Ce matin, pendant qu’ils s’apprêtaient à aller à l’école, Ivan regardant dans le miroir s’exclame : « Roméo, à te voir dans le miroir, on dirait papa ». Roméo : « Ivan, à te voir dans le miroir, on dirait maman. ». La maman suivant discrètement la conversation rétorqua à ses 02 enfants : « vous ressemblez aussi à moi qu’à papa. Il est temps d’aller à l’école maintenant ». Problèmes soulevés : ressemblances et différences entre les individus de l’espèce humaine. Recherche des solutions : transmission partielle de l’information génétique des parents aux enfants. Introduction : Les enfants ressemblent plus ou moins à leurs parents ou à un aïeul (atavisme). Il s’agit parfois des caractères mal définis tel qu’un geste, une manière de sourire, de marcher,… Mais aussi, ce sont des caractères très précis tels que la couleur des yeux, la forme du menton, le groupe sanguin,…Inversement, dans une famille, les enfants sont souvent très différents les uns des autres du point de vue de certains caractères, pourtant ils sont tous issus des mêmes parents. Objectifs/actions à mener : Relever les caractères ou traits de ressemblances et de différence entre les individus de l’espèce humaine Compétence à développer : lutter contre les accusations gratuites d’infidélité et de sorcellerie. I- Ressemblances entre les individus : les caractères de l’espèce humaine Les individus appartenant à une même espèce présentent de nombreux caractères de ressemblance. Parmi ces caractères, certains sont visibles et d’autres invisibles ou discrets. Dans l’espèce humaine par exemple, on peut citer comme caractères visibles: - la taille : grand, petit, … - la couleur des yeux : noirs, bleus, gris, - le teint : noir, brun, … - la forme du pouce : droit ou recourbé ; - la forme du lobe de l’oreille (libre ou adhérent) ; - la capacité ou non à enrouler la langue Comme caractères invisibles : - les groupes sanguins : A, B, AB ou O ; - le facteur rhésus (Rh+ ou Rh-) ; - les protéines plasmatiques. II- Différences entre les individus : caractères héréditaires et caractères modifiés par l’environnement Les caractères présentés par les individus d’une espèce sont transmis à travers les générations. Mais peuvent subir l’influence des facteurs du milieu : c’est la sélection naturelle. Raison pour laquelle, les enfants nés des mêmes parents ont parfois des caractères qui diffèrent les uns des autres. Toutes ces ressemblances et différences paraissent complexes. L’hérédité est la transmission des caractères des parents aux descendants. La science qui étudie l’hérédité est la génétique. Un caractère est tout aspect visible d’un être vivant. Lecon.2 : Localisation et nature de l’information génétique déterminant les caractères héréditaires Objectifs/actions à mener : localiser l’information génétique dans la cellule Introduction : Chaque être vivant, dans le cas de la reproduction sexuée, est issue d’une cellule œuf, fruit de l’union des gamètes mâle et femelle (fécondation). Cette cellule porterait donc en elle ‘’presque tous les caractères de cet être’’. I- Localisation de l’information génétique : résultats d’expériences de transfert de noyaux 1- Dispositif expérimental. Le protocole suivant résume les grandes étapes de l’expérience de clonage couramment pratiqué en élevage. Figure 1 : Expérience de clonage chez les mammifères. - prélèvement sur une vache ‘’donneuse d’ovule’’ ou « vache pondeuse » d’un ovule non fécondé et on en retire le noyau ; - prélèvement sur une vache ‘’donneuse d’embryons’’ ou « vache donneuse » d’un embryon au début de son développement (stade 32 cellules) ; - isolement des différentes cellules de l’embryon ; - greffe du noyau de l’une des cellules de l’embryon dans l’ovule énucléé ; - réimplantation du nouvel embryon dans l’utérus d’une vache ‘’porteuse’’. 2- Résultat : Après réimplantation, on obtient pour chaque embryon, un veau présentant les caractéristiques génétiques de la vache ‘’donneuse d’embryons’’. Compléter le tableau suivant si l’élevage a pour objectif la production de lait. Vache pondeuse Vache donneuse Vache porteuse Caractéristiques rôle Interpréter le résultat obtenu. Cette expérience prouve que le noyau est le siège du programme génétique. Ce programme génétique dirige la mise en place des caractères spécifiques et individuels. L’ensemble des caractères que manifeste un individu constitue son phénotype. On peut les envisager à l’échelle de l’organisme ou des cellules. NB : Un clone est un ensemble d’individus génétiquement identiques issus d’une même cellule souche. Le clonage n’est possible que si les noyaux des cellules embryonnaires contiennent le même programme génétique. II- Nature de l’information génétique 1- Notion de chromosomes Sur une préparation microscopique, les cellules en cours de division se distinguent des autres cellules (dites quiescentes ou au repos ou en interphase) par la présence des filaments individualisées, les chromosomes. Les chromosomes sont donc des structures permanentes de la cellule, visibles seulement au cours de la division cellulaire (ou mitose). Dans les cellules en interphase, les chromosomes ne sont pas visibles. Dans chaque cellule, les chromosomes homologues peuvent être regroupés par paires. Le nombre pair de chromosomes est noté 2n (c'est-à- dire 2 fois n), n’étant le nombre de paires de chromosomes. 2- Constitution d’un chromosome : notion d’ADN Chaque chromatide est constituée d’une molécule d’ADN (Acide Désoxyribonucléique). Si l’on déroulait les molécules d’ADN des 46 chromosomes d’une seule cellule humaine, on obtiendrait un filament d’une longueur de 2 mètres ! C’est donc une grosse molécule ou macromolécule. Chaque molécule d’ADN porte une information codée, déterminée par sa composition chimique. 3- chromosomes de l’espèce humaine a) caractéristiques des caryotypes de l’espèce humaine. - Caryotype des cellules diploïdes : une cellule diploïde est une cellule qui comporte deux lots de chromosomes homologues c'est-à-dire 2n chromosomes. Le nombre et la forme des chromosomes d’une cellule constituent son caryotype. Ce dernier est caractéristique de l’espèce (ne change pas d’une génération à l’autre). Exemple : 2n = 46 chez l’homme ; 40 chez la souris ; 78 chez le chien ; 20 chez le maïs ; … Le caryotype d’une cellule d’origine mâle est différent de celui d’une cellule d’origine femelle au niveau de la 23ème paire de chromosomes. C’est cette paire de chromosomes qui est responsable de la détermination du sexe de l’individu : ce sont les chromosomes sexuels ou gonosomes. Cette 23ème paire est formée de deux chromosomes morphologiquement semblables et désignés chacun par la lettre X chez les individus de sexe féminin. Chez l’individu de sexe masculin, les deux chromosomes de la 23 ème paire sont différents : l’un semblable au chromosome X de la femme désigné par la lettre X ; l’autre, plus petit, désigné par Y. Les 22 autres paires de chromosomes sont morphologiquement semblables dans les deux sexes : ce sont les chromosomes somatiques ou autosomes. Dans l’espèce humaine, le nombre de chromosomes est donc de 46 chromosomes répartir-en : uploads/s3/ 4-5980972839941966231.pdf
Documents similaires


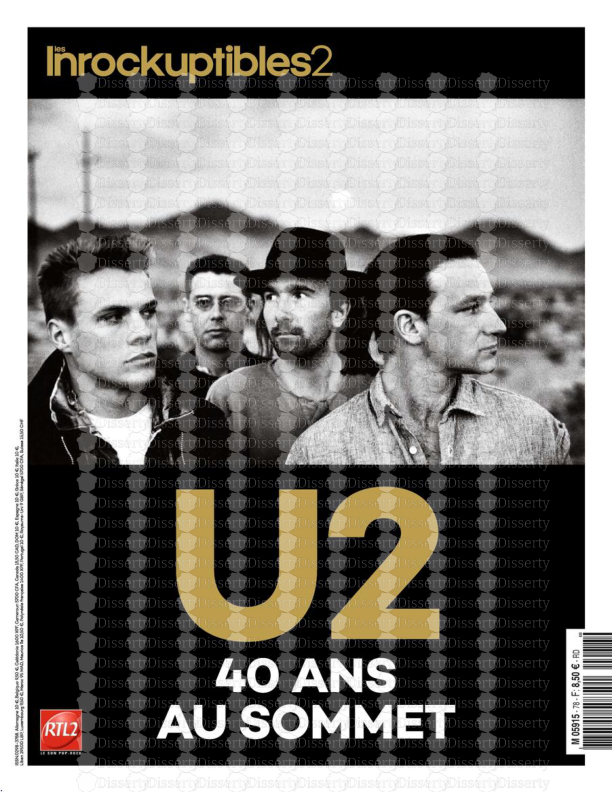







-
62
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 26, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.7688MB


