Revue d’esthétique musicale L’analyse perceptive des musiques électroacoustique
Revue d’esthétique musicale L’analyse perceptive des musiques électroacoustiques Une publication électronique de Musiques & Recherches LienAnalyse2011.indd 1 23/09/11 17:01:03 Sommaire La représentation sonagraphique est-elle une aide pour l’analyse perceptive de la musique électroacoustique ? Vincent Tiffon 3 L’analyse formelle en quête de significations profondes Stéphane Roy 16 Sur le statut de l’analyse morphologique François Delalande 20 Analyse de la musique électroacoustique, genre acousmatique, à partir de son écoute : bases théoriques, méthodologie et but de la recherche, conclusions Antonio Alcázar Aranda 25 Análisis De La Música Electroacústica – género Acusmático A Partir De Su Escucha : Bases Teóricas, Metodología De La Investigación, Conclusiones Antonio Alcázar Aranda 35 Un peu de tout entre l’analyse, l’écoute et la composition Rodolfo Caesar 45 Ce qu’a vu le vent d’Est (d’après Debussy) By Annette Vande Gorne : compositional strategies. A bridge with the past in the acousmatic field Interview and English text by Elizabeth Anderson 48 Musique informelle, musique électroacoustique : une convergence insoupçonnée ? Ricardo Mandolini 52 L’orchestration électroacoustique. Une approche particulière à la composition électroacoustique. Ses liens avec la musique instrumentale et ses applications dans le domaine de l’analyse musicale Mario Mary 71 Analyse perceptive en vue de l’étude du rapport texte/musique dansGesang der Jünglinge (Le chant des adolescents) de Karlheinz Stockhausen Sandrine Baranski 76 La fonction perceptive de l’espace composé dans l’œuvre de François Bayle Jan Simon Grintsch 107 Une logique des sensations François Bayle 112 via http://www.musiques-recherches.be/edition.php?lng=fr&id=110 Réalisée avec l’aide de la Communauté française (Direction générale de la Culture, service de la Musique) Revue d’esthétique musicale Direction : Annette Vande Gorne © Musiques & Recherches, 2006 - révision 2011 ISBN 978-2-9600201-1-3 LienAnalyse2011.indd 2 23/09/11 17:01:05 Revue d’esthétique musicale L’analyse perceptive des musiques électroacoustiques 3 La communauté des musiciens électroacousticiens et musicologues spécialistes de la musique électroacoustique tend à donner à la représentation sonagraphique (représentation intensité-fréquence en fonction du temps), produite notamment par l’Acousmographe (GRM) ou AudioSculpt (IRCAM), un statut de référence graphique de l’œuvre, dans la perspective du travail d’analyse. Si le module de lec- ture des outils d’analyse sonagraphique facilite la navigation dans l’œuvre électroa- coustique pour laquelle aucun support graphique n’existe, par définition, la lec- ture visuelle de la représentation sonagraphique synchronisée à l’écoute de l’œuvre modifie, à l’évidence, notre perception de l’œuvre et ainsi l’analyse perceptive que l’on peut en faire, au même titre que les logiciels d’aide à l’écoute et les réalisations multimédias offrant des « écoutes signées ». Par ailleurs, en réinstallant l’œil comme auxiliaire de l’oreille dans l’écoute mu- sicale (comme à l’ère hégémonique de la graphosphère), on se détourne de l’ap- proche acousmatique, qui postulait l’écoute musicale sans le secours de l’œil (pos- tulat de la vidéosphère). L’analyste se trouve-t-il alors en contradiction avec un des principes ontologiques du genre acousmatique (l’image sonore) ? Est-ce une contradiction stérile ou féconde ? La représentation sonagraphique offre-t-elle des informations pertinentes pour l’analyste ? La représentation sonagraphique est-elle une aide pour l’analyse perceptive de la musique électroacoustique ? Vincent Tiffon1 L’interrogation sur la pertinence d’une représentation sonagra- phique comme aide à l’analyse des musiques des sons fixés sur support fait écho à une pratique dont l’expérience montre qu’elle résout des problèmes autant qu’elle en crée. Cette contradiction sera étudiée en observant l’évolution, à l’échelle de la grande histoire, du rapport entre l’œil et l’oreille. C’est pourquoi nous voudrions croiser la méthode d’analyse médiologique avec les autres méthodes traditionnelles d’analyse dédiées au cas spécifi- que des musiques n’existant que sur un support électronique. I Parcours médiologique du rapport entre l’œil et l’oreille La question posée est celle de savoir ce qu’induit une représen- tation visuelle dans l’analyse perceptive d’une musique qui pos- tule précisément l’absence du visuel. Il apparaît sans doute utile de replacer cette question à l’échelle de la grande histoire – ou de l’histoire transversale, en observant le rapport entre l’œil et l’oreille sous l’angle de l’analyse médiologique, dont voici une brève présentation2. La médiologie est une méthode d’observa- tion qui vise à étudier les interactions entre les médiums (les infrastructures techniques et institutionnelles) et nos formes supérieures de symbolisation (la Religion, le Politique, l’Art, la Science…)3. Les médiums (cf. figure 1 en annexe) sont d’autant plus efficaces et cohérents qu’ils s’insèrent dans un milieu tech- nique et humain que la médiologie nomme des médiasphères (cf. figure 2 en annexe). Cette typologie en médiasphère a avant tout une valeur d’expo- sition, par nature simplificatrice. C’est assurément dans l’étude fine de la vie des médiums insérés dans des médiasphères en su- perposition que l’on pourra trouver quelques réponses à la com- plexité des rapports entre technique et culture. La médiologie tente ainsi de montrer l’impact des innovations techniques (et notamment celle de l’enregistrement) sur les inventions musi- cales, et en retour, l’influence de nos innovations culturelles sur les technologies du savoir. Dans la lignée de Leroi-Gourhan4, la médiologie peut être assimilée à une discipline de l’observation des phénomènes de transmission. Qu’observe-t-on ? Avec l’invention du papier, les musiciens en viennent à inventer l’écriture graphique, c’est-à-dire une for- me de création musicale passant par ce que Hugues Dufourt nomme l’ « artifice d’écriture »5. Par voie de conséquence, on invente une musique visuelle, dont le médium de fixation et de stockage coïncide avec le processus même de création : la par- tition devient cet objet prétendument neutre, susceptible d’être la référence dans un travail d’analyse entendu comme un travail prospectif allant au-delà du simple commentaire. Si la musique devient visible par la partition, elle le devient aussi dans la pra- tique d’écoute, notamment via le médium de diffusion qu’est le concert. On observe donc un rapport de causalité entre le son que l’auditeur entend et ce que l’auditeur voit. C’est préci- sément ce rapport de causalité qui disparaît avec les musiques concrètes, électroniques, électroacoustiques et acousmatiques. LienAnalyse2011.indd 3 23/09/11 17:01:05 Revue d’esthétique musicale L’analyse perceptive des musiques électroacoustiques 4 L’enregistrement sonore, inventé autour de 1878, offre pour la première fois la possibilité de fixer ce qui est par nature fuyant : on retrouve ici le caractère fondamentalement phénoménologi- que du son comme de l’image. La partition permettait de stoc- ker une musique susceptible d’exister via l’interprétation, mais la partition ne stocke pas la musique telle que nos oreilles la perçoivent. Lorsque les compositeurs détournent ce nouveau médium de fixation et de stockage qu’est l’enregistrement à des fins de création (comme l’avaient fait avant eux les musiciens de l’Ars nova avec la technologie du papier), ils participent à la mise en place progressive d’une nouvelle médiasphère, cohérente, basée sur ce que François Delalande appelle le « paradigme du son » : en inventant la fixation du son, on invente le son. S’ins- taure alors une relation à la fois conflictuelle et complice entre la note et le son, qui atteste des négociations permanentes entre la graphosphère et la vidéosphère : certaines musiques faites de notes s’inscrivent en réalité dans la logique du paradigme du son : musiques minimaliste et répétitive, musique spectrale… en passant par Ligeti ou Cerha. La musique électroacoustique est bien évidemment celle qui radicalise la nouvelle donne : en postulant l’absence du visuel, elle se passe définitivement de l’abstraction du graphe – rappelons que le « concret » de la mu- sique concrète s’oppose à l’abstraction solfégique de la musique écrite – permettant ainsi la situation d’écoute acousmatique, si- tuation d’écoute neuve et lourde de conséquences. Mozart ou Debussy écoutés en situation acousmatique ne sont plus Mozart ou Debussy, mais une image de la musique de Mozart ou de Debussy. L’analyse médiologique permet de mieux évaluer les conséquences considérables d’une vérité évidente : une musique enregistrée n’est pas une musique vivante. Avec le nouveau médium de l’enregistrement, le musicien et l’analyste n’ont plus de support de référence censé représenter l’œuvre. La difficulté de l’analyse de la musique électroacous- tique tient à cette absence de support visuel, même si l’on doit se rappeler que la musicologie est une discipline neuve, quasi inexistante en tant que telle avant le XIXe siècle. D’où le recours à une transcription, à une représentation graphique la plus neutre possible pour faciliter le travail d’analyse. La communauté des chercheurs semble s’entendre sur l’usage de la représentation so- nagraphique comme référence à l’analyse. Mais cette représenta- tion peut aussi s’accompagner d’une transcription graphique. II Transcription / représentation Par transcription, l’on entend un travail de représentation symbolique de l’œuvre. Rappelons à ce sujet la mise en garde de Stéphane Roy : « Une transcription n’est pas un niveau neutre puisqu’elle n’est pas l’œuvre, ni même la représentation symbolique de celle-ci ; elle n’est qu’une représentation symbolique de l’œuvre, qui reflète étroitement les critères adoptés par l’analyste pour réaliser une analyse de niveau neutre de l’œuvre. »6 Si la transcription est donc une représentation symbolique, la transcription est un cas particulier de la représentation (définie ci-après). La transcription, dans le cadre d’un travail d’analyse des musiques électroacoustiques, est un travail subjectif qui relève donc déjà, de par sa facture, d’une interprétation analytique ; il s’agit donc bien d’une représentation symbolique parmi tant d’autres possibles. Par uploads/s3/ analyse-perceptive-en-vue-de-letude-du-r-pdf.pdf
Documents similaires






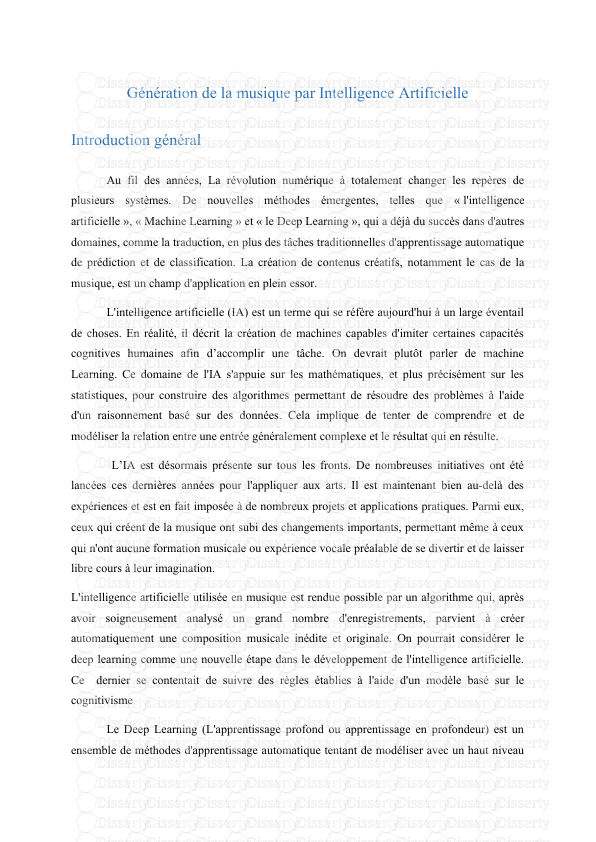



-
110
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 04, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 7.6023MB


