1/110 Les Arts de l’Espace, Casterman, 1959 - La Peinture Henri Van Lier LES AR
1/110 Les Arts de l’Espace, Casterman, 1959 - La Peinture Henri Van Lier LES ARTS DE L’ESPACE Vertige! voici que frissonne L’espace comme un grand baiser Qui, fou de naître pour personne, Ne peut jaillir ni s’apaiser. Stéphane MALLARMÉ Lorsque tout est à son intensité, — la couleur, le dessin, l’idée (le thème), la proportion, l’équilibre, l’harmonie réalisée entre tous ces éléments constitutifs, — alors à ce moment se déclenche une sensation de l’ordre de l’ineffable. Je l’ai baptisée : l’espace indicible. Le mot suffit. Et si j’ai pu toucher la sensibilité (même religieuse) des gens à Ronchamp et à la Tourette c’est à cause de cette nature d’harmonie déclencheuse d’espace. C’est dans la peinture que j’ai reconnu en premier ce phénomène indicible. LE CORBUSIER, Lettre à l’auteur du 24 mai 1960. Le donné formel est tout entier communicable, peut s’imiter ou s’apprendre; l’espace comme tel est incessible. Jean GUIRAUD, L’énergétique de l’espace, 1970. Introduction Je suis fier de le dire, je n’ai jamais considéré la peinture comme un art de simule agrément, de distraction; j’ai voulu par le dessin et la couleur, puisque c’étaient là mes armes, pénétrer toujours plus avant dans la connaissance du monde et des hommes. Pablo PICASSO, Interview publiée par New Masses, octobre 1944. I C’est un des grands mérites de notre temps de s’être rendu compte que la peinture, l’architecture ou la poésie ne sont pas ces « ornements égayés » dont parlait Boileau, et Descartes avant lui. L’homme du XVIIe siècle devait le croire. Il se représentait la vérité sous la forme d’idées claires et distinctes, qui s’exprimaient d’autant plus adéquatement que le langage était plus dépouillé, plus précis, plus raisonnable. Tout ce qui s’ajoutait à la pure énonciation, comme le charme du discours chez le poète ou la séduction de la couleur chez le peintre, n’apportait rien d’essentiel. Ce pouvait être un moyen pédagogique de stimuler notre attention, d’émouvoir notre sensibilité, et par là de nous mieux disposer à la réception du vrai. Ce pouvait être aussi un agrément raffiné, sorte de détente supérieure, qui était à l’esprit ce que le jeu est au corps. En tout cas, l’art demeurait un luxe, spirituel mais gratuit. Nos classiques parlent sans flagornerie lorsqu’ils se montrent si humbles dans leurs épîtres dédicatoires : ils croyaient sincèrement qu’en dépit du génie, leur activité n’était pas primordiale. En théorie, sinon en pratique, l’homme de lettres ou 2/110 Les Arts de l’Espace, Casterman, 1959 - La Peinture Henri Van Lier l’artiste, toujours un peu amuseurs, gardaient mauvaise conscience devant le théologien ou le soldat. Les romantiques retrouvèrent et approfondirent le principe déjà affirmé à la Renaissance, que la vie esthétique, loin d’être accessoire, est une des manières fondamentales dont nous assumons notre destinée — en quoi réside leur révolution, plus qu’en l’exaltation du sentiment. Ils eurent pour seul tort d’insister tant sur la poésie et la musique qu’ils en oublièrent les arts de l’espace. Baudelaire et Ruskin, puis, au début de ce siècle, les théoriciens du cubisme, du surréalisme et de l’abstraction répareront leur négligence. Et les quelques décennies indispensables à la propagation des idées ont transformé la mystique de cénacles ésotériques, antibourgeois, « maudits », en conviction raisonnée et universelle. II Cette dimension de l’existence, ce n’est pas de savoir quelle proportion de blanc d’œuf entrait dans la peinture à la détrempe, ni la datation des progrès du béton armé, ni les facteurs économiques ou sociaux ayant suscité les mécènes, ni les détails pathétiques des amours de Van Gogh ou des mésaventures de Le Corbusier, ni même les investigations psychanalytiques sur les relations de Vinci avec sa mère, qui nous y introduira. Tout cela, qui rend service, a été bien étudié, mais reste extérieur à la visée de l’art, comme Freud en convenait. Et, à l’autre extrême, nous sommes également déçus par les philosophes. L’œuvre d’art, c’est la révélation sensible de l’Idée, dit Hegel; le dévoilement d’une origine, dit Heidegger; une profondeur dans le visage du monde, ajoute Weischedel; un quasi-sujet, pense Mikel Dufresne. Et sans doute ces formules, avec leurs accents divers, convergent et prouvent que, dût-on échouer à dire si tel objet appartient bien à l’art, nous entrevoyons cependant, depuis plus d’un siècle, ce qu’est l’art en général. Mais, de même que les enquêtes historiques restent en dessous de l’œuvre, les réflexions des philosophes planent au-dessus. On voudrait alors une approche à niveau, de plain-pied. On suivrait dans leurs dispositions concrètes ce qui fait que la Bethsabée au bain, la Vénus de Lespugue ou le Tadj-Mahall ne sont pas des objets comme les autres et peuvent devenir le terme d’une expérience absolument originale. Nous retrouverions les définitions des philosophes, mais incarnées dans les structures de l’objet et dans les comportements du sujet, lequel, pour éprouver l’œuvre, doit toujours la refaire. A vrai dire, la saisie artistique ne se présente pas d’une venue, et ce sera notre premier travail que de distinguer quatre attitudes, de plus en plus intérieures et profondes, devant l’œuvre d’art. Par ailleurs, la peinture est une surface étalée, la sculpture un centre englobé, l’architecture une couverture englobante, en sorte que nous devrons tirer les conséquences du fait que la première est plus visuelle, la seconde plus tactile, la troisième plus kinesthésique et cénesthésique. Contrairement à la tradition, où l’on part de l’édifice comme du lieu où tout le reste prend place, c’est vers le tableau que nous nous tournerons d’abord. La peinture est le plus complexe des arts de l’espace, celui qui, du point de vue perceptif, pose les problèmes les plus variés. Du reste, elle a dominé notre époque jusqu’à hier; c’est autour des toiles de Degas, de Cézanne, de Picasso et de Paul Klee que s’est noué le monde contemporain. En commençant par la peinture, nous avons des chances d’occuper une position centrale, d’où le reste s’éclairera. 3/110 Les Arts de l’Espace, Casterman, 1959 - La Peinture Henri Van Lier LA PEINTURE Chapitre I L’attitude spectatrice et le sujet scénique Un premier point de vue, le plus courant, considère le panneau peint comme une fenêtre par où nous serait offert un spectacle, réel ou imaginaire. A travers le rectangle du cadre, nous regardons s’étendre un paysage, se fermer un intérieur, évoluer un drame, surgir des monstres d’Apocalypse. On assiste et on prend part, du moins en esprit. L’œuvre livre alors ce que nous appellerons son sujet scénique. Celui-ci est déjà animé, dans ses contenus et dans sa présentation, par une intention spéciale, par une tendance à l’universel, propre à l’art. I. LES CONTENUS A. Le documentaire Lorsqu’il comporte un spectacle, le tableau a souvent le caractère d’un document. L’image se prête en effet au constat, comme le prouve l’emploi judiciaire de la photographie. Elle enregistre assez bien le fait brut. Le peintre a même le recours, comme le photographe, d’estomper ou au contraire de souligner les détails par l’éclairage, l’angle de vue, le cadrage, voire de commenter la scène par des insignes : auréole des saints, sceptre des rois, collier de la Toison d’Or, ou, de façon plus secrète, paon de sainteté, fleurs de paradis. Mais si l’image picturale et photographique capte bien le fait ou l’emblème, elle réussit mal à nous en dire le sens. Qui distinguera après trois siècles, dans le sourire de cette abbesse de Lenain, ce qui fut suffisance, affabilité, joie, niaiserie ou simplement sénilité? Nos interprétations en ce domaine résultent d’idées préconçues, et Buytendijk fait justement remarquer que « si l’on tend à quelqu’un un portrait en lui disant qu’il s’agit d’un assassin, les traits composent à ses yeux un tout autre visage que s’il croit avoir affaire à un savant »1. La difficulté redouble dans les insignes et les cryptogrammes, dès que nous cessons de les traduire un à un pour chercher leur signification d’ensemble. Ainsi une fresque crétoise aligne une procession de femmes, mais s’agit- il d’action de grâces, de magie, de communion cosmique, de parade? N’accusons pas trop vite l’éloignement, puisque notre familiarité avec la Renaissance ne nous rend pas beaucoup plus déchiffrables les intentions enfermées par Vinci dans le sourire ou le paysage de la Joconde. N’accusons pas trop non plus l’immobilité du tableau ou de la photo, puisque le dessin animé, voire le cinéma muet échouent également à raconter des histoires circonstanciées. L’ambiguïté et la prolifération anarchique des sens semble une caractéristique de l’image comme telle, du moins quand on la compare au mot2. Et l’on oserait s’en plaindre, si cette faiblesse, bien comprise et bien exploitée, n’avait, en retour, des vertus. Voyons, dans le chef-d’œuvre du reportage photographique que sont les Images 1 F. J. J. BUYTENDIJK, La Femme, DDE, 1954, rééd. 1967, p. 201. 2 En ce qui concerne ces caractères dans l'image filmique, cf. G. Cohen-Séat et P. Fougeyrollas, L'action sur l'homme : cinéma et télévision, Denoël, 1961. 4/110 Les Arts de l’Espace, Casterman, 1959 - La Peinture Henri Van Lier de guerre de Capa, le combattant saisi en pleine chute, ou encore les cadavres étendus raides sur une plate-forme de Castille. A part le fait brut uploads/s3/ arts-espace-1.pdf
Documents similaires






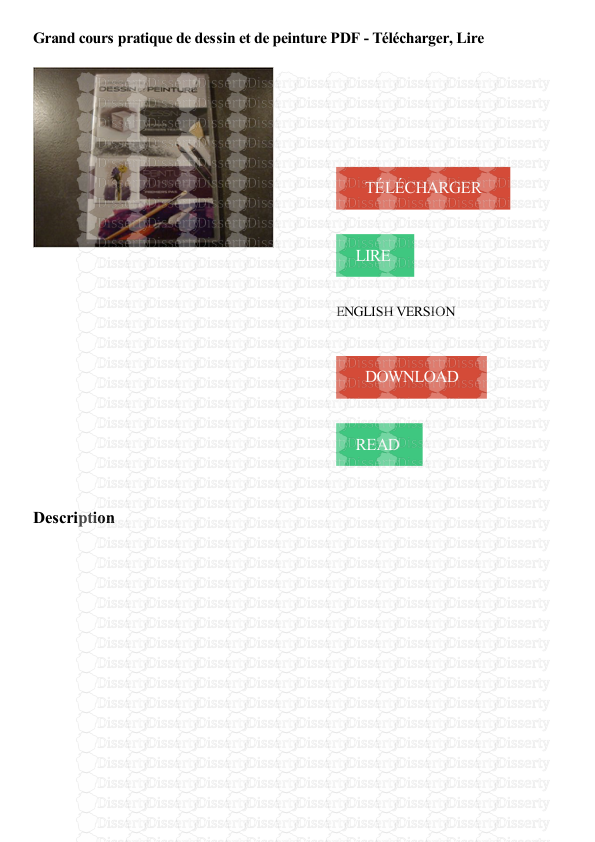



-
36
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 08, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.0331MB


