Cours 6 L’HOMONYMIE La distinction homonymie /polysémie est très importante pou
Cours 6 L’HOMONYMIE La distinction homonymie /polysémie est très importante pour la conception des entrées de dictionnaire. Définition Homonymie : Étroitement reliée à la polysémie, comme on le verra plus loin, l’homonymie est une question centrale de la sémantique lexicale. Il y a deux définitions du terme homonyme. La plus courante est celle donnée par Robert : [Robert ] Homonymie : Se dit des mots de prononciation identique (voir homophone) et de sens différents, qu'ils soient de même orthographe (voir homographe) ou non. Comme le précise Robert, ce qu’ils appellent des homonymes sont en fait des homophones mais en enlevant de la définition (et de forme graphique différente). Pour eux, sont homonymes paire/père et avocat (fruit) /avocat (juriste). Il y a, en sémantique lexicale, un autre emploi du terme qui est plus restreint et plus intéressant pour les sémanticiens, qui élimine les couples de graphie différente (paire/père). L’homonymie désigne le lien de similitude ou de ressemblance entre des mots ayant des sens différents, autrement dit c’est une relation qui s’établit lorsque deux entrées lexicographiques sont distinctes sémantiquement et identiques graphiquement. Le dictionnaire les enregistre comme des entrées distinctes. Ainsi, l'homonymie peut s’actualiser au niveau de la forme orale (mots ayant le même son), auquel cas on parle d'homophonie (par exemple, perd et paire sont homophones), ou au niveau de la forme écrite (mot ayant la même orthographe), on parle d'homographie (par exemple, fraise (instrument) et fraise (fruit) sont homographes). L'homophonie se présente comme deux lexèmes qui ont un même signifiant sonore, mais des signifiés différents, comme par exemple : - sain(s), saint(s), sein(s), seing; - sans, sang, cent ; 1 - seau, saut, sot, sceau; - ver, vers, vert, verre, vair ; UN VER VERT DANS UN VERRE VERT - coq, coque, coke. L'homophonie est, par conséquent, une homonymie sonore (et non optique ou tactile). Par exemple, pair, père, paire, voie, voix, chant, champ, dessin, dessein, compte, conte, " sont homophoniques. Par économie, des phonèmes peu différents peuvent être peu à peu assimilés s'ils différenciaient (et permettaient de distinguer) peu de monèmes, et donc si leur disparition crée / produit peu d'homophones. Par exemple, en français, il y a une tendance à n'y avoir qu'un seul /a/ alors qu'il y en avait deux qui faisaient la différence /ba/ ("bas") et /b/ ("bât"), /pat/ ("patte") et /pt/ ("pâte"); le /u/ a tendance à disparaître aussi, et on prononce /brë/ ("brun" comme /br/ ("brin") et /prë/ ("emprunt") comme /äpr/ ("empreint"). L'homographie apparaît lorsque deux lexèmes ont chacun leur signifiant sonore propre et leur signifié propre : - portions (sbs. f. pl) et portions (vb. à la 1re personne de l'imparfait), - couvent (sbs. m. sg.) et couvent (vb. à la 3e personne du pluriel, présent de l'indicatif), - parent (n.m) et (ils) parent (v.3e pl. ind. prés.) - (le) président (n.) ~ (ils) président (v.) - rue (voie de circulation) ~ rue (plante vivace), - les poules du couvent couvent - les fils de soie ~ les fils de famille L'homographie représente donc l'homonymie optique ou tactile (et non sonore). Nous pouvons conclure que l’homonymie est un terme - «parapluie». Il couvre deux sous-catégories, soit: l’homophonie: mots de même prononciation, mais de graphie différente (pot ~ peau) et l’homographie : mots de même graphie, mais de prononciation et de signifiés différents. 2 Il arrive assez souvent que les lexèmes soient homophones et homographes à la fois. C’est le cas du lexème son «résidu de la mouture du blé», son «bruit» et son «déterminant et adjectif possessif» ou du lexème porte : la porte (n.) ~ il porte (v.) : L’unité de signification que illustre par excellence cette coopération entre les homophones et les homographes : que (pron. rel.) : La maison que vous voyez... ; que (pron. interrog.) : Que voulez-vous ?; que (conj. subord.) : je sais que tu viens ; que (adv.excl.) : Que tu me manques ! Etant donné la prédominance de l’oral sur l’écrit, on peut entendre des opinions d’après lesquelles seule l’homophonie est constitutive de l’homonymie. Il ne faut pourtant pas minimiser l’importance de l’orthographe et des homographes. Si l’homophonie est l’une des principales sources d’ambiguïté, c’est à l’orthographe d’opérer la désambiguïsation. Les langues riches en homophones, donc riches en ambiguïtés réelles et potentielles, sont obligées de recourir à des procédés de désambiguïsation. C’est grâce l’orthographe (opération purement visuelle) et aux contextes particuliers qu’on peut désambiguïser à l’oral des unités comme eaux, os, Oh!; vers, ver, vert, verre, vair. Ainsi, on va situer un homophone dans un contexte précis si l’on veut lever toute ambiguïté réelle ou potentielle : - vers l’aéroport Pearson /+direction/ - un ver solitaire /+animé/, /non vertébré/ - le livre vert /+couleur/ - des vers de poésie /+production de l’esprit/, /+esthétique/ - un verre de vin /+objet/, /+transparence/ - un manteau de vair (type de fourrure à l’époque médiévale) /+objet/, / +vêtement/. Il est à remarquer qu’en français on a affaire à certains mots qui connaissent plusieurs orthographes, sans pour autant perdre leur sens et parfois même tout en conservant leur prononciation, comme dans le cas de clé / clef, cuiller / cuillère. Ces mots à graphie multiple sont appelés variantes et n’ont rien en commun avec les homonymes. Une autre confusion possible peut intervenir lorsqu’il s’agit d’un phénomène sémantique appelé paronymie. Un paronyme est un mot presque homonyme. Les 3 paronymes sont des mots se ressemblants phonétiquement, sortes d’homophonie approximative. éminent/imminent collision/collusion enduire/induire… Ce qui intéresse largement les études de sémantiques est de trouver les arguments de prouver la relation d'homonymie, pour la distinguer de la polysémie. Soient les exemples : l’étalon et la jument / l'étalon de l'or un livre intéressant / une livre de beurre L'un des critères de distinction est fourni par le sens. Si on a une relation de sens, il s'agit de polysémie, sinon, il s'agit d'homonymie. Un autre critère est de nature formelle: deux homonymes peuvent se distinguer par leur genre (le mémoire / la mémoire), par leur partie du discours (il mesure / la mesure), par leur orthographe. Ainsi, dans le cas de livre, on constate que la première occurrence est masculine, la deuxième féminine. Un troisième critère est fourni par la dérivation. Prenons le cas de étalon. On constate que la première occurrence ne donne pas lieu à des formes dérivées. Par contre, la deuxième est reliée à un verbe étalonner = tester en comparant à une mesure. La différence de dérivation nous donne un indice de la différence de classe. L'étude des sens multiples se complique une fois qu'on inclut la dimension historique. L'évolution du sens peut passer par une longue série d'étapes qui font en sorte que l'on voit peu de parenté entre le point de départ et le point d'arrivée. Par exemple, en français, le mot grève `cessation volontaire de travail' repose sur le sens `plage de gravier' puisque les travailleurs sans ouvrage s'assemblaient à Paris sur la Place de Grève. Mais de nos jours, personne (sauf les linguistes) ne voit le lien. D'autres cas sont plus délicats. Y a-t-il une relation entre bloc de marbre et Bloc soviétique? Seule l'application systématique des critères permet de répondre à la question (et la réponse risque de varier d'un locuteur à l'autre). 4 L’homonymie s’appuie sur une analyse distributionnelle des lexèmes. Chaque lexème homonyme a son sens déterminé par l’environnement dans lequel il apparaît. Par conséquent, chaque mot d’entrée ne correspondra qu’à une seule paraphrase. Entre les sémèmes des homonymes il n’y a pas d’intersection. Les deux lexèmes grève =plage de sable = cessation du travail apparaissent dans le dictionnaire comme deux entrées, donc deux signes notés grève1, grève2. Un verbe comme appréhender comportera autant d’entrées lexicographiques qu’il a de sens : appréhender qqn = l’arrêter appréhender qqch =le craindre Le sens de crainte se retrouve dans le dérivé nominal appréhension : Il éprouve une certaine appréhension devant son père. C’est aussi le cas d’un substantif comme cuisinière ci-dessous : Cuisinière1= /+humain/ (Cuisinière –femme) Cuisinière2 = /-humain/ (Cuisinière électrique) Le recours au contexte lève l’ambiguïté : La Cuisinière était la mère de Michel. Les grammèmes peuvent être à leur tour homonymes. Ainsi le suffixe –eur est bisémique puisque sur une base adjectivale il forme des féminins, son sens étant : qualité ex. noir/noirceur, pâle / pâleur et sur une base verbale il forme des noms marqués par le noyau sémique : agent, instrument : arroser/arroseur ; tailler/ tailleur, etc. Par l’analyse distributionnelle on distingue les différences entre les mots, en mettant en évidence le rapport entre les homonymes et leurs dérivés syntaxiques. Les dérivés peuvent se regrouper sous des homonymes différents. Si on a deux signes A et B homonymes, tous les dérivés suffixés de A (A1, A2,....) forment avec A un même ensemble, et tous les dérivés de B forment avec celui-ci un autre ensemble (en fonction du sens du mot). Collège 1 aura pour dérivés : collégien (institution) Collège 2 - collégial (fonction) 5 Homonymie et polysémie L'étude des sens est compliquée par un fait essentiel du langage humain. Il n'existe uploads/s3/ cours-6.pdf
Documents similaires







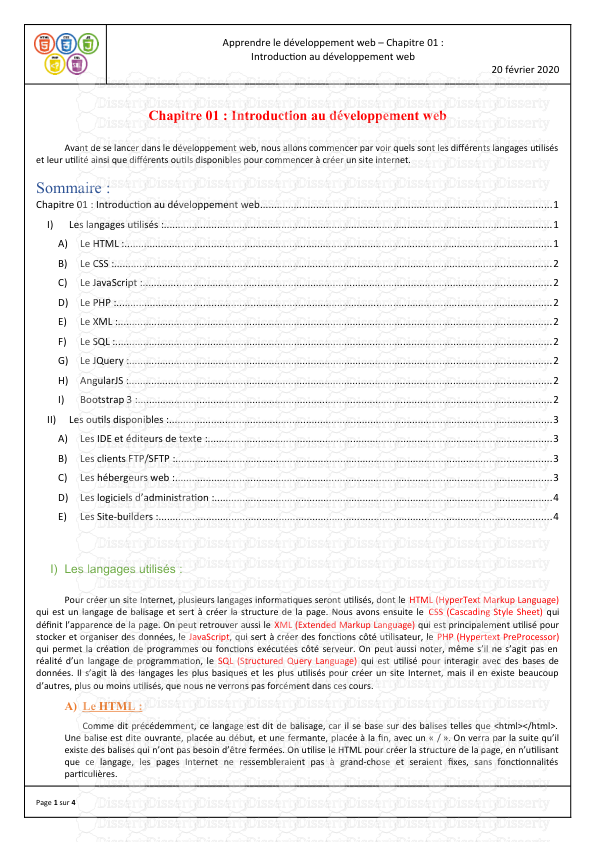


-
47
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 27, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1513MB


