CRÉATION MUSICALE D'AUJOURD'HUI ET CERVEAU PAR P. LALITTE" En 1965, une collabo
CRÉATION MUSICALE D'AUJOURD'HUI ET CERVEAU PAR P. LALITTE" En 1965, une collaboration entre le compositeur Alvin Lucier et le physicien Edmond Dewan aboutit à la création de Music for Solo Performer, première piè ce musicale utilisant les ondes cérébrales1• Le performer, assis au milieu de la scène les yeux clos, cherchait à atteindre un état de calme afin de produire des ondes alpha. Le signal, capté par des électrodes, était conduit vers 8 amplifica teurs stéréo connectés à 16 haut-parleurs répartis dans la salle de concert. Le amplifié faisait vibrer divers instruments à percussion placés à proximité des haut-parleurs. Le compositeur John Cage participa à la création en manipu lant aléatoirement le volume des amplificateurs pendant les 40 minutes de la performance. Cette pièce initia pour Lucier pour approche originale de la com position où le public était amené autant à observer qu'à écouter, En scrutant le visage du performer, le spectateur tentait de comprendre la corrélation entre son état de concentration et les sons qui émanaient des percussions. Au-delà de son intérêt artistique, cette performance renvoie au mystère de la création musicale. Que se passe-t-il dans le cerveau d'un compositeur au mo ment de l'acte de composition? La notion de processus de création peut se défi nir comme la succession des pensées et des actes qui débouchent sur une œuvre, une invention ou une théorie nouvelles. Un grand nombre de facteurs semble entrer en ligne de compte -l'inspiration, les connaissances et les souvenirs stoc kés en mémoire, les usages et les routines, la planification, le raisonnement... le hasard - et rendre la compréhension de ce phénomène particulièrement ardue. I:acte de création est réfractaire à l'observation direete, d'autant plus qu'il n'in tervient pas sur commande et qu'il n'est pas reproductible à l'identique. La com· et la quantité des tâches requises pour composer une pièce musicale sont également très variables, allant d'une simple juxtaposition intuitive de notes à un long processus rationne1. Par conséquent, il n'est pas étonnant que ce do· maine de la cognition humaine soit si peu connue et étudiée. Jusqu'à ces derniè res années, la musicologie n'a abordé cette question qu'indirectement par le biais des études biographiques et des traces laissées par les compositeurs (Sketch Studies). De leur côté, la psychologie cognitive et les neurosciences de la musi que, focalisées essentiellement sur les questions d'apprentissage, de mémoire, de 1 Music /"1' Solo Perfonner a été créé au Rose Art Museum de l'Université Brandeis le 5 mai 1965. • I.EAn (CNRS lIMR <;022) LJniVl'I'Nit(o dl' BOlll'goglll" PÔIl' AAFE· ENplanudt' EmslII'" Ill' 2M n . 210tl<; Dijon ("'''l'X rUJ'Al'ION MI/...,/CALf: D'AWOlllW'lIl11 /iTCh'RV/:'AIl '\7 perception et a Interprétatlon, ne se sont que peu impliquées dans ce domaine de recherches. Malgré tout, l'étude des processus de création semble, depuis une dizaine d'années, devenir un centre d'intérêt pour les chercheurs. Lobjectif de cet article n'est pas de produire un état de l'art exhaustif, mais simplement poser quelques problèmes relatifs à cette question. Nous ferons, dans un premier temps, une brève revue de la littérature produite depuis une cinquantaine d'an nées. Nous aborderons ensuite la question des phases génératrices et exploratoi res à partir de témoignages de compositeurs. Pour terminer, nous examinerons les choix stratégiques de Roger Reynolds lors du processus de composition de The Angel ofDeath, une pièce spécialement conçue pour mener des études sur les processus de perception et de création d'une œuvre contemporaine. Fig. 1 : Alvin Lucier interprétant Music for Solo Performer ETUDIER LES PROCESSUS DE CRÉATION MUSICALE: UNE BRÈVE REVUE DE LA LITTÉRATURE Il y a 25 ans déjà, John Sloboda [29] soulignait, dans un chapitre de Musical Mind consacré à la composition et l'Improvisation, le déséquilibre entre les étu des sur la perception musicale et celles sur les processus de composition. Dans un article de 2001 au titre provocateur "Us psychologues peuvent-ils dire quelque chose d'utile sur la composition ?", Sloboda [30] portait un regard pessimiste sur une quelconque possibilité de compréhension des processus de création musi cale. Il soulevait la question de l'acte créateur dont la nature - jugée ineffable, insaisissable, évanescente, subjective s'opposerait à toute tentative d'intrusion. Le compositeur François-Bernard Mâche [20] souligna, lui aussi, la difficulté à revenir sur un travail de composition achevé: "Même pour les étapes décrites as sez précisément dans les notes de travail, il arrive que j'ai du mal, après coup, à re trouver l'imagerie mentale qui les avait suscitées, tout comme le résultat musical peut dans certains cas m'apparaître étranger". Pour Sloboda, l'impossibilité d'en registrer le déroulemem complet de la composition et l'inadéquation de la verba. lisation, en temps réel, sans altérer le processus lui-même, seraient les paux facteurs qui le conduisent à rejeter l'étude de la cognition créatrice. Pour autant, quelques études empiriques sur les processus créatifs en musique ont vu le iour depuis un demi-siècle (pour une revue complète, voir Collins .1H /~ JAUTTli I:étude séminale de Reitman [25] a porté sur l'observation d'un compositeur professionnel dont la tâche consistait à composer une fugue. I:auteur a rapporté trois comportements du participant pendant la phase d'écriture: 1) une ten dance à multiplier les contraIntes au fur et à mesure de l'avancée de la composi tion2 ; 2) la suspension momentanée de l'attention sur un paramètre (par ex. le rythme) pour mieux résoudre un problème particulier; 3) le report d'un pro blème à un autre moment de la composition lorsque certaines contraintes ne peuvent être appliquées à un moment donné du processus. Davidson et Welsh [6] ont demandé à des participants novices et experts de rapporter à voix haute leurs stratégies en écrivant une mélodie. Les auteurs ont observé que les novices effectuaient la tâche note à note, alors que les experts étaient capables de regrou per les éléments mélodiques en de plus larges unités. Avec une méthodologie équivalente, Younker et Smith [32] ont rapporté que les novices se focalisaient sur les structures locales ou les sons isolés, alors que les experts se montraient capables d'accomplir leur tâche avec des groupements plus larges. Colley et coll. [4] ont obtenu des résultats similaires avec une tâche de complétion d'un choral de Bach de 7 mesures. Les résultats de ces études n'apportent qu'une compré hension limitée du processus de création en raison du type de protocole choisi qui ne favorise pas l'émergence des différentes étapes du processus. I:utilisation de l'informatique a permis d'améliorer l'observation du proces sus de composition dans sa dImension dynamique avec la méthode "sauvegarder sous" qui offre la possibilité de conserver tous les stades du processus. Folkestad [12, 13] a demandé à de jeunes enfants de composer en "sauvegardant sous" continuellement leur travail (sous forme de fichiers MIDI). I:auteur a pu obser ver deux styles de composition: le premier, qualifié d'horizontal, où l'activité se déroule linéairement du début jusqu'à la fin, le second qualifié de vertical, où les participants travaillent d'une façon récursive. Un résultat similaire a été obtenu avec des jeunes adultes et des adolescents par Burnard et Younker [3] et par Seddon et O'Neill [28]. Comme dans le cas des études citées plus haut, basées sur la comparaison de niveaux d'expertise, la simplicité de la tâche, qui s'apparente à un exercice, ne peut rendre compte d'un véritable travail de composition sur une longue durée. I:étude de Collins [5] a été conçue pour obtenir un maxImum de données dans des conditions "écologiques". Les données recueillies comportaient des fi chiers MIDI et audio (avec la méthode "sauvegarder sous"), mais aussi des inter views et des commentaires rétrospectifs du compositeur, ainsi que des éléments notés graphiquement et musicalement. I:étude ne comportait qu'un seul partici pant, un compositeur professionnel, habitué au travail sur ordinateur. Il lui a été demandé de composer librement, sans limitation de durée, une musique de vidéo. Il est apparu que le compositeur avait, dès le départ, une idée globale de sa composition en termes d'atmosphère, d'image mentale (une bataille), de so norité et de matériau thématique (deux thèmes opposés). Dans une phase ulté rieure, il fut confronté à un celtain nombre de problèmes à résoudre qui ont proliféré au fur et à mesure du travail d'écriture (transition entre les thèmes, réordonnancement des thèmes, formulation de nouvelles Idées, etc.). Sur la base des observations recueillies, CollIns a proposé un modèle du processus de créa tion musicale. La composition est vue, non comme une activité de résolution de 1 /),'S cmlll'lliJlll's l'Xll'l"IlI's. ('011/111<' 1'1II/(/I"(/IÎIlII dl' l'ëcrÎllIn·/ill!.lI('1' <111111' ÎII/(·r,m'/(/IÎfllll'i(/IIÎS/ÎlIII('. IL",- ~·nll/"'nl'lJi~H.' fu/.wu .....' ''''Hf'lll/n(''Ia' fllH' l'Jf 1111; JI ;Îllf "tUJJtlf)~I( Hn(i'j(tl,'J1l1Ht'lll. (m;M/ON MUS/CAU:' /)'A/J.I()(//W'/IlJJ UT C/:RVliAIJ .N problèmes, mais comme "une activité expressive de génératIon de solutions ren contrant les contraintes de problèmes émis par le compositeur lui-même" [5]. Cette activité se déploierait par une série d'étapes, dont les frontières sont par fois imprécises, avec des processus à la fois linéaires, récursifs et parallèles. I:étude de Collins [5], qui fait émerger toute la dynamique et la complexité co gnitive du processus de création, n'apporte cependant pas de réponse à la ques tion de la grande forme car la méthode "sauvegarder sous" a tendance à focaliser l'observation sur le niveau local. uploads/s3/ creation-musicale-et-cerveau.pdf
Documents similaires








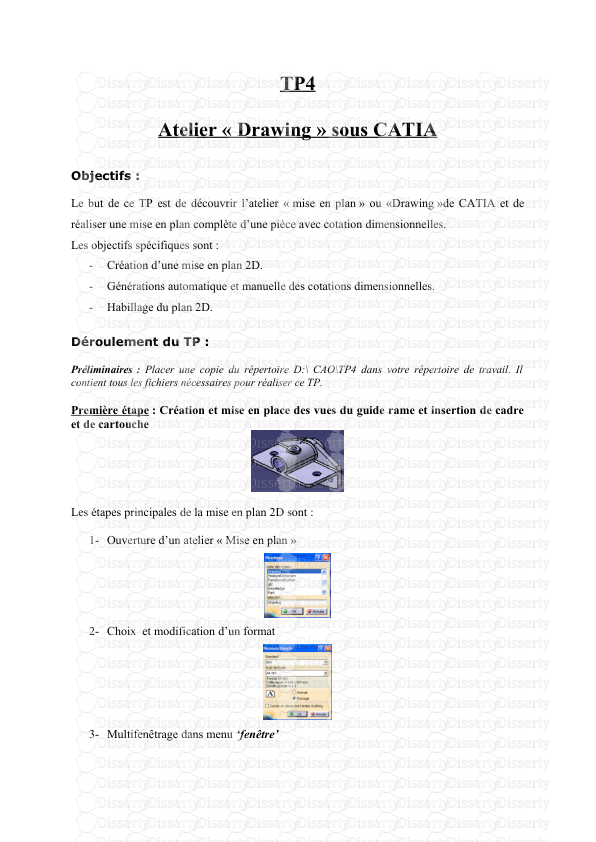

-
94
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 15, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.8489MB


