1 Dessiner grâce au cerveau droit - Betty Edwards http://www.drawright.com/ htt
1 Dessiner grâce au cerveau droit - Betty Edwards http://www.drawright.com/ http://www.dessinoriginal.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=25&ref=LIV_2870098 006&code_lg=lg_fr&pag=1&num=1&tri=0&marq=0 1. Le dessin et l’art de rouler à bicyclette 2. Le dessin comme moyen d’expression : le langage non verbal de l’art 3. Votre cerveau côté gauche et côté droit 4. Une première expérience de la conversion cognitive gauche droite 5. Evocation d’un dessin d’enfant 6. Votre symbolique : à la rencontre des bords et des contours. 7. La forme des espaces: l’aspect positif des espaces négatifs 8. Coup d’oeil à la ronde: la perspective sur un mode nouveau 9. Répétition générale: la place des proportions 10. De face et de profil: le portrait sans peine 11. Passage à la troisième dimension: voir la lumière pour dessiner les ombres 12. Le Zen du dessin: la révélation de l’artiste Postface - A l’attention des professeurs et des parents - A l’attention des élèves des Beaux-Arts Glossaire Bibliographie Index 2 Préface Dessiner grâce au cerveau droit est le fruit de dix ans de recherches orientées vers l’élaboration d’une nouvelle méthode pour enseigner le dessin à des individus d’âges et d’occupations divers. C’est au départ d’une véritable énigme que je me suis décidée à entreprendre ces recherches ; pourquoi le dessin, alors qu’il me semble si facile et si agréable, paraît-il si compliqué à mes élèves ? Depuis très longtemps, depuis l’âge de huit ou neuf ans peut-être, je dessine correctement. Je pense être l’un de ces enfants qui, fortuitement. découvre une manière particulière de voir qui lui permet de bien dessiner. Petite encore, quand je voulais dessiner quelque chose, je me disais : « Tu n’as qu’à faire ‘cela’ ». Je n’ai jamais pu définir ce que ‘cela’ signifiait mais je sais qu’il fallait que je fixe du regard pendant un moment ce que je voulais dessiner avant que cela se produise. Je pouvais alors dessiner mon sujet avec une adresse surprenante pour mon âge. On a beaucoup encouragé mes dispositions pour le dessin. Je m’entendais souvent dire: « N’est-ce pas merveilleux ce don artistique chez Betty ? Sa grand-mère déjà faisait des aquarelles, vous savez, et sa mère est elle-même très douée. Il doit s’agir d’une aptitude naturelle, je suppose — un don particulier ». Comme tous les enfants de mon âge,j’adorais être complimentée pour mon apparente singularité et j’étais bien près de croire ces éloges. Mais au fond de moi-même, je sentais que ces compliments étaient déplacés. Je savais qu’il était facile de dessiner et que n’importe qui pouvait y arriver à condition de regarder les choses d’une certaine manière. Des années plus tard, lorsque j’ai débuté dans l’enseignement, j’ai tenté de communiquer cette conception du dessin à mes élèves. Ma démarche a remporté peu de succès et, à mon grand désespoir, dans une classe d’une trentaine d’élèves, quelques- uns seulement apprenaient à bien dessiner. J’ai alors essayé de m’observer intérieurement, cherchant à savoir ce que je faisais pour voir les choses différemment quand je dessinais. Je me suis également placée du point de vue des élèves. J’ai alors remarqué que les rares étudiants qui avaient réussi à apprendre le dessin ne s’étaient pas améliorés progressivement mais plutôt de manière subite et radicale, Une semaine ils en étaient encore à tâtonner avec des images stéréotypées et infantiles et la semaine suivante ils dessinaient correctement. Je me moquais des élèves : « Que faites-vous donc de plus aujourd’hui pour ne plus commettre les erreurs de la semaine passée ? ». Presque invariablement, les élèves répondaient simplement qu’ils « se contentaient de regarder les choses ». Je pouvais leur poser autant de questions que je voulais, ils n’arrivaient pas à trouver les mots pour décrire précisément ce qui avait changé dans leur manière de faire. J’ai alors découvert un nouvel indice. J’ai toujours eu recours aux démonstrations pendant mes cours, pour expliquer à mes élèves ce que je faisais — ce que je regardais, pourquoi je dessinais les choses de telle façon. II m’arrivait souvent de m’arrêter au milieu d’une phrase. J’entendais ma voix s’interrompre et je voulais reprendre ma phrase, mais je devais faire un effort terrible pour trouver les mots — et de toute façon, je ne le souhaitais plus. Enfin, me ressaisissant,je reprenais mon exposé — et je m’apercevais alors que j’avais perdu le contact avec mon dessin qui, subitement, me paraissait compliqué et difficile. Cette nouvelle découverte allait me mettre un peu plus sur la voie: je pouvais soit parler soit dessiner, mais je ne pouvais pas faire les deux à la fois. 3 D’autres indices allaient se présenter, souvent par hasard, qui me feraient comprendre le mystère. Un jour, alors que mes élèves peinaient sur un dessin de personnage, j’ai fait circuler un dessin de maître et j’ai eu soudain l’idée de leur faire copier ce dessin à l’envers. Ils ont placé la reproduction la tête en bas et l’ont copiée de cette façon. A ma grande surprise, et à celle des élèves, les dessins étaient excellents. Je n’y comprenais rien. Les lignes, après tout, restaient les mêmes, que l’image soit à l’envers ou à l’endroit. Pourquoi fallait-il que les élèves dessinent plus facilement une image orientée de manière inhabituelle ? En travaillant sur les espaces négatifs,j’ai relevé de nouvelles indications — et soulevé de nouvelles questions aussi. Je me suis aperçue que les étudiants dessinaient mieux non pas en observant la forme qu’ils souhaitaient représenter. mais en observant les surfaces qui entouraient cette forme. Une fois de plus, je m’interrogeais. Pourquoi dessine-t-on mieux les formes en observant les espaces qui les entourent ? J’ai continué d’observer ma propre manière de dessiner mais la réponse au problème, le principe fondamental ultime, continuait de m’échapper. Il y a environ une dizaine d’années, je me suis mise à lire une série d’ouvrages concernant les études que Roger W. Sperry et ses associés ont réalisées sur des commissurotomisés pendant les années cinquante et soixante au California Institute of Technology. En résumé, le Groupe Cal Tec a montré que les deux hémisphères du cerveau humain se caractérisent par des fonctions cognitives supérieures et que ces deux hémisphères emploient des méthodes — ou modes — différents pour traiter les informations. Ces travaux ont soudain fait la lumière dans mon esprit. L’aptitude d’un individu au dessin venait peut-être essentiellement de sa faculté à adopter une manière inhabituelle de traiter les informations visuelles, c’est-à-dire l’aptitude à passer d’une méthode verbale et analytique (appelée « mode gauche » ou « mode-G » dans cet ouvrage) à une méthode spatiale et globale (que j’appelle « mode droit » ou « mode-D »). Grâce à cette découverte, les différentes pièces du puzzle ont pris leur place et j’ai compris pourquoi certains élèves arrivaient à mieux dessiner que d’autres. Depuis lors, et plus particulièrement pendant mon travail de doctorat, j’ai formulé le principe de base et établi les séries d’exercices qui constituent cet ouvrage. Le principe de base est le suivant: il est possible d’apprendre à dessiner en adoptant une nouvelle manière de voir, c’est- à-dire en faisant appel aux fonctions spécifiques de l’hémisphère droit du cerveau, et les exercices qui suivent sont conçus dans ce but. Je suis certaine qu’un jour, ma méthode d’enseignement par conversion cognitive, qui encourage une translation mentale à partir d’un mode de pensée verbal et logique vers un mode plus global et intuitif, sera reprise et améliorée par les professeurs et chercheurs dans le domaine des arts et appliquée à d’autres secteurs. Quel que soit le degré de latéralisation cérébrale que la recherche à venir déterminera, c’est-à-dire le degré de spécialisation des fonctions du cerveau en ce que j’ai nommé mode gauche et mode droit, les deux modes cognitifs et les principes sous-jacents que je décris ici se sont avérés utiles pour les étudiants à tous les niveaux et ont. dès lors, été retenus. Sous sa forme actuelle, cette théorie m’a permis d’élaborer une méthode d’enseignement qui réponde à mon problème de départ: comment permettre à tous les étudiants et non à quelques-uns seulement, d’apprendre la technique du dessin ? 4 5 1. Le dessin et l’art de rouler à bicyclette Fig. l-l. Bison mugissant. Peinture rupestre paléolithique des grottes d’Altamira en Espagne. Dessin de Brevil. Les artistes préhistoriques étaient probablement censés détenir des pouvoirs magiques. Le dessin est un processus curieux, tellement lié aux perceptions visuelles que les deux peuvent difficilement être dissociés. Pour dessiner, il faut être capable de voir les choses à la manière de l’artiste, et cette manière de voir peut merveilleusement enrichir notre existence. A plusieurs égards, enseigner le dessin c’est comme apprendre à quelqu’un à rouler à bicyclette. C’est difficile à expliquer avec des mots. Lorsque vous apprenez à quelqu’un à rouler à vélo, vous dites : « Il suffit de monter sur le vélo, de pousser les pédales, et c’est parti». Bien sûr, cela n’explique pas tout, et il est probable que vous finissiez par intervenir : « Je vais monter sur le vélo et te montrer. Regarde comment je fais ». Il en va de même pour le dessin. La plupart des uploads/s3/ dessiner-grace-au-cerveau-droit-betty-edwards-introduction-a-la-pratique-du-dessin-pour-nul-bon-debutant-artiste-professionnel 1 .pdf
Documents similaires



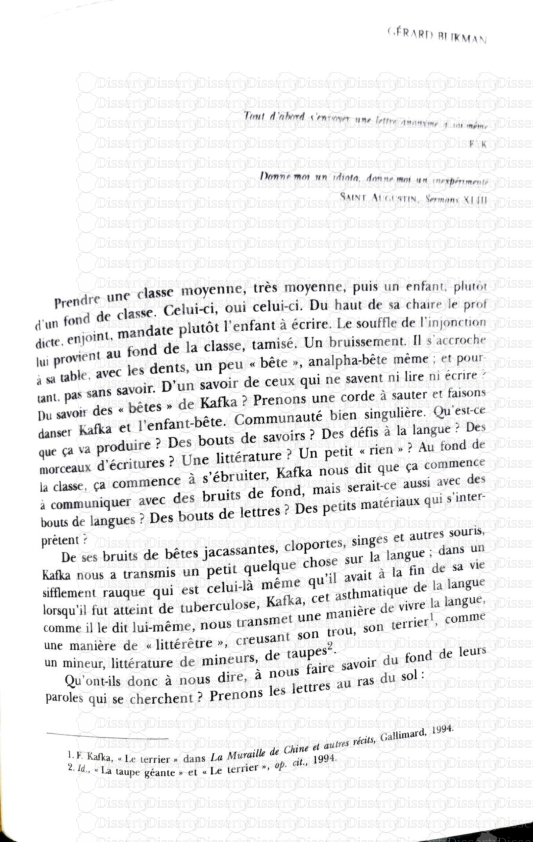






-
42
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 18, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 5.4541MB


