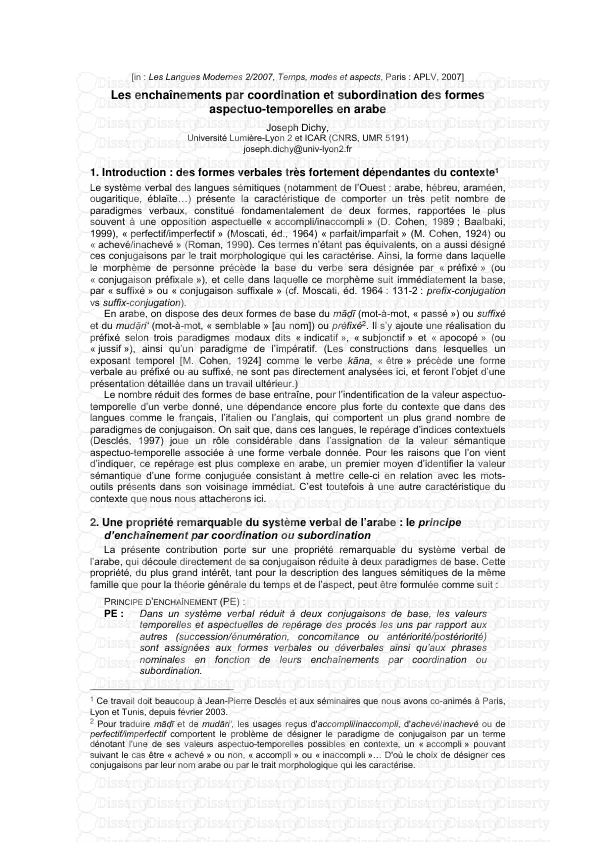[in : Les Langues Modernes 2/2007, Temps, modes et aspects, Paris : APLV, 2007]
[in : Les Langues Modernes 2/2007, Temps, modes et aspects, Paris : APLV, 2007] Les enchaînements par coordination et subordination des formes aspectuo-temporelles en arabe Joseph Dichy, Université Lumière-Lyon 2 et ICAR (CNRS, UMR 5191) joseph.dichy@univ-lyon2.fr 1. Introduction : des formes verbales très fortement dépendantes du contexte1 Le système verbal des langues sémitiques (notamment de l’Ouest : arabe, hébreu, araméen, ougaritique, éblaïte…) présente la caractéristique de comporter un très petit nombre de paradigmes verbaux, constitué fondamentalement de deux formes, rapportées le plus souvent à une opposition aspectuelle « accompli/inaccompli » (D. Cohen, 1989 ; Baalbaki, 1999), « perfectif/imperfectif » (Moscati, éd., 1964) « parfait/imparfait » (M. Cohen, 1924) ou « achevé/inachevé » (Roman, 1990). Ces termes n’étant pas équivalents, on a aussi désigné ces conjugaisons par le trait morphologique qui les caractérise. Ainsi, la forme dans laquelle le morphème de personne précède la base du verbe sera désignée par « préfixé » (ou « conjugaison préfixale »), et celle dans laquelle ce morphème suit immédiatement la base, par « suffixé » ou « conjugaison suffixale » (cf. Moscati, éd. 1964 : 131-2 : prefix-conjugation vs suffix-conjugation). En arabe, on dispose des deux formes de base du mādī (mot-à-mot, « passé ») ou suffixé et du mudāri‘ (mot-à-mot, « semblable » [au nom]) ou préfixé2. Il s’y ajoute une réalisation du préfixé selon trois paradigmes modaux dits « indicatif », « subjonctif » et « apocopé » (ou « jussif »), ainsi qu’un paradigme de l’impératif. (Les constructions dans lesquelles un exposant temporel [M. Cohen, 1924] comme le verbe kāna, « être » précède une forme verbale au préfixé ou au suffixé, ne sont pas directement analysées ici, et feront l’objet d’une présentation détaillée dans un travail ultérieur.) Le nombre réduit des formes de base entraîne, pour l’indentification de la valeur aspectuo- temporelle d’un verbe donné, une dépendance encore plus forte du contexte que dans des langues comme le français, l’italien ou l’anglais, qui comportent un plus grand nombre de paradigmes de conjugaison. On sait que, dans ces langues, le repérage d’indices contextuels (Desclés, 1997) joue un rôle considérable dans l’assignation de la valeur sémantique aspectuo-temporelle associée à une forme verbale donnée. Pour les raisons que l’on vient d’indiquer, ce repérage est plus complexe en arabe, un premier moyen d’identifier la valeur sémantique d’une forme conjuguée consistant à mettre celle-ci en relation avec les mots- outils présents dans son voisinage immédiat. C’est toutefois à une autre caractéristique du contexte que nous nous attacherons ici. 2. Une propriété remarquable du système verbal de l’arabe : le principe d’enchaînement par coordination ou subordination La présente contribution porte sur une propriété remarquable du système verbal de l’arabe, qui découle directement de sa conjugaison réduite à deux paradigmes de base. Cette propriété, du plus grand intérêt, tant pour la description des langues sémitiques de la même famille que pour la théorie générale du temps et de l’aspect, peut être formulée comme suit : PRINCIPE D’ENCHAÎNEMENT (PE) : PE : Dans un système verbal réduit à deux conjugaisons de base, les valeurs temporelles et aspectuelles de repérage des procès les uns par rapport aux autres (succession/énumération, concomitance ou antériorité/postériorité) sont assignées aux formes verbales ou déverbales ainsi qu’aux phrases nominales en fonction de leurs enchaînements par coordination ou subordination. 1 Ce travail doit beaucoup à Jean-Pierre Desclés et aux séminaires que nous avons co-animés à Paris, Lyon et Tunis, depuis février 2003. 2 Pour traduire mād̫ī et de mudāri‘, les usages reçus d'accompli/inaccompli, d'achevé/inachevé ou de perfectif/imperfectif comportent le problème de désigner le paradigme de conjugaison par un terme dénotant l'une de ses valeurs aspectuo-temporelles possibles en contexte, un « accompli » pouvant suivant le cas être « achevé » ou non, « accompli » ou « inaccompli »… D'où le choix de désigner ces conjugaisons par leur nom arabe ou par le trait morphologique qui les caractérise. J. Dichy - Enchaînements par coordination et subordination des formes aspectuo-temporelles en arabe – 2 – On pourrait croire en première approximation que cette propriété mise au jour à partir de mon travail de 1989 (voir aussi Dichy, 1997), pourrait être ramenée à l’idée que les valeurs aspectuo-temporelles des formes verbales sont repérées les unes par rapport aux autres au sein d’un énoncé. Le caractère relatif des formes verbales – l’antériorité, la postériorité ou la concomitance des procès verbaux les uns par rapport aux autres –, était déjà partiellement présent dans la grammaire de Wright (1898, II, § 3 D), ainsi que chez M. Cohen (1924). Il est analysé par Comrie (1985, p. 22 et 63-64) et différemment Abi Aad (2001, p. 152-162). Ayoub (1996, p. 705-716) met au jour des relations de repérage et de subordination entre procès verbaux inclus dans une même phrase, mais sans opposer subordination et coordination. Ben Gharbia (1996, p. 371-386) propose une analyse de la relation entre coordination et subordination au moyen du mot-outil wa- (« et »), et éclaire le fonctionnement, en particulier, de la « phrase circonstancielle » (ğumla hāliyya). Roman (2001, p. 559-561) observe également qu’ « une succession temporelle discordante » peut « révoquer » la coordination par wa- entre deux phrases. Or le principe d’enchaînement ci-dessus et le jeu de règles qui en découle ne se laissent par réduire à la seule analyse du caractère relatif des « temps » verbaux, et permettent de reprendre en les systématisant plusieurs aspects des analyses que l’on vient de citer. Ils résultent en effet de la mise en relation de deux observations : – le fait que le système verbal de l’arabe est construit, comme on l’a vu, sur deux conjugaisons de base ; – l’opposition, générale en syntaxe, entre coordination et subordination. Le coordonnant le plus fréquent en arabe, wa-, « et », a justement pour propriété, comme on le verra, de se trouver en position de subordonnant dans certains contextes. C principe constitue le corollaire systématique de la structure à deux paradigmes verbaux de l’arabe et le complément nécessaire de la description des valeurs aspectuelles et temporelles associées aux formes verbales. Je partirai, pour la clarté de l’exposé et pour des raisons de méthode, de deux brefs extraits de textes contemporains, dus au romancier N. Mahfouz. 3. Deux extraits de Naguib Mahfouz Ces deux extraits sont présentés ci-dessous sous forme de tableaux : – La première colonne comporte des numéros, qui permettront les renvois. – La seconde reproduit le texte arabe en transcription, les indentations représentant les liens de coordination (indentation de même niveau) ou de subordination (indentation décalée d’un cran) ; les traits en pointillés séparent les propositions relevant de la même phrase ; les traits pleins marquent les frontières de phrase (voir ci-dessous les conventions de ponctuation). – La troisième colonne indique la forme du verbe ou du déverbal, ou lorsque c’est le cas, la structure nominale de la phrase (jumla)3, selon les conventions ci-dessous. Les formes correspondantes sont en caractères gras dans les deuxième et quatrième colonnes. – La dernière colonne reproduit la structure du texte arabe, en traduction française. Cette dernière est un compromis entre un mot-à-mot reflétant les constructions du texte arabe et un rendu en langue française permettant au lecteur non-arabisant de comprendre le texte. Conventions : a) Ponctuation La ponctuation en arabe répond plus à une fonction expressive qu’à une fonction de communication. Elle reflète en tout état de cause fort mal le découpage syntaxique des textes et des phrases (l’usage syntaxique de la virgule en est notamment absent). De ce fait, j’ai respecté ci-dessous la ponctuation des deux éditions – parues à vingt ans de distance – auxquelles j’ai accès. Cette ponctuation, qui se trouve être la même, pourrait être originelle. Il va de soi que d’autres découpages, entraînant d’autres liens de subordination, seraient possibles. 3 La tradition linguistique arabe médiévale, suivie en cela par les grammaires modernes et les travaux linguistiques contemporains, englobe dans le terme de phrase (ğumla) ce qui est appelé en français phrase ou proposition. Il en est ainsi dans ce travail. On lira donc, par exemple, « phrase principale » et « phrase subordonnée ». J. Dichy - Enchaînements par coordination et subordination des formes aspectuo-temporelles en arabe – 3 – Il y a ci-dessous trois symboles de ponctuation : • correspond à une virgule dans le texte arabe. Celle-ci – lorsqu’elle est présente – se trouve coïncider ici avec une frontière de phrase, mais cet usage n’est pas généralisable ; ● représente un point ; ●● reproduit un point suivi d’une fin de paragraphe. b) Catégories de prédicats affectés d’une valeur aspectuo-temporelle (liste limitée aux formes apparaissant dans les tableaux ci-dessous) : Préf. Forme conjuguée au paradigme du préfixé, ou mudāri‘. Le mode est le mode réel (dit, dans la conjugaison du préfixé, « indicatif », marfū‘). Préf. subj. Comme pour Préf., le verbe étant au mode non réel et à la conjugaison au préfixé « subjonctif » (mudāri‘ mansūb). Suf. Forme au suffixé, mādī. Suf. (inv.) Forme morphologiquement au préfixé apocopé, précédée de la négation lam, mais dont la valeur, dans le système uploads/s3/ dichy-j-temps-aspect-langues-modernes-v2bis-bib-libre.pdf
Documents similaires










-
74
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 07, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2849MB