Tous droits réservés © Protée, 2001 Ce document est protégé par la loi sur le d
Tous droits réservés © Protée, 2001 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ Document généré le 16 juin 2020 09:39 Protée L’aménagement d’un espace habitable Giorgio Grignaffini et Eric Landowski La société des objets. Problèmes d’interobjectivité Volume 29, numéro 1, 2001 URI : https://id.erudit.org/iderudit/030612ar DOI : https://doi.org/10.7202/030612ar Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) Département des arts et lettres - Université du Québec à Chicoutimi ISSN 0300-3523 (imprimé) 1708-2307 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Grignaffini, G. & Landowski, E. (2001). L’aménagement d’un espace habitable. Protée, 29 (1), 17–22. https://doi.org/10.7202/030612ar Résumé de l'article Aménager son appartement constitue une expérience des plus intéressantes du point de vue de l’étude de l’interobjectivité. Un véritable dialogue s’y noue entre sujets et objets, ainsi qu’entre les objets eux-mêmes, appelés à cohabiter en un même espace. La problématique ici proposée se concentre surtout sur la dialectique entre esthétique et fonctionnalité qui préside au choix des objets, sur le double rôle de l’espace, précondition du sens en même temps qu’objet parmi les autres, sur certains effets de rimes entre formes, couleurs ou matériaux entrant dans la composition des objets, et sur diverses questions liées à la notion de style en tant que dimension intervenant dans les modes de la coprésence interobjective. 17 ESPACE HABITABLE PROTÉE, PRINTEMPS 2001 – page 17 L’AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE HABITABLE GIORGIO GRIGNAFFINI et ERIC LANDOWSKI Aménager sa maison, son appartement –␣un lieu d’habitation, quel qu’il soit␣–, c’est s’efforcer de mettre au point un projet unique et si possible cohérent à partir d’un grand nombre d’éléments hétéroclites. C’est essayer de coordonner des choix rationnels, économiques et fonctionnels, avec des états d’âme et des passions, c’est chercher à concilier les motivations esthétiques relevant des goûts individuels avec des déterminations d’ordre collectif découlant des fluctuations de la mode. Et c’est aussi une pratique qui nous amène à attribuer du sens au monde qui nous entoure, un monde constitué d’objets capables de nouer entre eux, et avec nous, des relations signifiantes. Une analyse sémiotique de l’aménagement intérieur d’un appartement peut a priori être conçue de deux manières. On peut se donner pour but de dégager des régularités organisant les relations entre objets coprésents à l’intérieur d’un espace donné, déjà structuré et habité, ou prêt à l’être, auquel cas on travaillera sur le résultat d’un processus d’aménagement présupposé. Ou bien on peut se proposer d’étudier le processus même d’aménagement, c’est-à-dire l’enchaînement, considéré comme en cours, des étapes qui conduiront au résultat final. En adoptant ici la seconde de ces perspectives, nous chercherons à rendre compte d’une sorte de partie, ou de dialogue, où se confrontent, d’un côté, les projets, les choix, le désir d’un sujet, et de l’autre, les résistances, les réactions, les contrecoups des objets. Effectivement, les décisions stratégiques et les coups tactiques du sujet ne s’effectuent pas face à des objets sémiotiquement passifs␣: au contraire, ces derniers entrent eux aussi dans la partie en assumant leurs propres rôles, polémiques ou contractuels, par rapport à «␣nous␣», les sujets. 1. SUJETS ET OBJETS La dimension stratégique de l’aménagement se définit sur la base d’un projet implicite concernant le mode et le style d’utilisation à venir de l’espace habitable. La «␣performance␣» en quoi consiste l’activité d’aménagement de l’espace peut, en effet, s’analyser comme une série d’opérations permettant de passer de divers programmes virtuels, définis à l’avance par un sujet, à une matière sensible (formes, couleurs, espaces, lumières, matériaux, etc.) concrétisant ces programmes. 18 Inversement, à partir du résultat final, c’est-à-dire de l’espace aménagé, on devrait pouvoir reconstituer les différents programmes narratifs pris en charge par le sujet au long du parcours ayant mené du projet initial à sa réalisation concrète. Pour mieux rendre compte de ce type de processus, nous ferons appel à la théorie de l’énonciation. En sémiotique, l’énonciation est conçue comme un faire permettant l’actualisation de virtualités inscrites sur la dimension paradigmatique, c’est-à-dire, en termes saussuriens, sur le plan de la «␣langue␣». Nous trouvons effectivement, dans notre cas, une situation de ce type␣: les éléments de décoration –␣meubles, lumières, espaces␣– représentent, une fois articulés entre eux, le niveau de l’énoncé, alors que l’énonciation correspond en l’occurrence à la mise en syntagme et à l’actualisation de ces éléments. L’aménagement, en tant que processus, coïncide donc avec une sélection d’éléments à choisir dans un paradigme d’options. Toutefois, ce qui précède doit être nuancé, dans la mesure où nous faisons en même temps l’hypothèse que le sujet de l’énonciation, l’instance qui réalise le passage du virtuel à l’actuel, ne s’identifie pas purement et simplement à l’instance qui définit stratégiquement le projet d’aménagement, mais inclut aussi les objets eux-mêmes. L’énonciation consiste donc, ici, en un jeu de relations multiples et réciproques entre sujets et objets, ainsi qu’entre objets (et bien sûr, aussi, entre sujets, ne serait-ce que du simple fait que le sujet-«␣décorateur␣» ne se confond pas toujours avec le sujet-«␣habitant␣»). De fait, on voit immédiatement que, par exemple, les meubles d’un appartement, de par leurs formes, leurs matières et leur disposition dans l’espace, construisent à eux seuls une sorte de simulacre de l’habitant à venir, en préfigurant et même dans une certaine mesure en prédéterminant certains mouvements et parcours, physiques ou cognitifs, esthétiques ou passionnels. D’où cette capacité qu’il nous faut reconnaître aux objets de réagir aux choix du sujet, qu’il s’agisse de contribuer à leur mise en œuvre, ou de s’y opposer. 2. L’ESPACE ET LES FONCTIONS Le problème sera alors de savoir de quelle manière les objets interagissent entre eux et comment s’effectue ce qu’on pourrait appeler la «␣sémiose parallèle␣» qu’ils réalisent en relation, et quelquefois en opposition, avec celle mise en œuvre par les sujets. Auparavant toutefois, il nous faut prendre en compte certaines des préconditions qui s’imposent à toute activité d’aménagement d’un espace habitable. Par définition, toutes les étapes du processus se dérouleront dans l’espace, et plus précisément dans un espace dès le départ strictement circonscrit␣; l’aménagement, somme toute, n’est pas autre chose que le remplissement, plus ou moins dense, d’un espace borné, à l’aide d’une série déterminée d’objets. Toutefois, l’espace n’est pas seulement un fond neutre, récepteur et «␣insensible␣» aux choix du sujet. Objet parmi d’autres, il joue un rôle à part entière, et même de premier plan, dans le dialogue interobjectif, ne serait-ce que parce que lui-même en sortira transformé, ou pour le moins resémantisé. Choisir un style d’aménagement, c’est toujours, en effet, «␣ré- écrire␣» d’une certaine manière un espace donné en lui conférant un sens nouveau. De ce point de vue, les espaces et les objets sont des éléments à la disposition du sujet –␣du «␣décorateur␣», professionnel ou non␣– pour réaliser des programmes narratifs relatifs à la vie domestique dans ses différentes fonctions (pratiques, ludiques, etc.)␣; mais en même temps, ce sont aussi de véritables agents, à même de construire des relations signifiantes autonomes, découlant directement de leurs formes propres, de leurs couleurs, de leur localisation précise, etc. L’espace s’analyse par conséquent à la fois comme une précondition et comme un résultat de l’activité décoratrice. En tant que précondition, il n’est certes pas encore investi d’un contenu sémantique précis. Mais il n’en est pas moins déjà lourd d’orientations potentielles␣: la dimension, la forme de l’espace disponible, la manière dont il se répartit constituent une sorte de champ de possibilités multiples mais non infinies, modulables selon différentes configurations. Par ailleurs, en tant qu’espace signifiant, l’espace 19 apparaît au contraire comme le résultat des opérations d’aménagement␣: espace mis en valeur selon certaines modalités spécifiques et qualifié par les objets qu’il accueille, et en même temps espace «␣objet␣» parmi les objets, dans la mesure où lui-même devient un élément fonctionnel parmi d’autres dans le cadre de programmes conçus par les sujets qui y habiteront. Dans «␣Pour une sémiotique topologique␣», Greimas développe l’opposition entre étendue et espace␣: […] l’étendue [...], remplie d’objets naturels et artificiels, présentifiée par nous, par toutes les voies sensorielles, peut être considérée comme la substance qui, une fois informée et transformée par l’homme, devient l’espace, c’est-à-dire la forme, susceptible, du fait de ses articulations, de servir en vue de la signification.␣1 Le cadre architectural de l’habitat, tel qu’il est donné au départ et tant qu’il n’est pas encore aménagé, correspond de toute évidence au premier pôle de l’opposition, à l’étendue, cette «␣substance␣» encore dépourvue de signifiés. Et c’est seulement à l’issue du procès de «␣décoration␣» qu’on aura affaire à un espace présentant le statut de ce qu’on appelle, en termes sémiotiques, une «␣forme␣». Le problème spécifique qui se pose pour nous est de savoir dans quelle mesure la «␣substance␣» en question prédétermine la «␣forme␣» finale␣: d’un côté, il est clair, par exemple, qu’un élément comme la dimension d’un appartement est un paramètre extrêmement contraignant, sur uploads/s3/ l-x27-amenagement-d-x27-un-espace-habitable-giorgio-grignaffini-et-eric-landowski.pdf
Documents similaires

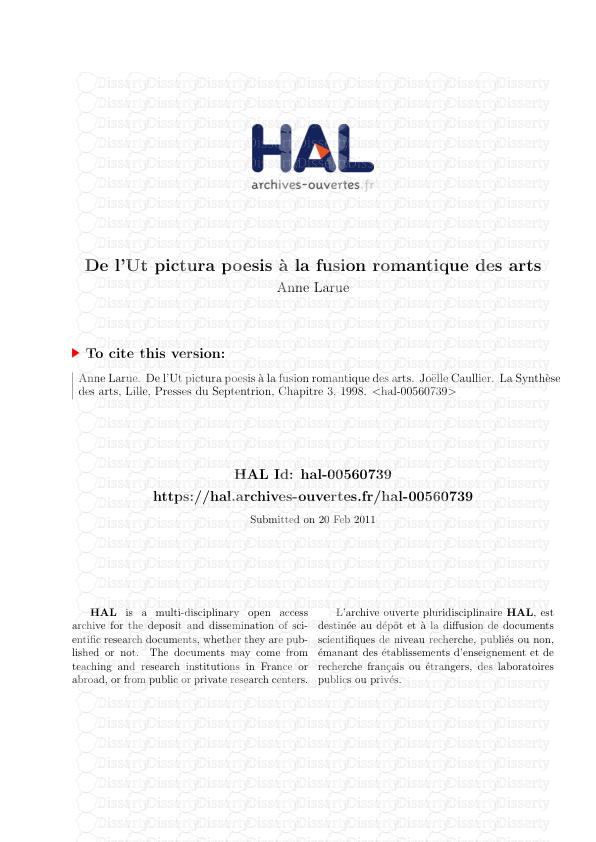








-
54
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 03, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1310MB


