Retrouver ce titre sur Numilog.com Des artistes, à la fin des années soixante,
Retrouver ce titre sur Numilog.com Des artistes, à la fin des années soixante, s'écartent délibé- rément des lieux consacrés, ateliers, galeries, musées, pour se confronter à l'immensité des déserts, ou pour piéger, dans leurs observatoires, les mouvements du cosmos. Certains font de la marche dans le paysage l'essence même de leur art, d'autres s'adonnent à la lente élaboration d'un jardin. D'autres encore expriment, à travers des œuvres éphémères, dont seule la photographie conservera la trace, leur inquié- tude pour un environnement de plus en plus menacé. Dans l'affrontement prométhéen ou la rêverie fusionnelle, tantôt s'inspirant des pensées primitives, tous contribuent à instaurer; au-delà de la traditionnelle peinture de paysage, des rapports nouveaux entre l'art et la nature. Dans une étude introductive, Colette Garraud propose une vision synthétique, à travers les courants contemporains, de la façon dont les artistes pensent aujourd'hui la nature. Dix d'entre eux particulièrement représentatifs par la diversité de leurs approches font ensuite l'objet de courtes monogra- phies : Joseph Beuys, Walter De Maria, lan Hamilton Finlay, Hamish Fulton, Paul-Armand Gette, Andy Goldsworthy, Wolfgang Laib, Richard Long, Giuseppe Penone, Robert Smithson. Colette Garraud, historienne d'art, est professeur à l'École Nationale Supérieure d'Arts de Cergy. Retrouver ce titre sur Numilog.com L'idée de nature dans l'art contemporain Retrouver ce titre sur Numilog.com C o l e t t e G a r r a u d Retrouver ce titre sur Numilog.com L ' i d é e d e n a t u r e d a n s l ' a r t c o n t e m p o r a i n Ouvrage publié en coédition avec le Centre National des Arts Plastiques Collection dirigée par Bernard Marcodé La Création contemporaine Flammarion Retrouver ce titre sur Numilog.com Je remercie, en regrettant de ne pouvoir tous les nommer ici, les artistes et les galeries qui nous ont obligeamment fourni les illustrations, Maud Fischer- Osostowicz, documentaliste, qui les a réunis, Pascale Ogée qui a assuré la conception graphique de l'ouvrage, ainsi qu'Anne Sefrioui qui en a entière- ment supervisé la réalisation. Je remercie également Juliette Blanchet, Catherine Lobstein qui a bien voulu relire mon texte, et tout particulièrement Bernard Marcadé pour avoir pris l'initiative de me demander ce livre. @ Adagp 1993 pour les œuvres de C. Andre, J. Beuys, M. Raetz, R. Serra, C. Simonds @ Spadem 1993 pour les œuvres de J. Clareboudt, J. Dibbets, D. Nash @ Flammarion, Paris, 1993 Tous droits réservés ISBN 2-08-011002-0 N° d'édition : 0744 Retrouver ce titre sur Numilog.com Sommaire Sortir de l'atelier 8 Les déserts de l'Ouest 13 Le corps comme outil et comme image 22 L'observatoire 32 Sculptures 40 Dessiner avec la nature 51 « Peut-on encore peindre un paysage ? » 60 Paysage, perspective et photographie 63 La « pensée sauvage » 71 L'éphémère, le transitoire et la ruine 73 La disparition 79 Parcs et jardins 84 MONOGRAPHIES Joseph Beuys 99 Walter De Maria 109 Ian Hamilton Finlay 117 Hamish Fulton 127 Paul-Armand Gette 137 Andy Goldsworthy 144 Wolfgang Laib 151 Richard Long 159 Giuseppe Penone 167 Robert Smithson 174 Notes 183 Index 188 Bibliographie 189 Retrouver ce titre sur Numilog.com Retrouver ce titre sur Numilog.com Gilles Richard, Volume en forme de croix de lumière rouge dérivant la nuit sur le lac. Juillet 1989. Structure flottante, néons. Centre d'art contemporain de Vassivière-en-Limousin. « Nous sommes entourés de choses que nous n'avons pas créées et qui ont une vie et une structure dif- férentes des nôtres : les arbres, les fleurs, les prairies, les rivières, les collines, les nuages... Pendant des siècles, elles ont été pour l'homme objet de plaisir, aussi bien que de curiosité et d'effroi [...] Elles ont constitué à la longue une entité à laquelle nous avons donné le nom de nature, et c'est à travers la pein- ture de paysage que nous pouvons saisir les diverses formes qu'a prises notre sentiment de la naturel » (Kenneth Clark, L'Art du paysage). Que faut-il entendre en effet par « nature » ? Dans sa simplicité, l'énumération avancée par Kenneth Clark, dès les premières lignes d'un ouvrage qui fait toujours autorité, lui permet de contour- ner une approche philosophique par trop théorique, et d'entraîner un consensus au moins apparent sur l'objet même du propos. Elle n'est pas, pour autant, innocente. D'emblée, elle nous place à une distance des choses déterminée et fixe. Toutes les composantes évoquées le sont dans leurs formes lointaines et non dans leur ordre et leurs lois propres, traditionnellement objets de la physis : par une sorte de tau- tologie implicite, ce que l'on nous décrit comme un morceau de nature, c'est déjà une peinture de pay- sage. Tant il est vrai que, comme le disait Oscar Wilde, c'est la nature - ou du moins la perception que nous en avons - qui imite l'art, et non le contraire. La traduction du texte de Kenneth Clark introduit, par un glissement significatif, la notion de « sentiment de la nature » (l'original disait conception of nature). Ce qu'il est, en effet, convenu d'appeler dans la tradition occidentale « sentiment de la nature » se retrouvera encore souvent, sous une forme moderne fortement infléchie par l'inquiétude écologique, au cœur des préoccupations des artistes contemporains. Souvent, mais pas toujours, il s'en faut : une certaine défiance à l'égard de l'élan fusion- nel, le souci de fonder le geste artistique dans les concepts davantage que dans les émotions, le déclin, avec celui des croyances religieuses, et plus généralement des « idéologies naturalistes2 », de la possi- bilité de penser la nature comme une totalité, tous ces facteurs font qu'il semblera parfois plus juste de parler d'une « idée de nature » plutôt que d'un « sentiment ». Si l'on s'en tient à la formulation de Kenneth Clark, non seulement la principale, mais presque la seule expression plastique de cette idée serait la peinture de paysage. Or celle-ci, dont il retrace l'his- toire à travers la culture occidentale, a aujourd'hui, sinon complètement disparu, du moins largement cédé le pas, pour l'essentiel, à la sculpture, dans un sens élargi du terme, aux installations et aux envi- ronnements, aux actions engageant le corps de l'artiste, à la photographie, et à toutes les combinaisons possibles entre ces formes d'art. Retrouver ce titre sur Numilog.com L'énoncé « peinture de paysage » impliquait, bien entendu, la relation de représentation, la mime- sis. Il est clair que la crise qu'a connue cette notion dans l'art du xxe siècle a été décisive, et qu'elle fut probablement la cause du relatif effacement de la nature comme « thème » avant son retour specta- culaire sur la scène artistique, vers le milieu des années soixante, selon des modalités tout à fait nou- velles : parmi celles-ci, la pratique, qui va se généraliser, de la manipulation des objets naturels et de leur introduction dans les espaces consacrés, galeries ou musées, ou des interventions in situ, au sein de la nature elle-même. (Le fait de prendre le paysage comme support et non plus comme modèle n'écar- tant pas pour autant la question de la mimesis, en raison du rôle déterminant, on le verra, de la pho- tographie.) Enfin, l'intitulé même de l'ouvrage de Kenneth Clark, L'Art du paysage (Landscape into Art) qui traite exclusivement de peinture, se fonde sur le fait que le mot « paysage », comme d'ailleurs le mot Landscape, désigne indifféremment la réalité ou sa représentation - alors qu'il n'en va pas de même pour les vocables « portrait » ou « nature morte ». S'agissant des mouvements artistiques actuels, on remarquera que, par un déplacement sémantique qui ne saurait relever de la simple coïncidence, l'expression « art du paysage » apparaît quelquefois dans la critique comme un équivalent approxi- matif du mot Land Art, et désigne en tout cas le plus souvent un art qui s'exerce physiquement dans le paysage. Sortir de l'atelier Les chiffres en marge du texte renvoient aux pages où sont reproduites les œuvres. À la fin des années soixante, l'esprit de révolte de la jeune génération manifesté partout se traduit plus particulièrement dans une mise en cause radicale du système marchand et des circuits traditionnels atelier-musée-galerie. « Le musée, dit Smithson, sape notre confiance dans les données des sens. [...] L'art s'installe dans une prodigieuse inertie [...], les choses s'aplatissent et se fanent3. » C'est la même lassitude devant la surabondance d'oeuvres, la même inquiétude devant une scène artistique engorgée, le même sentiment que « les musées, les collections sont bondés4 », que « les planchers s'écroulent », qui conduira de nombreux artistes américains et européens - essentiellement anglais - à quitter l'espace confiné de leurs ateliers pour le land, le sol, le terrain, le paysage. Il serait pour le moins hâtif de parler d'un « retour à la nature ». Les formes artistiques outdoors les plus diverses émergent dans ces années-là, et le dessein de sortir des lieux consacrés n'amène pas nécessairement les artistes sur des territoires vierges, mais suscite aussi de nouvelles formes d'inter- ventions en milieu urbain. Pour ceux uploads/s3/ l-x27-idee-de-nature-ds-l-x27-art-contemporain.pdf
Documents similaires





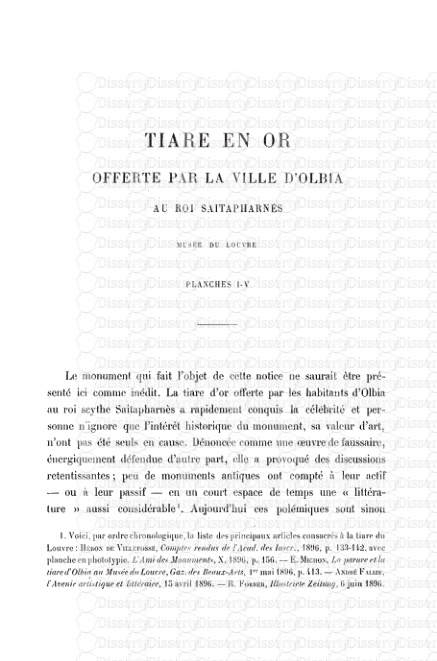




-
18
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 08, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.9100MB


