1 Les techniques de l’expression écrite et orale 1ere année ST 2 Les techniques
1 Les techniques de l’expression écrite et orale 1ere année ST 2 Les techniques de l’expression écrite et orale 1ere année ST Table des matières QU'EST CE QUE L'EXPRESSION ORALE I LE RAPPORT AU LANGAGE II LE RAPPORT A SOI-MEME III LE RAPPORT AUX AUTRES IV LE RAPPORT AU MONDE EXTERIEUR TECHNIQUES D'EXPRESSION ORALE I LA RESPIRATION II LA VOIX III L'ARTICULATION IV LE RYTHME V LA REPETITION COMMUNICATION NON VERBALE I LES TERRITOIRES II LA DISTANCE INDIVIDUELLE [PROXÉMIE III LES POSTURES IV LES GESTES V LE VISAGE ET LES MIMIQUES VI LE REGARD LE TRAC I DESCRIPTION DU PHENOMENE II COMMENT MAITRISER SON TRAC TECHNIQUES DE L'EXPOSE ORAL I LA PREPARATION DE L'EXPOSE II LA STRUCTURATION DE L'EXPOSE III LE DEROULEMENT DE L'EXPOSE 3 Les techniques de l’expression écrite et orale 1ere année ST QU'EST CE QUE L'EXPRESSION ORALE ? C'est transmettre des messages à l'aide d'un langage en utilisant sa voix et son corps pour communiquer. Cette activité ne peut se comprendre qu'en fonction d'un certain nombre de rapports que l'on entretient avec : - le langage, - soi-même, - les autres, - l'ensemble du monde extérieur. I LE RAPPORT AU LANGAGE Toute langue a une structure particulière qui réagit sur la pensée elle-même. Tous les Francophones ont donc en commun un certain rapport au langage. Chacun entretient avec le langage une relation particulière en fonction de ce qu'il représente pour lui sur le plan affectif . Il peut être associé à de bons ou de mauvais souvenirs [familiaux, scolaires, professionnels...]. Il peut être vécu comme un instrument permettant d'avoir un certain ascendant sur les autres ou au contraire permettant aux autres de vous dominer. Ainsi le rapport que l'on entretient avec le langage est en relation avec l'image que l'on se fait de l'autorité et même de la structure sociale tout entière. II LE RAPPORT A SOI-MEME Une fois que l'on a fait siennes les différentes règles qui s'appliquent à une langue et qui sont communes à son groupe social, (tout groupe social a une façon particulière de parler qui lui sert de signe de reconnaissance), on ne parle qu'en fonction de ce que l'on est soi-même et de la façon dont on se perçoit. Ex. : Une personne plus extravertie parlera fort et fera beaucoup de gestes. Une personne plus introvertie parlera plus posément d'une voix plus faible et plus sourde et fera peu de gestes. On s'utilise aussi soi-même comme instrument : l'expression orale peut être considérée comme une technique instrumentale. - le corps ) - la voix ) sont les instruments par lesquels on s'extériorise. - les gestes ) - les postures ) Les principales difficultés que l'on rencontre résident dans l'image infériorisée que l'on peut avoir de soi qui se traduisent par de la "timidité". 4 Les techniques de l’expression écrite et orale 1ere année ST III LE RAPPORT AUX AUTRES La façon dont on s'exprime dépend de la façon dont on perçoit l'autre et en particulier au travers des statuts et des rôles. Ainsi on ne parle pas de la même façon à : - un frère, - une mère, - un ami, - un collègue, - un supérieur hiérarchique. Si nous avons l'impression que les autres nous sont supérieurs, qu'ils nous jugent, notre façon de nous exprimer en sera affectée. Le rapport aux autres réagit sur le rapport à soi-même et inversement. La principale difficulté là aussi réside dans la façon dont on imagine que les autres nous perçoivent. On a l'impression : - d'être peu considéré, - d'être jugé, - de ne pas susciter ou retenir l'intérêt. On croit parfois que les autres nous sont supérieurs, qu'ils expriment mieux que nous-mêmes ce que nous voudrions dire. IV LE RAPPORT AU MONDE EXTERIEUR Nous sommes insérés dans des structures économiques, politiques et sociales qui nous influencent et avec lesquelles nous entretenons certaines relations de type : - accord, - acceptation, - compromis, - négociation, - refus, - révolte. Ce type de relation influe fortement sur notre mode de communication. 5 Les techniques de l’expression écrite et orale 1ere année ST TECHNIQUES D'EXPRESSION ORALE I LA RESPIRATION - Elle conditionne la bonne émission du son. - Elle favorise la détente musculaire et nerveuse. - Elle est nécessaire à la mise en oeuvre de la fluidité mentale et verbale. On constate trois types de respirations : 1/ THORACIQUE : - Ouverture de la cage thoracique par l'élargissement des côtes seulement. - C'est la respiration la plus connue, celle sur laquelle on concentre son attention automatiquement quand on nous dit de respirer à fond. 2/ VENTRALE : - Le volume de la cage thoracique s'accroît par l'abaissement du diaphragme. - On prend conscience de cette respiration en s'allongeant sur le dos, en plaçant une main sur son ventre et en gonflant son ventre par son inspiration : la main est soulevée. 3/ COSTALE : - C'est le bas des côtes qui se soulève. - On prend conscience de cette respiration en bloquant les précédentes. Pour ce faire s'asseoir sur une chaise à califourchon, les épaules appuyées sur le dossier, les bras ballants. La respiration complète intègre ces trois types de respirations, ce qui n'est pas synonyme de respiration maximum ; on ne doit jamais avoir l'impression de forcer. Positionsquifavorisentlarespiration : - Lorsqu'on est assis derrière une table : laisser la cage thoracique libre (bras croisés à proscrire), considérer la colonne vertébrale comme un axe vertical (le mât d'un bateau) et éviter de se pencher trop en avant ou en arrière. - Que l'on soit assis ou debout toutes les positions FERMEES sont à proscrire. II LA VOIX Elle est le véhicule du message oral. Selon les individus, les dimensions, la forme et la texture des : cordes vocales, os et cartilages, muscles, Le timbre de voix sera très différent. On trouve généralement : les voix de gorge (basses), les voix de masque (appuyées), les voix de tête (élevées). 6 Les techniques de l’expression écrite et orale 1ere année ST Pour trouver son timbre il faut fermer la bouche et produire le son [HM] sorte de [HEIM]. Cette onomatopée donne le timbre de la voix en faisant vibrer les différentes parties de la tête. Le timbre se travaille mais varie peu. En revanche la nécessité pour un orateur consiste à bien placer sa voix. La voix se caractérise aussi par : 1/ L'INTENSITÉ : C'est la force, la puissance avec laquelle on s'exprime. Il convient d'adapter l'intensité de la voix au volume de l'espace de prise de parole et à la disposition de l'auditoire dans cet espace. 2/ L'INTONATION : C'est le mouvement mélodique de la voix, caractérisé par des variations de hauteur. Par exemple, dans la phrase interrogative, il y a une intonation montante : "vous m'entendez ? " En fin de phrase affirmative la voix a tendance à tomber : "nous allons présenter les inconvénients." En public il est indispensable de varier les intonations afin de capter l'attention de l'auditoire. 3/ LE DÉBIT : C'est la vitesse à laquelle on s'exprime. Souvent le trac amène une accélération excessive du débit. Il faut donner du mouvement à l'expression en variant les rythmes, en évitant l'uniformité, en usant du contraste. Pour cela : - respirer entre les phrases, - ménager des pauses pour reprendre le souffle, - utiliser le silence. Ces trois éléments constituent le SYSTEME VOCAL d'un individu et son spectre vocal qui lui est propre [plus fiable que les empreintes digitales pour différencier deux individus]. La voix se caractérise aussi par : - lalargeur du parler ; en allongeant les voyelles, en appuyant sur les syllabes longues et les diphtongues, on peut parler plus loin. - l'accent, il est basé sur les voyelles. III L'ARTICULATION C'est le détachement et l'enchaînement correct des sons et en particulier, la netteté des consommes. Elle peut être déficiente sur : les syllabes d'attaque, les syllabes internes, les finales. Pour corriger ces tendances nuisibles à la bonne compréhension d'un propos, il faut s'entraîner à lire à haute voix en améliorant les mouvements : 7 Les techniques de l’expression écrite et orale 1ere année ST des lèvres, de la langue, des mâchoires. Une mauvaise articulation conduisant à la fusion de deux syllabes consécutives peut provoquer une amphibologie. Ex. : Il frappaà la porte. IV LE RYTHME Les changements de rythmes donnent à la prise de parole sa dynamique ; ils évitent la monotonie. Ils sont donnés par : 1/ La ponctuation : - La ponctuation parlée n'a rien à voir avec la ponctuation écrite. - Lorsqu'on parle on peut s'arrêter àtoutmoment. - Elle apporte du confort à l'écoute. - Elle donne du poids aux mots, aux gestes. 2/ La modulation : Le ton de la voix varie en jouant sur les inflexions en prenant appui sur certains mots, certaines syllabes. On peut prendre appui : - sur le mot sujet ou complément, - sur le verbe qui définit l'action, - sur les mots outils (article, conjonction, pronom, ...). 3/ l'utilisation des uploads/s3/ methodologie-chapitre-2.pdf
Documents similaires




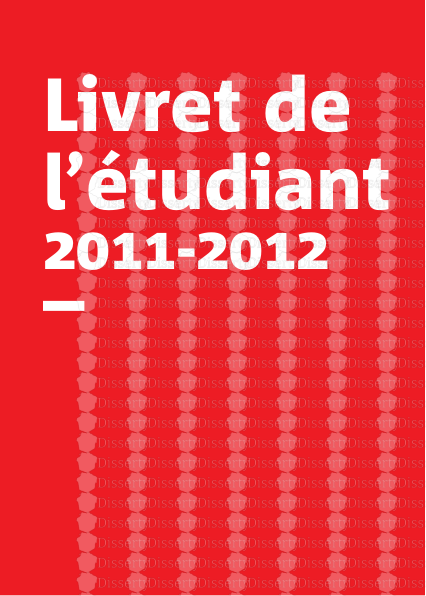





-
74
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 27, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2771MB


