MONNAIES MÉROVINGIENNES DU CENOMANNICUM A M. AttTttUH BERDtAXD, VICE-PRHStDEKT
MONNAIES MÉROVINGIENNES DU CENOMANNICUM A M. AttTttUH BERDtAXD, VICE-PRHStDEKT DE LA SOCIÉTÉ )ttSTO!<)QrE I:T.\r.()tMOLOf:;QUÏ: DUMAtXt;. Mon cher ami, Vous m'avez demandé de faire la recherche des monnaies mérovingiennes frappées dans l'ancien diocèse du Mans; mon plus grand désir est de vous être agréable; je me mets donc a l'oeuvre, mais je ne \ou~ dissimulerai pas qu'il est peut-être un peu tôt pour entreprendre ce travail. Les monnoyeurs du fe)'Wtor:Mnt CetMHtCtWttCM))! n'ont pas donné aux produits de leurs officines un style spécial et un carac- tère d'unité qui permettent de les distinguer au premier aspect l'art cénoman dans les monnaies n'est que le ref!et de plusieurs foyers, et j'ai constaté peu de particularités notables qui lui appartiennent en propre. Je suis parvenu cependant à constituer une dizaine de groupes de monnaies ayant des caractères artistiques communs, et à l'aide de ces groupes qui appartiennent tous au moins a une portion x. 19 LES du CeMom<tt)M!CMm, j'ai déjà établi l'existence de nombreux ateliers que cette province peut revendiquer. Assurément cette h~te sera très incomplète, car, sans parler des ateliers qui rehteront éternellement dans l'oubli parce qu'aucun de leurs produits n'a été conservé, il en est beaucoup qui ne se révèleront qu'à la suite de trouvailles heureuses ma liste sera encore sujette a révision a cause de quelques identifications qui ne seront certaines que lorsqu'on aura terminé l'inventaire complet et sûr des monnaies des régions voisines. L'explorateur des ateliers Mérovingiens n'a pour guide que l'étude du st~le, il procède par re- connaissances prudentes la timidité est sa loi, la har- diesse son écuen il doit gagner son terrain pied à pied et n'avance sûrement qu'à la condition d'être très circonspect. Ce que je puis vous annoncer dès à présent, c'est que votre province n'a rien à envier à ses voisines sous le rapport de la multiplicité des ateliers monétaires mérovingiens et que la numismatique est appelée à jeter une lumière inatten- due sur la géographie et sur l'histoire des origines du Maine. Je vous remercie, mon cher ami, de m'avoir suggéré l'idée de faire cette recherche et de lui avoir offert l'hospi- talité d~ votre savante Revue. C'est un travail dénué de tout attrait; il n'est pas fait pour être lu, mais on le consultera quelquefois. Quand on n'a pas le bonheur d'être agréable, il faut faire ses efforts pour être utile un dictionnaire a moins de charme qu'un roman, mais il est l'ami des chercheurs; ce rôle est toute mon ambition. Je divise mon travail en deux parties et je renvoie à la seconde tout ce qui conceine la géographie, parceque la numismatique est l'objet spécial de mon étude. Je cherche donc avant tout quelles sont les monnaies du Maine je m'occuperai ensuite de savoir dans quelles localités elles ont été frappées. FREMIR PAHTrE LE STYLE DES MONNAIES MÉROVINGIENNES DU C~(M//1AW7C<7M. Je me sers du mot style parceque je n'ose emploie)'le mot f<t't; les monétaires du Maine n'étaient pas des artiste'' ma pensée serait mieux rendue par les expressions ma;f)' /<M, que les esthétistes emploient pour désigner les pro- cédés spéciaux d'un artiste ou d'un artisan. Si la Cité du Mans n'est pas de celles qui se distinguent par la fécond)té de leurs ateliers elle est loin cependant défigurer parmi les plus pauvres. Elle me semble, comme Chartres et comme Bourges, avoir joué un rôle un peu effacé dans le mouvement politique et commercial pendant la période mérovingienne. Ces 'uttes isolées des grands cours d'eau qui étaient les artères de la vie sociale du peuple franc, ont conservé beaucoup plus tard que Tours, Orléans, Paris et Rouen, avec les moeurs et le caractère romains, l'usage des anciennes monnaies. Un texte de Ftodoard que je considère comme la meilleure énumération des provinces franques de la Gaule au point de vue de la géographie numismatique des VU'' et VIII" siècles (Boit., t. I, p. 17t) ne fait pas mention du CeitOHMH~cMtK et ne cite de l'ancienne troisième Lyonnaise que le TMt'o- )t!C!<)K;je suis porté a en conclure que, dans les énuméra- tions sommaires, on ava)t l'usage de désigner sous ce dernier nom l'ensemble des territoires des cités subordonnées à la Métropole de Tours. A défaut de fécondité, les ateliers cénomans présentent le phénomène de la multiplicité; on les trouve dispersés dans toutes les parties du diocèse, et nous verrons dans ta seconde partie de ce travail que le plus grand nombre de ces ateliers se révèlent à nous par un spécimen unique de leurs produits, ce qui donne à penser que les découvertes ultérieures grossiront dans des proportions très considérables la liste provisoire que je vais dresser. Il n'y aurait pas d'exa- gération a avancer que cette liste sera doublée, et je crois qu'au moyen du total des produits connus de chaque atelier, on pourrait, en se livrant il un calcul de probabilités, supputer a. peu près le nombre des ateliers encore inconnus. C'est un fait inouï que sur les dix-neuf émissions de la ville ou de l'église du Mans, dont dix-sept portent les noms de dix-sept monétaires différents, quatorze se révèlent par un exemplaire unique trois monétaires seulement sont connus par plusieurs produits, l'un par cinq, les deux autres par deux. Peut-être un jour comptera-t-on trente ou quarante monétaires de la seule ville du Mans. Avant d'entreprendre l'énumération des ateliers cénomans, je crois utile d'exposer les raisons qui déterminent mes choix parmi cette multitude d'enfants trouvés des collections dont nous recherchons la filiation. Je vaisinitiermon lecteur à mes procédés afin qu'il puisse contrôler mes affirmations, rectifier mes attributions, se faire juge de mes incertitudes et compléter lui-même mon travail quand de nouvelles découvertes lui en fourniront l'occasion. Ueux particularités, ont d'abord attiré mon attention, et m'ont permis de former deux groupes. Il faut créer une langue pour apprendre cette branche toute nouvelle de l'archéologie; je donne donc des noms à ces deux groupes, et je les appelle groupe au }))'o/t< coHMM et groupe a la face si- ~t'Hftn'e; oncomprendrabientotles motifs de ces désignations. 1 TYPE DU PROFiL CONCAVE. Voici un triens dont )'at.tnbutio)t:t taM))eépiscopa)e des Cénomans parait incontestable; sa descnption est celle-ci: t. +CENOMANNIS. Buste dradémf à dr0tte;de\ant)e front, un globule. I~T'MELUONE. Croix mixte hchéesur une base houzon- tale, cantonnée de globules aux L et 2 et de X aux 3 et 4 d~us le champ, à gauche, un globute à la hauteur des bras de la crot\. Cette description est encore trop vague, elle ne donne aucun détail sur le style du buste, il faut procéder plus minutieusement parceque chaque trait de burin peut devenir un rayon de lumière. Partout, depuis que la monnaie existe, on a représenté sur les espèces des bustes diadèmés tournés à droite ou a gauche, mais de même que chaque homme a sa physiono- mie propre, chaque époque a son style, chaque région son caractère, chaque artiste sa manière, et plus l'art est grossier dans ses contrefaçons de la nature, mieux il trahit les procédés particuhers et le faire de l'artiste. L'art~te copie plus qu'il n'invente quand il ne copie pas la nature, il copie les copies de la nature, il reproduit et exagère leurs imperfections, et, pour p3U qu'il soit a son tour cop)~ et recopié, le type primitif s'altère et déparait dans la dégéné- rescence et l'immobilisation. C'est la le sort très fréquent des figures représentées sur les monnaies; une tête correcte ne tarde pas à devenir une caricature et même tout autre chose qu'une tête, et il arrive souvent que Ie& reproduc- tions multipliées et rapides font oublier complètement le prototype les numismatistes eux-mêmes ne peuvent le retrouver qu'en cherchant ses vicissitudes dans l'étude de la filiation des types on sait par quelles transformations la tête de profil est devenue le fameux type chartrain, comment la louve romaine et le sanglier gaulois sont devenus le vaisseau de la ville de Paris après avoir été le corbeau d'Odm pour les Anglo-Sa\ons, une tète de profil, et entm un navire pour les rois de la mer, les Normands et les Anglais. C'est de la même mamére, dans un ordre parallèle mais tout duférent, que les langues se sont modifiées et que le latin est devenu le français les artistes ont eu l'avantage de pouvoir rester fidèles à l'expression du vrai parceque la nature les a constamment rappelés aux prototypes, mais leurs modes d'accentuation varient à l'infini et chez eux, si j'ose le dire, les patois abondent. Nous allons, pour poursuivre notre but, procéder à une dissection d'art mérovingien. Le buste d)adêmé figuré sur la monnaie de JUcHio offre les particularités suivantes 1° Le nez est représente par un arc de cercle dont la conca\ité s'enfonce dans le profil. 2"L'œn et les lèvres sont indiqués par de simples globules. 3" L'oreule est ti'cutée par une courbe en sens inverse de la courbe naturelle. 4" Le diadème est un simple cordon de perles dont la courbe Cbt inverse a~ la ligne de convexité du crâne sa direction forme un angle d'environ quarante-cinq degrés sur la verticale. 5" La partie postérieure du crâne est indiquée par une sorte de uploads/s3/ monnaies-merovingiennes-du-cenomannicum-pt-1-le-style-monnaies-merovingiennes-du-cenomannicum-ponton-d-x27-amecourt.pdf
Documents similaires








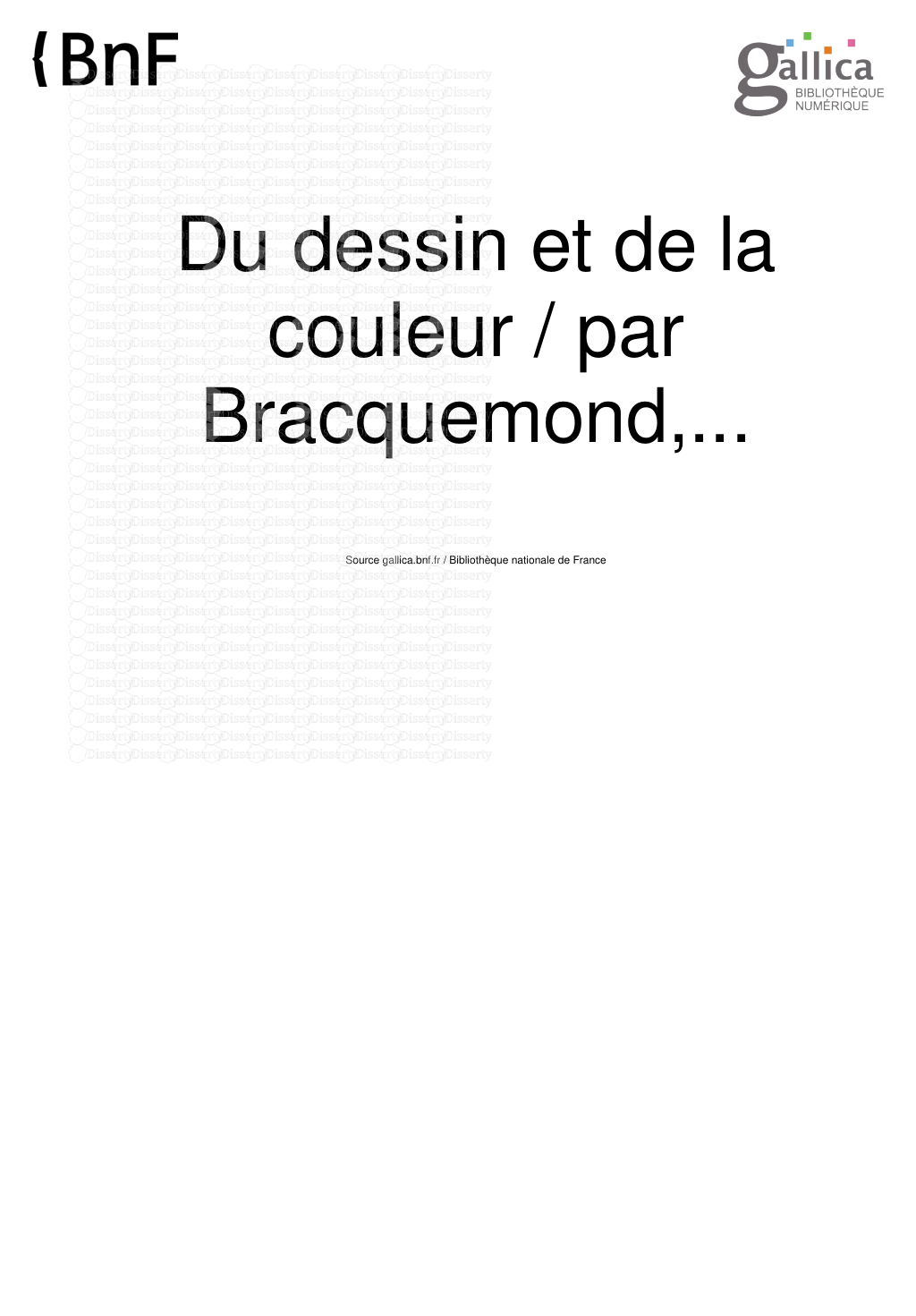

-
38
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 03, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.1280MB


