Syntaxe des incises de citation Olivier Bonami Université Paris-Sorbonne et Lab
Syntaxe des incises de citation Olivier Bonami Université Paris-Sorbonne et Laboratoire de Linguistique Formelle (UMR 7110) olivier.bonami@paris-sorbonne.fr Danièle Godard Laboratoire de Linguistique Formelle (UMR 7110 – CNRS & U. Paris 7) 1 Introduction* Les incises de citation sont illustrées en (1). Elles sont à comparer avec les autres incises (2), et avec les constructions du discours rapporté (3), avec lesquelles elles partagent certaines propriétés. (1) a. « Le Président, annonce Marie, est arrivé. » b. « Marie était très joyeuse », se souvenait Paul. (2) a. Marie, paraît-il, viendra ce soir. b. Le président arrivera, son porte-parole l’a annoncé, avec une heure de retard. (3) a. Alors, il annonce : « Le président est arrivé. » b. Alors, il annonce que le « président » est arrivé. c. Alors, il annonce que le président est arrivé. d. Il s’interrogeait : que répondre à son père ? Il n’y a pas d’accord dans la littérature sur la définition d'une « citation ». Selon les auteurs, on appelle ainsi : – le discours direct (3a) ; – toutes les expressions en mention, dont l’utilisation représente le choix d’un agent autre que le locuteur (3a,3b), et qui sont typiquement signalées par des guillemets ou par une prosodie particulière ; – tout contenu attribuable à un agent autre que le locuteur, y compris le discours indirect (3c) ou indirect libre (3d). Il y a également plusieurs approches théoriques concernant la citation. Nous adoptons ici la théorie de la citation comme imitation de Clark et Gerrig (1990). Contrairement à Clark et Gerrig cependant, nous adoptons la deuxième définition de la citation, excluant, en particulier, le discours indirect du champ de la citation. Ainsi, sont des citations les phrases qui sont l'hôte de l'incise en (1), et les expressions entre guillemets en (3a) et (3b) ; mais ni les exemples (2) ni (3c,d) ne comportent de citation. En outre, nous spécialisons le terme de discours direct pour la construction (3a), où une citation est explicitement introduite par un verbe de « dire ». Nous commençons dans la section 2 par décrire les propriétés spécifiques des incises de citation parmi les incises en général. Dans la section 3, nous discutons la nature de la citation, et précisons en quoi les incises se différencient du discours direct. La section 4 esquisse une analyse formalisée des incises de citation dans le cadre d’une grammaire HPSG (Pollard et Sag, 1994). 2 Les incises de citation et les incises ordinaires 2.1 Propriétés communes Les incises de citation partagent avec les autres incises, ou incises « ordinaires », un certain nombre de propriétés : Durand J. Habert B., Laks B. (éds.) Congrès Mondial de Linguistique Française - CMLF'08 ISBN 978-2-7598-0358-3, Paris, 2008, Institut de Linguistique Française Syntaxe DOI 10.1051/cmlf08080 CMLF2008 2407 Article available at http://www.linguistiquefrancaise.org or http://dx.doi.org/10.1051/cmlf08080 (i) Ce sont des phrases verbales : elles ont toujours pour tête un verbe, qui est saturé pour son sujet. L’incise est normalement attachée à une autre expression, que nous appellerons l’hôte de l’incise : en (1b), l’hôte est la phrase Marie était très joyeuse1. (ii) Ce sont des expressions incidentes. A la suite de Bonami, Godard et Kampers-Manhe (2004), nous considérons l’incidence comme une propriété strictement prosodique de certains constituants syntaxiques, qui peut, suivant les constructions, être corrélée à des propriétés syntaxiques, sémantiques et pragmatiques diverses. Bien que la description de l'incidence soit à compléter, l'idée générale est claire (Fagyal 2002, Mertens 2004, Delais Roussarie 2005) : les incidents sont prosodiquement autonomes ; optionnellement, ils sont séparés du reste de la phrase (notamment sur la frontière droite de l'incident) par une pause ou un allongement de la dernière syllabe, un contraste de F0 sur la dernière syllabe, ou un changement global de registre. (iii) Elles ont une certaine liberté de positionnement ; elles sont exclues en position initiale d’énoncé, mais pas en tête d’une phrase non-initiale. (4) a. *Paraît-il, le Président viendra ce soir. b. Le Président, paraît-il, viendra ce soir. c. Le Président viendra, paraît-il, ce soir. d. Le Président viendra ce soir, paraît-il. e. Le président viendra, et, semble-t-il, le ministre lui parlera. (5) a. *«Annonce-t-il, Le Président est déjà arrivé. » b. « Le Président, annonce-t-il, est déjà arrivé. » c. ?« Le Président est, annonce-t-il, déjà arrivé. » d. « Le Président est déjà arrivé», annonce-t-il. e. « Cette décision, dit le président, est bonne. Et, ajouta-t-il, je ne reviendrai pas dessus. » (iv) L’incise comporte un verbe dont le complément est manquant (1,2a) ou réalisé comme une forme pronominale (2b,6). (6) a. Carla, Paul vient de me dire ça, est un mannequin « très belle ». b. Est-ce que les enfants, l'instit me l'a demandé, seront là le jour de la grève ? (v) Il y a une forme d'identité (à préciser) entre la phrase hôte et l'interprétation du complément manquant ou pronominal de l'incise. Ainsi, les énoncés de (1) et (2) sont grossièrement équivalents à ceux qui sont donnés en (7). (7) a. Il annonce que le Président est arrivé. b. Paul se souvenait que Marie était très joyeuse . c. Il paraît que Marie viendra ce soir. d. Son porte-parole a annoncé que le président arriverait avec une heure de retard. 2.2 Différences Les incises de citation diffèrent des incises ordinaires par les propriétés suivantes. (i) Les incises de citation se caractérisent par la corrélation de deux propriétés. Alors que le complément dans les incises ordinaires est soit manquant soit un pronom, celui des incises de citation est toujours manquant. D'autre part, le sujet du verbe de citation est toujours inversé, du moins en français standard, alors que celui des incises ordinaires est parfois inversé (2a), mais pas toujours (8b), et qu'il ne l'est que s'il s'agit d'un clitique (8a) : en réalité, l’inversion ne se rencontre dans l’incise ordinaire qu’avec quelques formes qui semblent figées, comme paraît-il, semble-t-il. C'est pourquoi les incises de (9a,b) ne sont pas bonnes : il s'agit d'incises ordinaires, puisqu'elles comportent un complément pronominal ; or, dans la première, le sujet clitique est inversé alors qu'il ne s'agit pas d'une expression figée, et dans la seconde, le sujet SN est inversé. Les incises de citation correspondantes (où le complément manque) sont bonnes. (8) a. *Paul, croient ses collaborateurs, partira avant la fin de l'année. Durand J. Habert B., Laks B. (éds.) Congrès Mondial de Linguistique Française - CMLF'08 ISBN 978-2-7598-0358-3, Paris, 2008, Institut de Linguistique Française Syntaxe DOI 10.1051/cmlf08080 CMLF2008 2408 b. Paul, je crois, partira avant la fin de l'année. (9) a. *Le Président, l'annonce-t-il, est arrivé. b. *Marie était très joyeuse, s'en souvenait Paul. c. Le Président, annonce-t-il, est arrivé. d. Marie était très joyeuse, se souvenait Paul. Notons qu'il existe également en français informel ou non-standard, une incise de citation introduite par le complémenteur que, sans inversion : %Le Président, qu'il disait, est arrivé. Nous ne l’analysons pas en détail ici, mais voir la note 6. (ii) L’hôte des incises de citation est un signe linguistique de nature variée : ce peut être une interjection ou une onomatopée. L’hôte des incises ordinaires ne peut être ni une interjection, ni une onomatopée. (10) a. « Hourrah ! » a dit Paul. b. « Grrr » a fait Paul. (11) a. Le Président, Paul l'a dit, est arrivé. b. *« Hourrah ! » Paul l'a dit. c. *« Grrr » Paul l'a fait. (iii) L’hôte des incises ordinaires est pris en charge illocutoirement par le locuteur ; en particulier les indexicaux de première personne y renvoient au locuteur. Par contre, l’hôte des incises de citation n’est pas pris en charge illocutoirement par le locuteur : les indexicaux de première personne y renvoient à l’agent dont les paroles sont rapportées. (12) a. Moni frère a, Paulj l’a dit, répondu correctement à sesj questions. (i≠j) b. « Moni frère, a dit Pauli, a répondu correctement à sesj questions. » (i≠j) 3 L'incise de citation et les verbes de citation 3.1 La citation comme imitation Nous adoptons ici l’approche de la citation comme imitation proposée par Clark et Gerrig (1990) ; voir également Perrin (2002). Dans cette approche, la citation est un mode de communication qui contraste avec la description (ce qui est d'ordinaire pris en considération par les grammaires), et aussi avec la monstration (qui caractérise les déictiques, comme dans Regarde ça !). La citation est l'équivalent dans le dialogue d’un mime. Elle est caractérisée par deux propriétés : il s'agit d'un faire semblant, plutôt que d'un faire ; en (1a) le locuteur n'asserte pas, il fait semblant d'être Marie assertant l'énoncé en question. De plus, cette imitation est sélective, il ne s'agit jamais d'une reproduction intégrale, le locuteur choisissant les aspects de la situation originelle sur lesquels il veut attirer l'attention. Une citation est donc un signe imitant un signe ou un comportement produit par l'entité dénotée par le sujet du verbe de citation. Ce signe est d'une grande variété (Delaveau 1988 ; Clark et Gerrig, 1990 ; Authier-Revuz, 1992). C'est une phrase (1,3a), une interjection (13a), une onomatopée (13b), un signe uploads/s3/ cmlf08080-pdf.pdf
Documents similaires




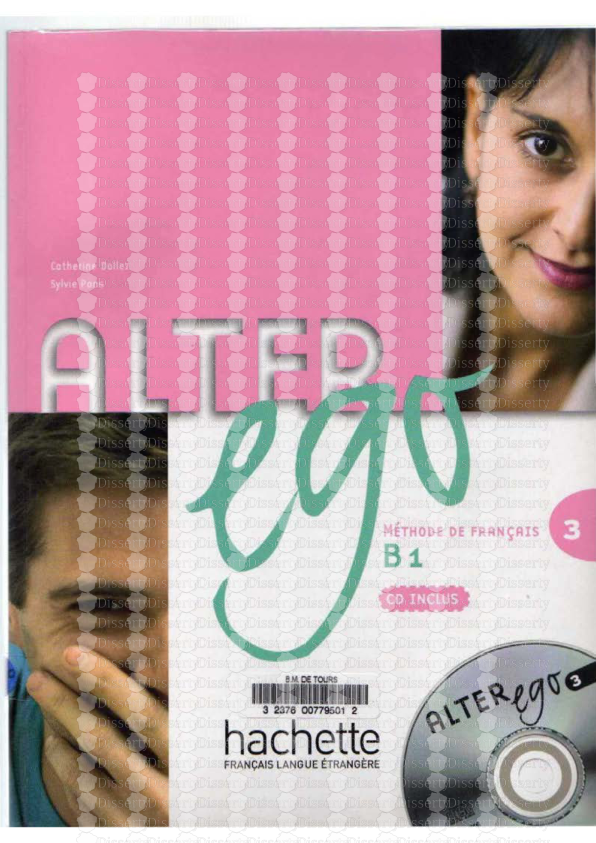





-
84
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 11, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.4424MB


