- 1 - Université Rennes 2 – Haute-Bretagne Département de Géographie et Aménage
- 1 - Université Rennes 2 – Haute-Bretagne Département de Géographie et Aménagement de l’Espace Unité Mixte de Recherche CNRS 6590 « Espaces et sociétés » N ° attribué par la bibliothèque ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ THÈSE Pour obtenir le grade de DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE RENNES 2 Discipline : Géographie Présentée et soutenue publiquement par Olivier GORÉ Décembre 2004 L’inscription territoriale de la musique traditionnelle en Bretagne Sous la direction de M Jean PIHAN, professeur, Université Rennes 2 Jury Maria Gravari-Barbas, professeure à l’Université d’Angers Yves Defrance, Directeur du CFMI – Université Rennes 2, membre de la Société Française d’Ethnomusicologie Ronan Le Coadic, maître de conférences à l’IUFM de Bretagne Joël Pailhé, professeur à l’Université Bordeaux 3 Jean Pihan, professeur à l’Université Rennes 2 - 2 - SOMMAIRE Remerciements………………………………………………………………………………..3 Introduction…………………………………………………………………………………...4 Partie 1 : Une approche géographique de la culture à l’heure de la mondialité………...10 Chapitre 1 : Mise au point sur la notion de culture dans les sciences sociales……………13 Chapitre 2 : Les étendards de la dialectique culturelle……………………………………57 Chapitre 3 : La musique : un “instrument” pour l’approche culturelle en géographie……85 PARTIE 2 : Interactions spatio-culturelles et musique bretonne....................................133 Chapitre 4 : La culture bretonne au temps de la mondialité……………………………...136 Chapitre 5 : La musique bretonne, de la pratique populaire à l’objet d’étude…………...187 Chapitre 6 : Une approche systémique d’inscription territoriale………………………...223 PARTIE 3: L'inscription territoriale des faits musicaux………………………...……...249 Chapitre 7 : Répartition et dynamiques spatiales des lieux de diffusion…………………251 Chapitre 8 : La dialectique musicale bretonne…………………………………………...287 Chapitre 9 : La musique traditionnelle, vecteur de la territorialité bretonne…………….358 Conclusion…………………………………………………………………………………..396 Références bibliographiques…………………………………………….………………...401 Annexes……………………………………………………………………………………..410 Tables des illustrations…………………………………………………………………….412 Table des matières………………………………………………………………………….415 - 3 - REMERCIEMENTS Si à travers cette thèse, j’ai le plaisir de présenter les résultats de mes recherches que je mène depuis quelques années, c’est grâce aux soutiens et aux encouragements d’un certain nombre de personnes. J’aimerais donc les remercier ici en commençant par ma famille qui m’a fait confiance et m’a soutenu tout au long de mon cursus universitaire. Mes remerciements s’adressent également à Monsieur Jean Pihan, professeur à l’Université Rennes 2, qui a accepté d’être mon directeur de thèse. Je lui suis particulièrement reconnaissant pour ses conseils méthodologiques, la liberté d’action qu’il m’a laissée et ses précieux encouragements de fin de course. Je n’aurai pu mener à bien ce projet sans l’aide des membres du laboratoire RESO de l’Université Rennes 2 et plus particulièrement de mes “voisins de table”, Erwan, Olivier, Régis et Charles-Edouard. Je remercie vivement les responsables d’associations qui m’ont accueilli confortablement afin que je puisse diffuser mon enquête sur la fréquentation des festoù-noz dans de bonnes conditions ainsi que les personnes qui ont consacré un peu de leur temps à répondre au questionnaire. Enfin, mon attention se porte à tous ceux qui m’ont accompagné de près ou de loin dans l’élaboration de cette thèse, en particulier : Janfy, Mehdi, Alex, Morgane pour leurs encouragements tout au long de ces années et pour leurs réconforts dans les moments plus difficiles qui ont affecté cette fin de thèse, Danielle, Jacques, Valentin pour leur accueil dans la douceur marine de la “maison de l’estran” et Justine qui m’a supporté au quotidien pendant trois années mais qui n’a pas souhaité partager l’aboutissement de ce travail. Introduction générale - 4 - Introduction générale « Une musique traditionnelle n’est ainsi en aucun cas l’image d’une quelconque pureté originelle, ni celle d’un passé musical demeuré intact ; vivante et donc soumise aux changements comme n’importe quel organisme, elle exprime au contraire toujours son époque, manifestant les confluences et les étapes ayant marqué ses productions ». Laurent Aubert, La musique de l’autre Avec l’essor des loisirs, la place croissante de l’activité musicale dans les pratiques quotidiennes accroît considérablement le rayonnement socioculturel de la musique. Forme d’expression artistique, la musique embrasse aussi de nombreux autres champs plus ou moins proches du domaine des Arts. Pour appréhender cette diversification les sciences sociales analysent les faits musicaux à travers un certain nombre de médiations dans la mesure où la musique n’est pas un objet en soi. A la différence des autres formes d’expression artistique, la création musicale ne produit que des œuvres sonores, néanmoins appréciables à travers des supports ou des situations. Bien que ces médiations matérielles (instruments, disques, salles de concerts…), immatérielles (goûts, pratiques, identités…) ou humaines (interprètes, amateurs, producteurs, diffuseurs…) amplifient la dimension spatiale des faits musicaux, les géographes n’investissent que modérément les espaces d’expression de la musique. L’émergence de l’approche culturelle en géographie, qui privilégie l’étude de la création individuelle ou collective à celle des objets créés, permet cependant d’appliquer les principes de la médiation spatiale à la pratique musicale. Au-delà de l’emprise des divers types de pratiques sur les territoires, l’approche de la création musicale à travers le filtre de la médiation spatiale contribue plus globalement à Introduction générale - 5 - la mise en valeur des interactions entre musique et territoire. Interactions d’autant plus fortes et complexes lorsque les pratiques musicales revendiquent une appartenance plus ou moins perceptible aux territoires auxquels elles se réfèrent. A la fonction artistique se greffe alors une fonction identitaire qui s’immisce dans les rapports entre musique et territoire. Cette dimension identitaire, dont l’étendue varie suivant les styles de musique, est particulièrement développée s’agissant des pratiques que l’on regroupe généralement sous l’appellation de “musiques traditionnelles”. Or, notre approche géographique de la musique se base d’abord sur ce type de pratiques. Bien que ces formes d’expression musicale soient aussi qualifiées de “folkloriques”, “ethniques”, “populaires” ou plus récemment de “Musiques du monde”, suivant les époques, les pays et les auteurs, et même si chacune désigne des réalités différentes nous emploierons en priorité l’expression “Musiques traditionnelles”. C’est d’ailleurs sous cette appellation que les pratiques vocales et instrumentales populaires du domaine français bénéficient d’une reconnaissance institutionnelle depuis les années 1980. Notre réflexion ne prend donc en compte qu’une partie des pratiques musicales, celles qui se revendiquent peu ou prou d’un territoire, en l’occurrence la Bretagne. Cette option méthodologique, qui laisse à l’écart la grande majorité des pratiques musicales en Bretagne celles qui ne revendiquent aucun caractère breton, a pour objectif d’analyser les liens entre la création musicale et la construction territoriale. En plus de révéler la dimension spatiale d’une pratique populaire régionale, notre approche géographique de la musique traditionnelle en Bretagne consiste à montrer dans quelle mesure une pratique culturelle peut contribuer à la valorisation d’un territoire. « La culture régionale demeure aujourd’hui un facteur de différenciation voire au-delà un appui pour favoriser la constitution d’un territoire attractif »1. Or, la musique traditionnelle est aujourd’hui un des éléments les plus vivaces de la culture bretonne. Avant de présenter notre recherche sur la musique traditionnelle en tant que composante d’une culture régionale, quelques précisions s’imposent à propos notamment de cette expression “culture régionale”. La notion de culture régionale Fondée sur deux notions extrêmement polysémiques, la région et la culture, cette expression est employée avec modération dans les débats géographiques d’autant plus lorsqu’ils concernent le terrain français. Bien que ces deux notions, prises séparément, fassent partie des objets fondamentaux de la géographie et aient donné naissance à deux des découpages reconnus de la discipline, la géographie régionale et la géographie culturelle, leur 1 Conseil Régional de Bretagne, Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire : Bretagne 2015, Octobre 2002, p. 71. Introduction générale - 6 - rapprochement autour de la notion de culture régionale est moins fréquent. En France, excepté les recherches qui s’inscrivent dans la mouvance de la géographie historique, les approches géographiques sur les cultures régionales sont assez rares. La géographie française a élaboré des concepts qui intègrent plus ou moins le rapprochement entre les notions de région et de culture, comme celui d’aire culturelle ou celui d’espace vécu, mais ils se démarquent sensiblement de la notion de culture régionale. Le concept d’aire culturelle traduit plus la dimension spatiale des civilisations que des cultures et celui d’espace vécu peut s’appliquer à d’autres niveaux scalaires que la région. Sans hypostasier la culture, la notion de culture régionale est bien une expression géographique de la culture à l’échelle de la région, c’est-à-dire à un niveau intermédiaire entre le local et la nation. Sous les actions uniformisatrices et centralisatrices séculaires de la culture nationale, les cultures régionales restent difficilement perceptibles dans l’organisation de l’espace français. Si la région continue à jouer un rôle déterminant dans la hiérarchie territoriale en France, elle le doit plus à sa vocation économique et au renouvellement récent de sa fonction politique et administrative qu’à sa dimension culturelle. La dimension culturelle des régions françaises n’est réellement perceptible qu’à travers leur histoire, leur fonction politique passée, tant sont infimes les disparités culturelles actuelles entre les régions. C’est donc plutôt dans cette acception historique, symbolique de la région que s’inscrit notre recherche. Il nous faut garder à l’esprit qu’analyser la musique traditionnelle en Bretagne en tant qu’élément d’une culture régionale, en l’occurrence la culture bretonne, participe plus à la compréhension de la construction symbolique de la Bretagne qu’à une étude de la réalité socioculurelle de la région même si la musique traditionnelle rythme le quotidien uploads/s3/ gore-o-musique-traditionnelle-en-bretagne.pdf
Documents similaires






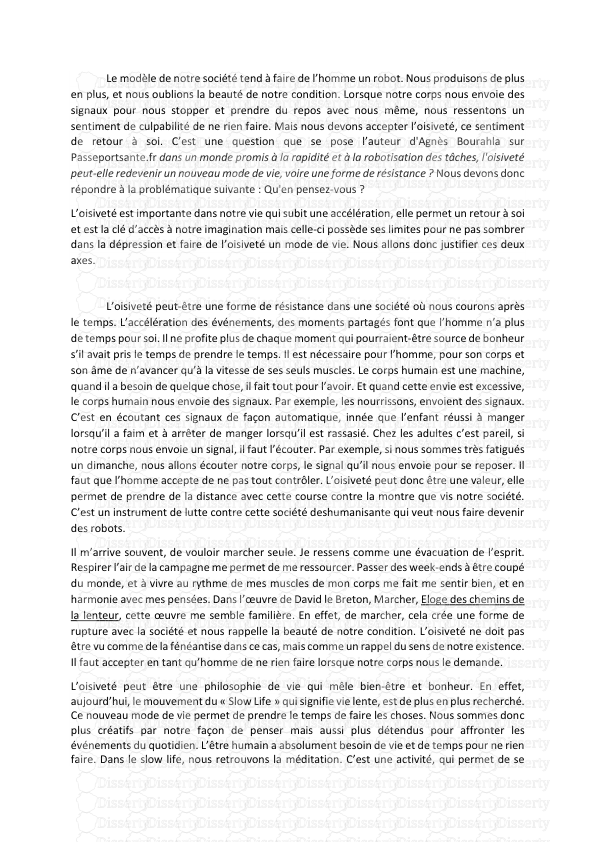



-
45
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 06, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 8.5251MB


