Les théoriciens de l’art Sous la direction de Carole Talon-Hugon ISBN 978-2-13-
Les théoriciens de l’art Sous la direction de Carole Talon-Hugon ISBN 978-2-13-078988-8 Dépôt légal — 1re édition : 2017, avril © Presses Universitaires de France / Humensis, 2017 170 bis, boulevard du Montparnasse, 75014 Paris Avant-propos Appréhender un objet comme une œuvre d’art suppose, sans qu’on en soit ordinairement conscient, une certaine idée de ce qu’est l’art. De manière générale, on ne perçoit qu’en mettant de l’ordre dans l’amas hétéroclite de nos sensations et en les catégorisant grâce à des concepts (de « fleur », de « bâtiment » ou de « chien », par exemple). Autrement dit, les mots grâce auxquels nous ordonnons le monde ne désignent pas tant des choses que des idées abstraites permettant cet ordonnancement. Cela vaut a fortiori pour les objets culturels ; ils ne sont jamais de purs donnés : entre l’objet sensible offert à nos sens et l’appréhension que nous en avons s’intercalent des médiations. Dans le cas particulier qui nous occupe, l’appréhension d’une chose comme une « œuvre d’art » suppose non seulement la mise en jeu de la catégorie mentale générale d’art, mais aussi de sous-catégories comme celles de « peinture », de « musique », de « sculpture » ou de « performance » et, à l’intérieur de ces sous-catégories, d’autres rubriques encore comme, à l’intérieur de la littérature, celles de « roman », de « nouvelle » ou de « poésie », auxquelles s’ajoutent, selon l’équipement culturel de l’individu, des catégories plus fines par sous- genres, mouvements, périodes, etc. Cette idée de l’art qui sous-tend notre appréhension de ses objets n’est toutefois pas faite que de catégories classificatoires ; elle est aussi composée de croyances concernant les finalités, les usages et les valeurs de ces objets, et suppose encore une certaine manière de penser leurs producteurs, ceux auxquels ils sont destinés, les lieux et les institutions où ils se font et où ils s’exposent. Si bien que ce que nous avons nommé en première approximation une « idée de l’art » est bien plutôt une nébuleuse de concepts liés entre eux de manière souterraine mais étroite. Ainsi, dans l’idée moderne d’art qui se constitue au cours du XVIIIe siècle, la catégorie nouvelle de beaux-arts est solidaire de l’invention du goût comme sens du beau, et du désintéressement comme attitude appropriée face aux œuvres. L’idée d’art constitue ainsi un paradigme au sens où Thomas Kuhn parlait de paradigme scientifique pour désigner l’ensemble des présupposés, des pensées, des croyances et des valeurs qui guide le rapport des scientifiques à leurs objets d’étude (La Structure des révolutions scientifiques, 1962). Il n’y a pas d’œuvre en soi qui pourrait être identifiée et appréciée comme telle sans l’interposition d’une nébuleuse théorique. Un objet n’est jamais une œuvre d’art par ses seules propriétés sensibles. Il le devient par le biais de catégories mentales qui commandent son appréhension, sa compréhension et son appréciation. Cette nébuleuse théorique nous est aussi invisible que l’air que nous respirons, aussi insensible que la pression atmosphérique que nous subissons et sans lesquels pourtant nos gestes, nos comportements et nos actes ne seraient pas ce qu’ils sont. Aussi ne nous apparaît-elle pas comme une configuration particulière d’idées, mais sous la forme de principes incontestables, universels et intemporels. Ne considère-t-on pas spontanément que le Parthénon, L’Adoration de l’Agneau mystique des frères Van Eyck, ou Le Baiser de Rodin sont substantiellement de l’art ? Cette trompeuse évidence procède de l’ignorance de la médiation des catégories mentales que nous mobilisons. Un exemple simple emprunté à Arthur Danto permet de l’établir. Analysant dans La Transfiguration du banal le cas très particulier d’objets perceptiblement indiscernables (un urinoir et Fountain de Duchamp ; un lit et Bed de Rauschenberg), il établit que pour voir Fountain ou Bed comme des œuvres d’art et non comme des objets utilitaires, il faut avoir fait siennes certaines conventions, certaines idées sur ce que l’art est, peut ou doit être1. Inversement, leur refuser le label « art » c’est encore se référer de manière plus ou moins consciente à une autre manière de penser ce que l’art est, peut ou doit être. Si cette atmosphère théorique qui constitue le milieu de notre rapport à l’art est ordinairement largement inaperçue, certains moments de l’histoire ont cependant contribué à la rendre visible : ce sont ceux où l’évolution des pratiques artistiques a fait que les œuvres produites n’ont plus correspondu, ou n’ont plus que très imparfaitement correspondu, au paradigme artistique de l’époque. Ce fut le cas au XXe siècle, lorsque l’inachèvement de Cent mille milliards de poèmes de Queneau, l’absence d’artefactéité d’un ready- made de Duchamp ou l’intervention du hasard dans les compositions de John Cage ont ébranlé l’idée d’œuvre classiquement définie comme une totalité organique et achevée, accompagnée par un libre choix et précédée par la pensée d’une fin ; lorsque les Assemblages de Kurt Schwitters, les Combine Paintings de Rauschenberg, les performances et les happenings, ou les pratiques individuelles absolument singulières ont bouleversé les sous-catégorisations de l’art en un nombre limité de genres artistiques. En contredisant rudement le paradigme artistique qui prévalait alors, ces pratiques artistiques l’ont fait apparaître à la lumière. En 1972, Harold Rosenberg écrivait dans un ouvrage éloquemment intitulé La Dé-définition de l’art : « Nul ne peut dire avec certitude ce qu’est une œuvre d’art. Lorsqu’un objet reste présent comme dans la peinture, c’est ce que j’ai appelé un “objet anxieux” : il ignore s’il est un chef-d’œuvre ou un déchet »2. En contraignant à mettre sur le devant de la scène théorique la question de la définition de l’art, les devenirs mêmes de l’art ont conduit à opacifier la nébuleuse théorique, jusque-là largement invisible, dans le milieu de laquelle se constituent nos appréhensions. Cette contestation n’attaquait pas un paradigme inchangé depuis l’Antiquité, mais une idée moderne de l’art, différente sur bien des points de celles d’époques antérieures. Car il n’y a pas un paradigme qui aurait été mis en cause au XXe siècle, mais des paradigmes qui se sont succédé au cours de l’histoire, de manière plus ou moins insensible. Ces nébuleuses théoriques évoluent tantôt lentement, tantôt brutalement, de manière partielle ou globale, discrète ou fracassante. Pour l’homme de l’Antiquité grecque ou romaine, le mot art n’avait pas le même sens que pour nous : il signifiait principalement le talent, le savoir-faire, l’habileté et il s’appliquait à la rhétorique, à la cordonnerie ou à la boucherie aussi bien qu’à la peinture ou à la sculpture. En latin, tous ceux qui pratiquaient ces ars ainsi définis étaient désignés par le substantif masculin artifex, artificis, que l’on traduit tantôt par artisan, tantôt par artiste, mais qui ne signifie exactement ni l’un ni l’autre. Là où nous distinguons l’art, la technique et l’artisanat, les hommes de l’Antiquité ne voient qu’une région unifiée de l’agir humain. Là où la modernité a vu une pratique autonome et autotélique, l’Antiquité a vu une activité répondant à des fonctions hétéronomes : mettre en relation avec les dieux, glorifier les héros, édifier les citoyens, etc. Elle ne rangeait pas ses œuvres dans le cadre neutre d’un musée, mais dans les lieux liés à leurs fonctions. Elle n’attendait pas des destinataires des œuvres une pure jouissance esthétique désintéressée, mais une participation. Aussi, même si le Parthénon, l’Érechthéion, les temples de Paestum, la Vénus de Milo, l’Apollon du Belvédère, l’Aurige de Delphes, l’Iliade et l’Odyssée, la mythologie et la tragédie grecque, constituent des formes idéales de notre imaginaire culturel, l’idée de l’art qui était celle de l’Antiquité nous est partiellement étrangère. Les catégories médiévales ne le sont pas moins : le Moyen Âge ne connaît pas les « beaux-arts » mais use de distinctions déconcertantes, voire énigmatiques : celle des arts mécaniques (activités manuelles et serviles effectuées contre rétribution : agriculture, tissage, ferronnerie, sculpture…) et des arts libéraux (disciplines intellectuelles que sont la grammaire, la rhétorique, la dialectique, l’arithmétique, la géométrie, l’astronomie et la théorie musicale). La mosaïque, l’enluminure, la tapisserie, l’orfèvrerie ou la broderie y occupent une place aussi importante que les cinq pratiques qui constituent le canon artistique de la modernité tel qu’on le trouve par exemple formulé par Hegel (architecture, sculpture, peinture, musique, littérature). Peintres et sculpteurs y sont des artisans appartenant à la corporation des « imagiers peintres et tailleurs d’images » et acquièrent leur savoir-faire par un apprentissage exclusivement pratique dans l’atelier d’un maître. Pas plus que la nôtre, l’expérience des œuvres que faisait le contemporain de Périclès ou l’homme du XIIe siècle ne dépendait de sa seule sensibilité. Elle était aussi fonction d’un équipement culturel. Comme l’écrivait Erwin Panofsky, « il n’existe rien de tel qu’un spectateur totalement “naïf”. Le spectateur prétendument naïf au Moyen Âge avait beaucoup à apprendre et un peu à oublier, avant de pouvoir apprécier la statuaire et l’architecture classique ; il avait, après la Renaissance, beaucoup à oublier, et un peu à apprendre, avant de pouvoir apprécier l’art médiéval – pour ne rien dire des arts primitifs. Ainsi, le spectateur prétendu “naïf” ne se borne pas à goûter l’œuvre d’art, mais encore, à son insu, il l’évalue uploads/s3/ les-theoriciens-de-lart-talon-hugon-carole.pdf
Documents similaires






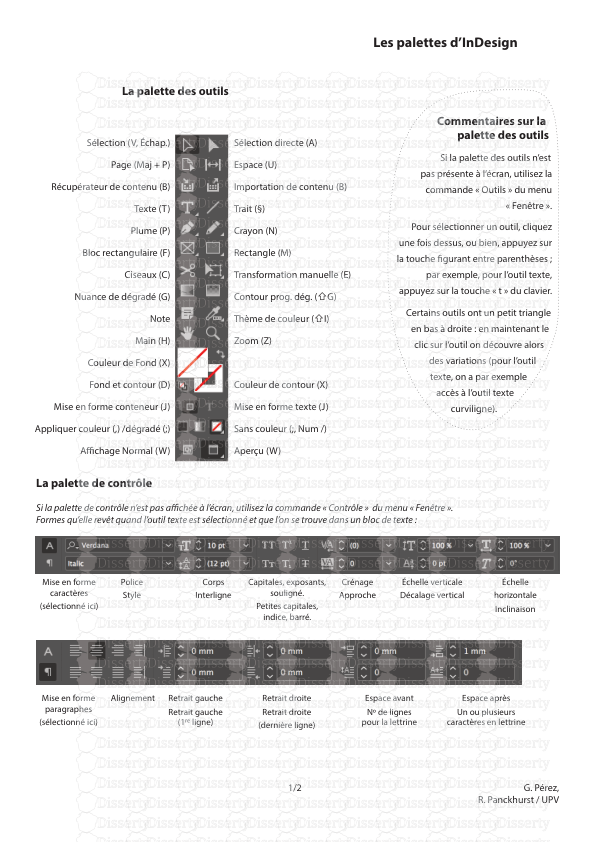



-
114
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 09, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 7.1937MB


