1 III.LE MAGMATISME, UNE CLE DE LA DIFFERENCIATION DU GLOBE. A.les séries magma
1 III.LE MAGMATISME, UNE CLE DE LA DIFFERENCIATION DU GLOBE. A.les séries magmatiques. 1.notion de série magmatique. Poly Massif - Central. Le volcanisme du Massif Central montre des ensmbles variés. Nous ne parlerons pas ici des liens qui existent entre la forme des édifices volcaniques, la nature des éruptions et la nature des produits émis. De nombreux ouvrages traitent de ces questions classiques. Nous allons prendre un exemple de roches émises par un même volcan de la chaine des Puys. Série de diapos. Basalte à olivine. ( roche pauvre en silice). Basalte sans olivine. Roche un peu moins pauvre en silice. Vue en lame mince. Trachyte. Roche plus claire, présentant des cristaux de biotite et d'amphibole ainsi que des phénocristaux de F.K. Rhyolite.On y distingue des cristaux de F.K et des cristaux de Q Voilà un exemple d'un cortège de roches qu'un même volcan a pu émettre à différents moments. Pour étudier ces différentes roches on va les replacer dans la classification internationale de Streckeisen. Voir aussi le logiciel à télécharger La classification des roches magmatiques. (streck.zip) 2 La composition minéralogique d'une roche est fonction de sa composition chimique et des conditions de cristallisation. On peut donc prendre en compte les minéraux réellement observés: c'est la composition modale . On peut prendre en compte les minéraux virtuels( qui n'ont pu s'exprimer par suite d'un refroidissement trop rapide). On calcule les pourcentages de ces minéraux selon une procédure standard à partir de la composition chimique. On parle alors de norme ou de composition normative. Dans cette classification on tient compte des pourcentages de minéraux clairs: Q- Feldspaths alcalins- Feldspaths plagioclases et feldspathoides. Le triangle du haut comprend les roches excédentaires en silice; le triangle du bas comprend les roches pauvres en silice. Les roches que nous venons d'observer proviennent de la différenciation du magma qui se refroidit. En se refroidissant un magma va donner à partir d'un terme dominant , des termes 3 différenciés de moins en moins basique par suite du phénomène de cristallisation fractionnée. Illustrons ceci à l'aide d'un exercice. Quelle est la nature et la quantité des liquides résiduels, après cristallisation fractionnée, d'un basalte tholéïtique et d'un basalte alcalin. (voir composition normative en minéraux ci- dessous). On considère que ce phénomène a lieu à 1000°C alors que sont cristallisés l'ensemble des oxydes et des silicates ferro-magnèsiens, ainsi qu'un feldspath plagioclase de composition 40% d'albite et 60% d'anorthite; ce plagioclase comprend toute l'anorthite de la norme. minéraux basalte tholéïtique basalte alcalin quartz 5 0 orthose 4 5 albite 20 20 anorthite 25 25 néphéline 0 5 pyroxène 42 21 olivine 0 20 magnétite 4 4 Composition minéralogique d'une rhyolite et d'une phonolite(équivalent microlitique d'une syénite néphélinique). minéraux rhyolite phonolite quartz 32 0 orthose 30 30 albite 25 35 anorthite 5 5 néphéline 0 20 micas, amphiboles 8 10 A 1000°C il reste un liquide résiduel qui a pour composition: Pour le magma tholéitique: Q 5%- Or 4% - Ab 3%. Ce qui correspond à la composition minéralogique d'une rhyolite. Pour le magma alcalin cela donne : Or 5% _ Ab 3% - Nephéline 5%. Ce qui correspond à la composition minéralogique d'une phonolite. Dans l'exemple de la chaine des Puys le magma étant moins alcalin a donné comme terme ultime de la différenciation des rhyolites alcalines. Ces suites de roches liées génétiquement constituent des séries magmatiques . Nous pouvons les reporter sur le diagramme de Streckeisen. Vous remarquez que pour les 3 séries envisagées les termes de départ sont extrémement voisins. On doit donc déjà penser à distinguer différentes sortes de basaltes. 4 Une autre façon de distinguer les différentes séries consiste à se placer dans un diagramme binaire: alcalins- silice. On remarque au passage que la série tholéitique et la série alcaline peuvent trés bien avoir la même proportion de silice mais dans ce cas la proportion d'alcalins est trés différente. On voit d'autre part sur ce diagramme une nouvelle série intermédiaire entre les deux précédentes, on l'appelle la série calco-alcaline. Elle est caractéristique des zones de subduction. On peut aussi étudier les proportions en différents isotopes contenus dans les minéraux. Exemple, le rapport Sr87/ Sr86 est plus élevé dans les roches d'origine crustale que dans les roches d'origine mantellique. ( cela tient à la proportion de Rb 87 plus grande dans l'écorce ). Ici on y adjoint le rapport Nd 143/ Nd 144(Le néodyme provient de la désintégration du samarium). Ce rapport est plus élevé dans les roches d'origine mantellique. On peut donc replacer les séries dans un tel diagramme. Donc tous les arguments concordent pour dire que les basaltes alcalins comme les basaltes tholéitiques ont une origine profonde, mantellique. Des arguments de terrain le confirment. On peut avoir des coulées de basaltes avec des péridotites( donc du manteau). Un magma basaltique a pu échantillonner en remontant des roches du manteau telles que les 5 péridotites. Ou bien encore à la faveur de la tectonique on peut voir des affleurements de péridotites. 2.les différents types de séries magmatiques. On a déjà évoqué la variété des séries magmatiques à propos de leur définition même. Etudions les un peu plus en détail. _ La série calco-alcaline. Voici un cortège qu'on peut rencontrer dans une telle série: Basaltes alumineux-- andésites-- dacites -- rhyolites. Diapo d'andésite. Japon. Volcan Hakone On y voit des plagio(andésine), des pyroxènes(Hypersthène). Rq: " L'andésite de Volvic" est en fait une trachy- andésite . L'étude des isotopes montre une origine mixte , crustale et mantellique. On doit aussi envisager le magmatisme calco-alcalin plutonique. 6 Série de diapos sur le volcanisme andésitique ( Cinder Cone , Californie) et sur les plutons grano-dioritiques ( Yosémite, Californie). On pourrait aussi prendre comme exemple les plutons calco-alcalins de Corse. 7 _ La série Tholéitique. On la replace sur le diagramme de Streckeisen et sur le diagramme binaire. Sur le terrain on peut considérer une série ophiolitique avec de bas en haut: Des péridotites foliées. Des gabbros lités qui indiquent une accumulation de minéraux à cause de la gravité.Phénomène de cristallisation fractionnée. Tout au sommet de la série des basaltes en pillows lavas caractéristiques d'un volcanisme sous-marin. Cette série donne donc un volcanisme de type dorsale et un magmatisme plutonique de type plancher océanique. Si on reprend la comparaison série alcaline-série tholéitique, on constate que des souches basaltiques de composition voisine ont des potentialités évolutives différentes. Si on veut différencier ces souches basaltiques, il faut utiliser des classifications qui vont prendre en compte non plus les minéraux clairs mais les ferro-magnésiens. 8 Poly . On peut éclater ce diagramme en tétraèdre, pour bien distinguer les trois grandes souches basaltiques: -Basanites: sous saturées en silice. - Tholéites à olivine: Pas de Q normatif. - Tholéites à Q ;Q normatif. 9 D'où viennent ces différences minimes entre les trois souches et qui vont induire une évolution ultérieure totalement différente? Ces trois souches doivent provenir d'une fusion du manteau, donc ce sont les conditions de la fusion qui ont du être différentes. B.les conditions de fusion partielle du manteau. Voir aussi logiciel à télécharger Les conditions de la fusion partielle du manteau. (manteau.zip) On a reporté sur ce diagramme P-T : -Le solidus "humide " des péridotites. - Le solidus "sec" des péridotites. - Le liquidus des péridotites. Ainsi que deux géothermes calculées, l'une correspondant au domaine continental, l'autre au domaine océanique. On a noté aussi 3 domaines de stabilité pour des péridotites particulières: Les lherzolites à plagio, à spinelle et à grenats. 1ère remarque: Le manteau n'a aucune raison de fondre dans les conditions naturelles. Les points se trouvent à gauche du solidus sec. Envisageons les cas où il y a fusion: 1er cas. Par suite d'une anomalie thermique locale la T augmente à P constante. Le solidus sec est recoupé. Il y a fusion partielle faible. 2 à 5 % fondent. Les éléments 10 magmatophiles ou incompatibles vont se précipiter dans le peu de liquide . Celui-ci sera donc trés riche en alcalins ( On a vu que les alcalins étaient des éléments incompatibles ). Le magma basaltique formé dans ces conditions sera donc alcalin. C'est ce qui se produit au niveau des points chauds. Ex : îles Hawaï. La fusion a lieu sous une forte pression, 160 à 200 km. 2ème cas. Lorsqu'il y a décompression adiabatique ( c'est à dire sans échange de chaleur avec l'encaissant lors d'une remontée rapide), on constate que la flèche recoupe le solidus. Il y a formation d'un magma à P plus faible et 15 à 30 % de fondu. Le magma sera plus riche en silice. C'est un magma tholéitique. Il se forme dans un autre contexte géodynamique, celui des dorsales. 3ème cas. A P et T constantes, un apport d'eau local peut déplacer la courbe du solidus vers la gauche. A ce moment là le point "devient" liquide, sans que les conditions de P et de T n'aient changées. C'est le cas de la formation des magmas calco-alcalins. Contexte géodynamique: Les zones de subduction. Vous constatez qu'il y a une analogie avec les conditions uploads/s3/ magmatisme 3 .pdf
Documents similaires
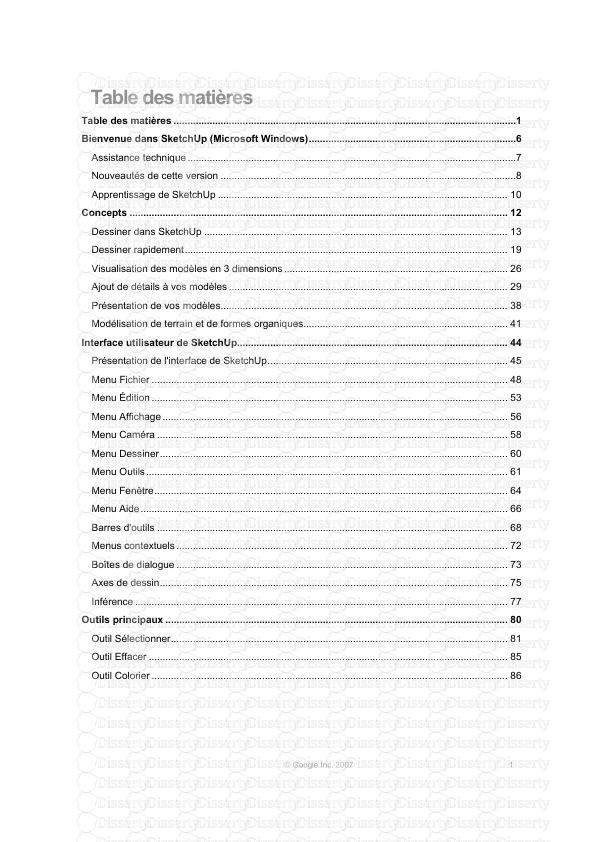

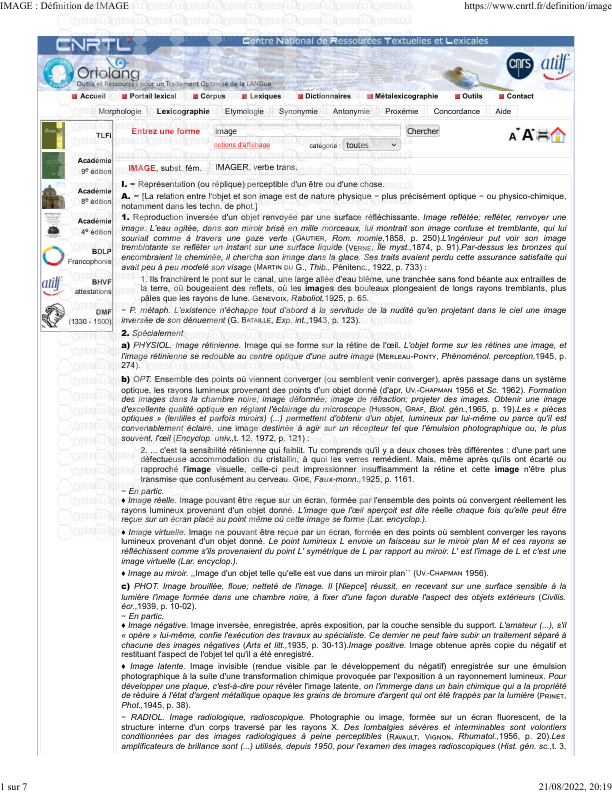







-
96
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 18, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.8733MB


