Les mouvements artistiques d’avant-garde ont utilisé les revues pour développer
Les mouvements artistiques d’avant-garde ont utilisé les revues pour développer et faire connaître leur art. Avant leur développement au début du XXème siècle, nous trouvons quelques exemples des revues appartient à autres esthétiques. Les premières théorisations dans la forme des revues datent de la fin XVIIIème siècle et début XIXème siècle en Allemagne sous le romanticisme. Il s’agissait d’une proposition « intradisciplinaire » appelée Atheneum. Plus tard, quelques impressionnistes ont conçu leurs propres revues dont la première, un projet qui cherchait faire communauté entre les artistes, arrive en 1905 et la deuxième qui a comme but la théorisation de l’art en 1910. Mais la revue impressionniste plus reconnu sorte en 1920, il s’agissait d’un publication hebdomadaire appelé Der Sturm (La Tempête) qui publiait de textes politiques, sur les actions sociales et de textes théoriques. Toutes les avant-gardes sont invitées à collaborer avec eux jusqu’à 1930. Parallèlement en Italie, le futurisme a produit une dizaine de revues dont sa première époque, entre 1909 à 1914, fut la plus productive. Avec ces antécédents, il est normal que les revues périodiques aient été le moteur principal du surréalisme. Elles ont constitué la place où toutes les principales référentes du mouvement ont publié leurs textes, réflexions et exercices d’écriture. Habituellement, dans ces publications nous sommes capables de trouver une quantité des expressions de natures différentes. Les textes et les illustrations qui les composent n’étaient pas seulement des poèmes ou des reproductions du tableaux, ils ont multiplié les formats, les typographies et les dispositions. Pendant un regarde plutôt rapide nous trouvons par le côté texte : des enquêtes, des textes automatiques, des écrits sur différents sujets, des manifestes, des analyses, des œuvres littéraires recommandés par le groupe. Par le côté images, nous apprécions chez la revue des dessins, des photographies et des photomontages. Nous pouvons délimiter deux moments dans l’histoire du surréalisme et les revues. Le premier compose les publications exclusivement du groupe : Littérature et La Révolution Surréaliste, faits entre 1919 jusqu’à 1929, celles qui ont été dirigés dont matériaux ont été sélectionnés par le collective en sa totalité. Le deuxième moment a eu lieu dans l’alliance entre les membres du groupe et l’éditeur de Minotaure Albert Skira et Tériade, une revue fondée en 1933. La présence des femmes chez le groupe surréaliste n’est pas une nouvelle. La plus parte d’elles ont été des amantes, des épouses, des muses et de modèles. Ces artistes ont trouvé chez elles une source d’inspiration, des copines de débats, d’objet de désir. Selon témoignages de l’époque comme ceux que nous trouvons chez biographies comme celle de Dora Maar par l’écrivaine Nora Dujovne, ces femmes étaient aussi artistes silencées par leurs relations avec ces hommes. Le jeu, un de mécanisme plus exploré par les avant- gardes, en particulier par les surréalistes, avait une dimension associée à la vie. N’oublions pas que les surréalistes cherchaient une révolution dans la façon de vivre de l’homme. Il était fréquent les changements de couples, des noms, et l’exercice du pouvoir constante sur ces femmes. Quelques pages avant, nous avons introduit et remarqué l’importance des revues chez le groupe surréaliste. La première revue créée par le groupe a été Littérature dont son premier numéro est sorti en mars 1919 et sa nouvelle série a commencé à être distribué en mars 1920 jusqu’à juin 1924. En la première série nous trouvons un minimum de présence féminine, soit-il dans les textes publiés ou dans la participation en enquêtes réalisés. Nous repérons dans la section « Livres choisis » courtement dirigée par Louis Aragon une seule recommandation d’un titre écrit par une femme. Dans le numéro 9 de Novembre 1919 l’écrivain parle de Voyages en kaléidoscope, avec un titre et un thermomètre d’Irène Hillel-Erlanger, la mention à cet ouvrage paraît être la porte d’entrée de cette femme et l’a donné la chance de participer en la revue dans le prochain numéro avec Par amour et partager son avis sur « Pourquoi écrivez-vous ? », une enquête réalisée entre les numéros 10, 11 et 12. L’analyse des participations dans cet espèce de sondage nous montre que dans le premier numéro la quantité des femmes qui ont partagé leur opinion est seulement de trois sur trente-huit, une sur vingt-sept pour le deuxième numéro et trois sur vingt-huit pour la fin de l’enquête. Finalement, dans le numéro 13 de mai 1920 entre les « Vingt-trois Manifestes du mouvement dada » la présence de la plume d’une femme est appréciée, celle de Céline Arnault. Pour la deuxième série de la revue nous ne verrons pas de collaborations féminines. En deuxième moment, le mouvement fonde une nouvelle revue, La Révolution surréaliste qui a consisté en douze publications entre les années 1924 à 1929. Le premier numéro nous montre dans sa couverture trois photographies du groupe où nous voyons des compagnies féminines. L’image du centre montrait deux femmes présentes et les autres deux, celle à gauche et celle à droit en superposition, affichent une femme chaque une entre les hommes du mouvement. Après l’absence féminine presque totale dans Littérature, ces portraits du groupe semblent nous donner des espoirs ; peut-être, cette fois, la revue aura plus de collaborations d’artistes qui n’ont pas figuré antérieurement. Ce numéro ne concède pas la parole à aucune féminité, mais elles sont présentes comme muses. La militante syndicaliste et anarchiste Germaine Breton a été le centre d’un page dédié aux portraits des membres du groupe surréaliste et l’objet d’inspiration de Louis Aragon dans son écriture. Le curieux montage à la page 17 qui occupe toute la surface est accompagné par ces lignes de Charles Baudelaire : « La femme est l’être qui projette la plus grande ombre ou la plus grande lumière dans nos rêves ». La femme est la chance et la perdition, la source inspiratrice et le démon de cette force motrice pour l’art surréaliste qui est le rêve, et nous ajoutons l’inconscient. L’anarchiste n’est pas la seule femme représentée dans ce numéro, quelques pages plus tard nous voyons un montage qui présente une femme en sortant de la douche et la figure d’un homme l’accompagne avec le regard en blanc, perdu. L’expression dans le visage de cette femme avec le geste corporel insinuent une attitude sensuelle, il est clair qu’elle est objet de regard, de désir. Contreraient à son prédécesseur, La Révolution Surréaliste ne compte pas avec des collaboratrices ni les éditeurs recommandent des ouvrages écrits par des femmes. La minuscule présence se trouve seulement dans une enquête publiée en le dernier exemplaire ; la consigne : « Quelle sorte d’espoir mettez-vous l’amour ? », la seule réponse par une femme, celle de Valentine Penrose. Au long des numéros, il se constate en le changement de voie faite pour les surréalistes, c’est-à dire, une mayeur espace pour les arts plastiques que celle occupée dans les derniers numéros de Littérature, une allure des œuvres joués par des femmes. La femme est muse et objet, soit-il de beauté, sensualité ou de ridicule, nous n’oublions pas que l’humeur est centrale pour ce mouvement. Nous considérons que pour faire une meilleure analyse de notre corpus photographie il ne suffit pas de compter les caractéristiques du surréalisme ou de la femme surréaliste. Même le regard minutieux des revues est insuffisant. Il est important considérer que le surréalisme a fondamentalement un bas littéraire, car ils ont été les écrivains qui ont théorisé et ont construit le groupe comme nous le connaissons aujourd’hui. Faire une lecture de toutes les œuvres liées au surréalisme, ou même de l’époque, est pertinent pour une compression totale de l’époque, mais nous avuons qu’il est impossible, car la quantité des textes est énorme. Même si nous aurons voulu lire la totalité des œuvres surréalistes, ou au minimum des productions littéraires et théoriques des participants du groupe, notre objet aurait été très ambitieux. La plupart des textes sur le sujet coïncident qu’André Breton a été l’auteur plus important pour le mouvement car il a écrit des textes fondateurs qui essaient de condenser la doctrine surréaliste. Tout mouvement littéraire et artistique, en général, acquise une dimension plus spécifique que leurs théories quand une œuvre est analysée. La lecture des chercheurs et critiques littéraires, et même les textes qui parlent des idées du même groupe ne nous donnent pas une image complète de notre sujet d’étude : la représentation de la femme. Pour mieux analyser, mieux comprendre et mieux regarder, nous croyons important l’analyse d’une œuvre phare du surréalisme qui a comme personnage principale une femme : Nadja d’André Breton. Au début, nous avons considéré une lecture profonde de la trilogie, Les Vases communicants et L’Amour fou, mais la figure de Nadja était si puissante qu’élargir notre corpus littéraire avait signifié rester dans la littérature et notre but principal est utiliser les deux arts ensembles pour mieux parler d’une époque. Nadja condense l’archétype de femme surréaliste et elle peut être utilisée comme exemple du mouvement. Les femmes qui viennent après elle, sont des réversions de cette femme surréaliste originale. Nous parlons d’un groupe conformé visiblement par des hommes, visiblement parce uploads/s3/ revues-et-nadja.pdf
Documents similaires








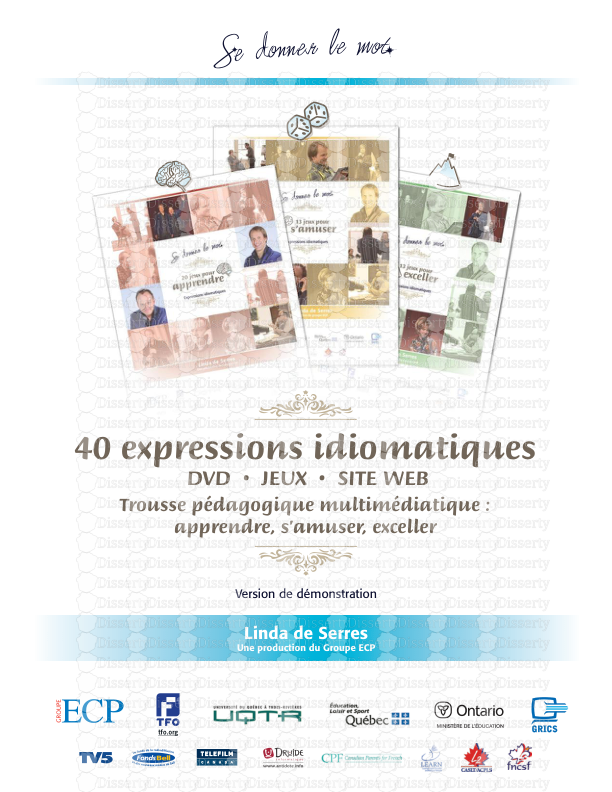

-
79
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 09, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0663MB


