Roland Barthes et Cy Twombly : le « champ allusif de l'écriture » Author(s): Ri
Roland Barthes et Cy Twombly : le « champ allusif de l'écriture » Author(s): Richard Leeman Source: Rue Descartes , Décembre 2001, No. 34, ROLAND BARTHES APRÈS ROLAND BARTHES (Décembre 2001), pp. 61-70 Published by: Presses Universitaires de France Stable URL: https://www.jstor.org/stable/40978665 JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org. Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at https://about.jstor.org/terms Presses Universitaires de France is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Rue Descartes This content downloaded from ������������178.197.232.157 on Wed, 17 Nov 2021 14:25:09 UTC������������ All use subject to https://about.jstor.org/terms Richard Leeman Roland Barthes et Cy Twombly : le « chamo allusif de l'écriture » L'artiste américain Cy Twombly a eu pendant longtemps une carrière assez confidentielle. Bien quii ait partagé avec son ami Robert Rauschenberg les premiers scandales des successeurs de l'Expressionnisme abstrait, et bien qu'il ait été pris en charge par le galeriste Leo Castelli chez qui sont passés les plus grands artistes américains de cette génération, Twombly n'a pas eu de recon- naissance immédiate, ce qu'il faut attribuer à la fois à son installation en Italie à la fin des années cinquante et à une œuvre difficile et relativement inclassable, en tout cas dans les termes de l'historiographie américaine. En France, et à l'exception d'une discrète exposition organisée par Pierre Restany en 1961, Twombly apparaît sur la scène artistique avec deux expo- sitions chez Yvon Lambert en été 1971 et au printemps 1974. Très vite le galeriste entreprend un catalogue raisonné des œuvres sur papier de la période 1973-1976, dont il demande à Roland Barthes d'écrire la préface x. Cette préface, intitulée « Non multa sed multum », est datée de 1976 et le catalogue paraît en 1979. C'est à cette date que le musée Whitney d'Art américain organise la première grande rétrospective de l'artiste à New York ; celui-ci demande à Barthes d'écrire un nouveau texte pour la préface du catalogue. Ce texte, « Sagesse de l'art », est écrit, si l'on en croit un passage, dans la nuit du 31 décembre 1978, et reprend pour l'essentiel le premier, quoique dans une construction assez différente 2. 1 . Yvon Lambert avait aussi demandé à Michel Foucault d'écrire un texte sur Twombly, mais cela n'intéressait pas le philosophe (conversation avec l'auteur, 1997). 2. Le texte de 1976 cultive une écriture du fragment, « a sauts et a gambades » : la construction de l'essai se fonde sur la succession de six thèmes de longueur variable (« écri- ture », « culture », « gauche », « support », « corps », « moralité »), à l'intérieur desquels des paragraphes indépendants ne suivent pas particulièrement une marche argumentative - plu- tôt associative. Le texte de 1 978 est plus construit, soumis à un dessin d'ensemble : les cinq parties (numérotées) sont annoncées dans l'introduction comme le développement de cinq This content downloaded from ������������178.197.232.157 on Wed, 17 Nov 2021 14:25:09 UTC������������ All use subject to https://about.jstor.org/terms 62 RICHARD LEEMAN Entre 1976 et 1979, Entre le Roland Barthes par Roland Banhes et chambre claire, ces deux textes éclairent la pensée de Barthes non seulem sur l'œuvre de Twombly, mais sur la question de l'écriture. UNE EROTIQUE DU GESTE Une part de l'œuvre de Twombly consiste en ce que la critique a fo malencontreusement rapproché du graffiti, mais plus justement du griboui lis (planches 1 et 2). Twombly raconte avoir fait certains de ses prem dessins dans le noir, lors de son service militaire, ce que Barthes comm ainsi : « [...] le "gauche" (ou le "gaucher") est une sorte d'aveugle : il ne voit pas bien la direction, la portée de ses gestes ; sa main seule le guide, le désir de sa main, non son aptitude instrumentale ; l'œil, c'est la raison, l'évidence, l'empirisme, la vraisemblance, tout ce qui sert à contrôler, à coordonner, à imiter, et comme art exclusif de la vision, toute notre peinture passée s'est trouvée assujettie à une rationalité répressive. D'une certaine façon, Twom- bly libère la peinture de la vision, car le "gauche" (le "gaucher") défait le lien de la main et de l'œil : il dessine sans lumière (ainsi faisait Twombly, à l'armée) » (TVA/, 9) l. Cette phrase fournit à elle seule une définition remarquable de ce que l'histoire de l'art appelle classiquement le disegno, que l'on traduit, faute de mieux, par dessin, quoique le sens en soit plus général. Par son activité héritée de l'automatisme, Twombly libère, en somme, le dessin (activité graphique) du disegno (principe rationnel de la peinture). La question d'un dessin qui, selon les termes de Barthes, assujettit la peinture à une rationalité répressive, se doit immanquablement d'être resi- tuée dans son opposition historique à la couleur. Une anecdote du Roland Barthes rappelle la lutte de sa propre gaucherie dans la petite société du lycée : « [...] je dessinais, par contrainte, de la main droite, mais je passais la couleur de la main gauche : revanche de la pulsion » (RB, 102). catégories d'événements : pragma (fait), tyché (hasard), telos (issue), apodeston (surprise), drama (action), chaque catégorie pouvant également se subdiviser - il y a par exemple plusieurs types de faits : griffure, tache, salissure, noms. 1 . Du point de vue neuro-sensoriel, l'exécution du geste d'écrire ou de dessiner s'accom- pagne d'un double contrôle, sensitifçx. visuo-manuel. Twombly, se privant de l'œil, laisse à sa seule main la « responsabilité » de la ligne. This content downloaded from ������������178.197.232.157 on Wed, 17 Nov 2021 14:25:09 UTC������������ All use subject to https://about.jstor.org/terms Roland Barthes et Cy Twombly : le « champ allusif de récriture » 63 Le gauche et la couleur se voient ici associés dans une même pulsion. Le commentaire de Barthes trouve ainsi un écho dans celui, contemporain, de Jean-Claude Lebensztejn selon lequel « l'histoire de la couleur dans l'art occidental, entre la Renaissance et l'impressionnisme, est avant tout l'his- toire d'un refoulement » l. Précisément : « Mais qu'est-ce que la couleur ? une jouissance » (NM, 10). Dans « Sagesse de l'art », ne subsiste de l'isotopie de la jouissance qu'un passage à la fin - qui éclaire le titre du texte et la nature de cette sagesse. Parlant du désir de faire la même chose et de l'exploration par le spectateur de son impuissance face à la puissance de l'artiste : « Voici Age of Alexander : oh, cette seule traînée rose... ! Je ne saurais jamais la faire aussi légère, raréfier l'espace autour d'elle ; je ne saurais pas m 'arrêter de remplir, de continuer, bref de gâcher ; et de là, de mon erreur même, je saisis tout ce qu'il y a de sagesse dans l'acte de l'artiste : il se retient dV« vouloir trop ; sa réussite n'est pas sans parenté avec l'erotique du Tao : un plaisir intense vient de la retenue » (SA, 21). L'expression de la jouissance graphique (où Barthes réhabilite paradoxale- ment un certain contrôle) prend ici la forme d'une écriture elle-même orgas- tique dans son rythme, en particulier dans le jeu de l'exclamation (« oh, cette seule traînée rose... ! ») précédée graphiquement d'une suspension (la retenue). L'érotisme de l'écriture réside donc en première analyse dans la jouissance gestuelle d'une activité rhéologique - comme le dit plus vigoureusement Philippe Sollers : « à la force du poignet qui tourne » 2. Mais cette jouissance de geste n'est qu'une part de ce qui est ici en jeu. GLISSEMENT II n'est sans doute pas innocent que, dans NM, le commentaire que fait Barthes de la condamnation morale de l'anomalie, de la déficience, de la faute du gauche y associe une autre « métaphore sentimentale » : 1. Jean-Claude Lebensztejn, « Les textes du peintre », Critique n° 324, mai 1974 : 400- 433 2. Philippe Sollers, « Les epiphanies de Twombly », in Yvon Lambert (éd.), Catalogue raisonné des œuvres sur papier de Cy Twombly, vol. VII, 1977-1982, Milan, Multipha, 1991, p. 10. This content downloaded from ������������178.197.232.157 on Wed, 17 Nov 2021 14:25:09 UTC������������ All use subject to https://about.jstor.org/terms 64 RICHARD LEEMAN « [...] de même voit-on, dans un autre coin de notre langue, une mét phore sentimentale donner son nom à une substance toute physiqu l'amoureux qui s'enflamme, X amado, devient paradoxalement le nom toute matière conductrice du feu : X amadou » (NM, 8). Dans NM, Barthes énonce ainsi l'idée de X essence de la trace de Twombly « Réfléchissons par comparaison. Qu'est-ce que l'essence d'un pantalon (s'il en a une) ? Certainement pas cet objet apprêté et rectiligne que l'o trouve sur les cintres des grands magasins ; plutôt cette boule d'étoffe ch par terre, négligemment, de la main d'un adolescent quand il se déshabi exténué, paresseux, indifférent. uploads/s3/ roland-barthes-et-cy-twombly-le-champ-allusif-de-l-x27-ecriture.pdf
Documents similaires



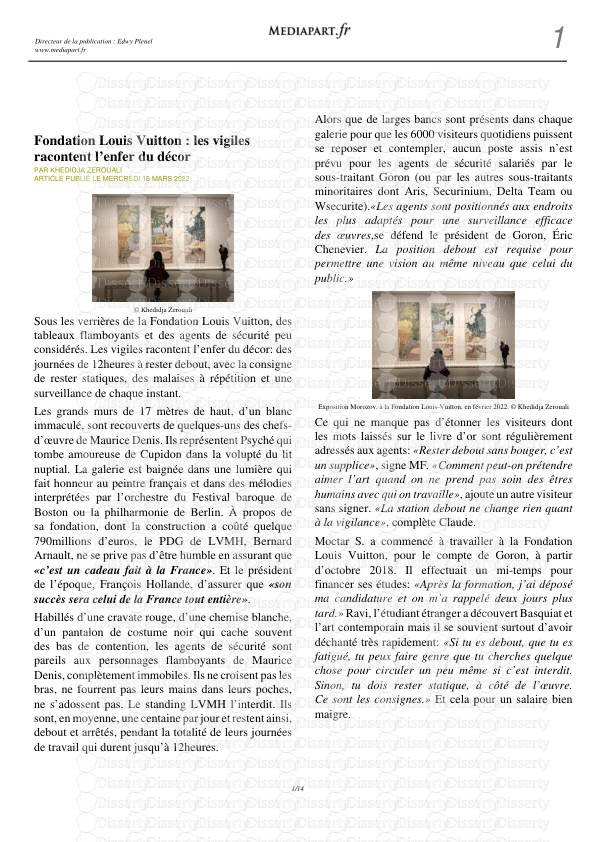






-
51
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 25, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.3925MB


