FAITES-MOI SIGNES - support de cours techno com - B.T.S. CV1 2008 Marc VAYER pa
FAITES-MOI SIGNES - support de cours techno com - B.T.S. CV1 2008 Marc VAYER page 1 RÉFÉRENT / SIGNIFIANT / SIGNIFIÉ Différenciation entre image et signe En communication visuelle, produire du sens, c’est envoyer des signes. Si l’on veut construire des signes pertinents, il faut s’attaquer à l’étude des signes, c’est à dire une discipline qu’on appelle sémiologie. Toujours par analogie avec le domaine linguistique, pour les images, la sémiologie est une approche qui permet d’analyser la signification ou la production de sens. Sémiologie vient du grec semeion : signe + logos : discours. Dans le monde médical, il s’agit d’interpréter les signes que sont les symptômes ou syndromes (ensemble de symptômes). Dans le domaine linguistique, on uti- lise le terme sémiotique, très proche, philosophie du langage, mais aussi étude des langages particuliers (image, cinéma, peinture, littérature, etc.) C’est d’ailleurs dans ce champ linguistique que Pierce a élaboré une théorie des signes (1867), vraiment étudiée à partir de 1970 en France, et que l’on peut transposer dans l’univers des signes visuels. En sémiologie, il faut d’abord bien distinguer la définition du mot signe par rapport à celle du mot image. L’image : Peut être reflet, illustration, ressemblance, projection mathématique, souvenir, illusion, réputation, mentale, métaphore. Dans tous les cas, c’est quelque chose qui ressemble à quelque chose d’autre. En communication visuelle, c’est une représentation analogique, imitative, principalement visuelle (elle peut aussi être associée à d’autres sens : son, toucher, odeur, …). Yasuko Najima (1889-1964) Torse de femme, 1930 « Avec un ami, nous contemplions et commentions la reproduction d’une photo de Yasuko Nodjima dans un livre de Ferrante Ferranti. Cette photographie était l’image d’une magnifique jeune femme se peignant les cheveux. La compagne de mon ami l’interpelle : — « Que faites-vous ? » — « On regarde une femme », puis, se reprenant : — « On regarde l’image d’une femme ». Cette anecdote nous rappelle qu’il est très facile et rapide de confondre, par le langage utilisé, l’image et la réalité. C’est d’ailleurs, bien-sûr , le phénomène que met en valeur le tableau de Magritte « la pipe ». FAITES-MOI SIGNES - support de cours techno com - B.T.S. CV1 2008 Marc VAYER page 2 En 1966, Magritte qui vient de lire les mots et les choses adresse à l’auteur, Michel Foucault, une reproduction de son célèbre tableau Ceci n’est pas une pipe en prenant soin d’ajouter au verso : « Le titre ne contredit pas le dessin ; il affirme autrement ». Si la précision lui a semblé nécessaire c’est sans doute que le malentendu était à craindre. Mais de quel malentendu pouvait-il s’agir ? Le tableau lui-même ne paraît être plus simple, plus lisible : l’image d’une pipe, d’une pipe dépourvue de toute singula- rité, l’archétype d’une pipe en quelque sorte. Le trouble provient des mots ajoutés par le peintre à son tableau, des mots qui font corps avec lui, en sont indissociables : «Ceci n’est pas une pie la chose et sa représentation, le réel et son image. (...) L’injonction du regard par Gérard Collas ”Images documentaires” 32/33 Nulle part, il n’y a de pipe. A partir de 1à, on peut comprendre la dernière version que Magritte a donne de Ceci n’est pas une pipe. En plaçant le dessin de la pipe et l’énonce qui lui sert de légende sur la surface bien clairement délimitée d’un tableau (dans la mesure ou il s’agit d’une peinture, les lettres ne sont que l’image des lettres; dans la mesure ou il s’agit d’un tableau noir, la figure n’est que la continuation didactique d’un discours), en plaçant ce tableau sur un trièdre de bois épais et solide, Magritte fait tout ce qu’il faut pour reconstituer (soit par la pérennité d’une oeuvre d’art, soit par la vérité d’une leçon de choses) le lieu commun à l’image et au langage. Tout est solidement amarré a l’intérieur d’un espace scolaire: un tableau « montre » un dessin qui « montre » la forme d’une pipe; et un texte écrit par un instituteur zélé « montre » que c’est bien d’une pipe qu’il s’agit. L’index du maître on ne le voit pas, mais il règne partout, ainsi que sa voix, qui est en train d’articuler bien clairement: « ceci est une pipe ». Du tableau à l’image, de l’image au texte, du texte à la voix, une sorte d’index général pointe, montre, fixe, repère, impose un système de renvois, tente de stabiliser un espace unique. Mais pourquoi ai-je introduit encore la voix du maître ? car à peine a-t-elle dit « ceci est une pipe » qu’elle a du aussi se reprendre et balbutier: « ceci n’est pas une pipe, mais le dessin d’une pipe », « ceci n’est pas une pipe mais une phrase disant que c’est une pipe », « la phrase: « ceci n’est pas une pipe » n’est pas une pipe »; « dans la phrase « ceci n’est pas une pipe », ceci n’est pas une pipe: ce tableau, cette phrase écrite, ce dessin d’une pipe, tout ceci n’est pas une pipe ». Les négations se multiplient, la voix s’embrouille et s’étouffe; le maître confus baisse l’index tendu, tourne le dos au tableau, regarde les élèves qui se tordent et ne se rend pas compte que s’ils rient si fort, c’est qu’au-dessus du tableau noir et du maître bredouillant ses dénégations, une vapeur vient de se lever qui peu à peu a pris forme et maintenant dessine très exactement, sans aucun doute possible, une pipe. « C’est une pipe, c’est une pipe » crient les élevés qui trépignent tandis que le maître, de plus en plus bas, mais toujours avec la même obstination, murmure sans que personne ne l’écoute désormais: « et pourtant ceci n’est pas une pipe ». Il n’a pas tort: car cette pipe qui flotte si visiblement au-dessus de la scène, comme la chose à laquelle se réfère le dessin du tableau noir, et au nom de laquelle le texte peut dire à juste titre que le dessin n’est pas vraiment une pipe, cette pipe elle-même n’est qu’un dessin; ce n’est point une pipe. Pas plus sur le tableau noir qu’au-dessus de lui, le dessin de la pipe et le texte qui devrait la nommer ne trouvent ou se rencontrer et s’épingler l’un sur l’autre comme le calligraphe avec beaucoup de pré- somption, avait essaye de le faire. Alors, sur ses montants biseautés et si visiblement instables, le chevalet n’a plus qu’à basculer, le cadre à se disloquer, le tableau à rouler par terre, les lettres à s’éparpiller, la « pipe » peut « se casser »: le lieu commun— oeuvre banale ou leçon quotidienne—a disparu.[...] Mais l’énoncé, ainsi articule deux fois déjà par des voix différentes, prend à son tour la parole pour parler de lui-même: « Ces lettres qui me composent et dont vous attendez, au moment où vous entreprenez de les lire qu’elles nomment la pipe, ces lettres, comment oseraient-elles dire qu’elles sont une pipe, elles qui sont si loin de ce qu’elles nomment ? Ceci est un graphisme qui ne ressemble qu’à soi et ne saurait valoir pour ce dont il parle ». Il y a plus encore: ces voix se mêlent deux a deux pour dire, parlant du troisième élément, que « ceci n’est pas une pipe ». Liés par le cadre du ta- bleau qui les entoure tous deux, le texte et la pipe d’en bas entrent en complicité: le pouvoir de désignation des mots, le pouvoir FAITES-MOI SIGNES - support de cours techno com - B.T.S. CV1 2008 Marc VAYER page 3 Le signe : « Donner signe de vie, présenter des signes de fatigue, faire un signe d’amitié, s’exprimer par signes, voir un bon ou mauvais signe, nuages signe de pluie, fais-moi un signe dès que tu seras prêt, tu es né sous quel signe ? ». Le signe, c’est ce qui est à la place de quelque chose d’autre. L’image n’est pas un signe, mais une texte, tissu mêlés de différents types de signes qui nous parlent « secrè- tement ». « Le sémiologue est celui qui voit du sens là où les autres voient des choses » (Umberto Eco) et donc qui « montre, avec un minimum de preuves, quelles significations et quelles interprétations peuvent produire ces choses ». (Martine Joly) Le signe est, lui, une entité à deux faces : le signifié (c’est le concept et non pas l’objet) ————— le signifiant (c’est la face matérielle et perçue du signe) Pictogrammes utilisés pour la signalétique des Jeux Olympiques d’Athènes, en 2004, • Le signifié de ces quelques pictogrammes, c’est la discipline sportive à Athènes, en 2004, en Grèce. • Le signifiant de ces quelques pictogrammes, c’est un dessin simplifié représentant un athlète en action sur un « tesson » de terre cuite. Sur la base de cette relation simple signifié/signifiant, on pourra alors commencer à analyser le signe, jusqu’à pousser très loin, par de multiples compléments d’informations. Par exemple, lorsque l’on sait que la premiére uploads/s3/ technocoma-2008-pdf.pdf
Documents similaires
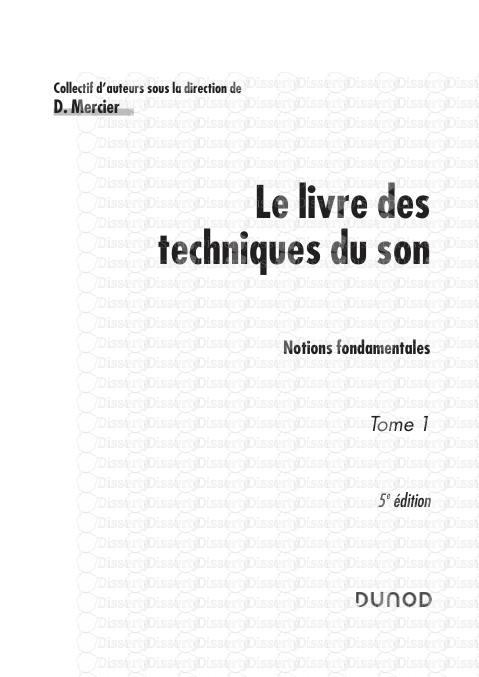









-
80
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 27, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.3050MB


