L’OCCIDENT ET LES AUTRES 155 L'Ornement est-il animiste ? Thomas Golsenne Un hi
L’OCCIDENT ET LES AUTRES 155 L'Ornement est-il animiste ? Thomas Golsenne Un historien de l’art qui étudie l’ornement est à peu près comme un oiseau qui étudierait la vie des poissons : c’est contre nature. Le concept d’art s’est en effet construit contre celui d’ornement et Ernst Gombrich a pu dire que l’histoire de l’art moderne est l’histoire du rejet de l’ornement hors de la sphère artistique 1. Depuis que Leon Bat- tista Alberti a rangé, en 1435, la peinture au sein des arts libéraux 2, les arts plastiques se sont progressivement détachés de l’artisanat ; l’œuvre d’art s’est vue dotée d’une dignité supérieure à celle de l’objet d’art. La modernité, dans ce sens, a poursuivi le chemin accompli depuis cinq siècles : Adolf Loos, écrivant en 1908 son essai Ornement et Crime, n’écrit pas seulement un manifeste du modernisme : il accomplit l’aboutissement de ce mouvement. Dans cet écrit comme dans d’autres de la même époque, il affi rme avec verve l’incompatibilité de l’ornement avec la vie moderne, la production industrielle et la démocratisation. La libération de l’art vis-à-vis de l’ornement est ainsi interprétée comme le signe d’une émancipation sociale et d’un progrès de la civilisation : « Les temps barbares où ont été amalgamés œuvres d’art et objets usuels sont défi nitivement révolus. Pour le salut de l’art. Car le dix- neuvième siècle se verra un jour consacrer un grand chapitre de l’histoire de l’humanité : nous lui sommes redevables de cet exploit d’avoir amené la rupture claire et nette entre art et artisanat 3. » Il n’est pas étonnant dès lors que les ethnologues contemporains de Loos se soient passionnément intéressés aux productions ornementales des peuples qu’on appelait alors « primitifs » : puisque l’absence d’ornement dans l’art est la signature de la civili- sation occidentale moderne, la présence d’ornement exprime logiquement le caractère primitif des autres sociétés. Prenons par exemple, comme témoin tardif de cette époque, le Manuel d’ethnographie de Marcel Mauss, publié en 1947 ; on y trouve écrit que « l’or- nementique est beaucoup plus développée dans ces sociétés [primitives] que chez nous » ; ou bien que « dans l’ensemble, il semble que c’est dans nos sociétés occidentales que la non-décoration des objets mobiliers s’accentue. La décoration est attestée à partir de L’ORNEMENT EST-IL ANIMISTE ? 1. Gombrich 1992. 2. Alberti (1435) 2004. 3. Loos (1908) 2003, p. 68. 156 l’Aurignacien » 4. Bref, l’ornementation serait une tendance universelle que seule notre société moderne aurait contrariée. Si bien que le point de vue de l’anthropologue sur l’ornement est radicalement inverse de celui de l’historien de l’art ou de l’artiste moder- niste : pour le premier, l’ornement constitue la base de son répertoire esthétique ; pour les seconds, il constitue un péché. Cependant, tous s’accordaient, au début du XXe siècle, à reconnaître l’importance de l’ornement au moins dans les temps les plus reculés de l’humanité. Comme les socié- tés primitives représentent un état moins avancé de la civilisation que la nôtre, pen- saient-ils, l’ornement représente l’état primitif de l’art, l’art sous sa forme archaïque. C’est l’opinion de Loos qui écrit : « La pulsion qui pousse quelqu’un à ornementer son visage et tout ce qui peut s’atteindre est le tout premier commencement des arts plastiques. C’est le balbutiement de la peinture 5. » L’idée était déjà présente chez Gottfried Semper, dont les travaux sur les origines de l’architecture pendant les années 1850 ont généré un tout nouveau ton dans l’histoire de l’art – un ton anthropologique : « Le fait remarquable est que maintes de ces manifes- tations archaïques et sauvages de l’instinct de parure se perfectionnèrent au cours des siècles chez les peuples civilisés, et perdurèrent chez eux, au moins au travers d’allusions symboliques 6. » Ce « ton anthropologique » exprimait une volonté de rompre avec l’histoire de l’art à la fois post-winckelmannienne (fondée sur la suprématie absolue de l’art grec et, plus généralement, de l’art européen) et érudite qui dominait dans les pays germa- niques : le rapprochement avec l’anthropologie permettait une élévation philosophique de l’histoire de l’art. Parmi les héritiers de Semper, Alois Riegl, l’inventeur du concept de Kunstwollen, fut le premier à utiliser une méthode comparative qui vise à dépasser la vision progressiste de l’histoire de l’art traditionnelle. Riegl n’hésitait pas à lier l’histoire des beaux-arts et celle des arts décoratifs, l’étude de l’art européen et celle de l’art pri- mitif. Son premier grand livre, Questions de style (1894), résulte de cette approche anti- académique et établit les premiers jalons d’une histoire de l’ornement, qui soit aussi une histoire des origines anthropologiques de l’art. Il y écrit notamment : « La parure répond à l’un des besoins les plus élémentaires de l’homme, plus élémentaire même que celui de protéger le corps 7. » 4. Mauss 2002, p. 138 et 148. 5. Loos (1908) 2003, p. 72. 6. Semper 2007, p. 236. 7. Riegl (1894) 2002, p. 30. L’OCCIDENT ET LES AUTRES 157 L'Ornement est-il animiste ? Recueillant l’essentiel de la pensée de Riegl, Wilhelm Worringer reprit cette idée dans Abstraction et Einfühlung (1911), en y voyant la manifestation du Kunstwollen : « C’est un trait essentiel de l’ornementation que le vouloir artistique d’un peuple trouve dans ses produits l’une de ses expressions les plus pures et les plus claires 8. » Autrement dit, non seulement l’ornement précède historiquement l’art comme le disaient Riegl ou Mauss : il occupe, selon Worringer, une place non plus primitive, mais primordiale dans l’expression artistique d’une société, quelle qu’elle soit, où qu’elle se situe dans l’histoire et dans l’espace. Parce qu’ils connaissaient les travaux des ethnologues de leur époque, parce qu’ils abordaient leurs problèmes artistiques avec un questionnement anthropologique, des historiens de l’art comme Riegl et Worringer pouvaient ainsi prendre l’ornement comme un objet d’étude de première importance et revisiter l’histoire de l’art occidental du point de vue ornemental ; d’où les études fameuses de Riegl sur l’art romain tardif et sur l’art baroque, d’où l’essai de Worringer sur l’art gothique 9 – mouvements artistiques où l’ornement joue un grand rôle et qui étaient justement à cause de cela réputés comme décadents 10. Cependant, leur revalorisation de l’ornement et de ses incarnations historiques était limitée par deux idées d’époque. La première, on l’a vu, est que l’ornement serait plus primitif que l’art. La seconde est que l’ornement serait lié à l’abstraction, par oppo- sition à l’art qui serait lié à la fi guration. Dans le débat sur l’origine de l’art, Riegl pen- chait pour une origine fi gurative de l’art – tout ornement, même le plus géométrique, serait la stylisation d’un motif fi guratif 11. Worringer penchait pour l’hypothèse de l’ori- gine abstraite de l’art – l’ornement l’emporte sur la fi gure comme le sentiment abstrait précède le sentiment empathique eu égard à la nature 12. L’association entre l’ornement et l’abstraction est une idée commune à l’époque et aujourd’hui encore ; on la trouve par exemple dans le livre d’Alfred Gell, Art and agency 13. Elle dérive sans doute du préjugé occidental selon lequel il n’y a d’art véritablement civi- lisé (c’est-à-dire non ornemental) que fi guratif ; et aussi de l’observation que, jusqu’au XXe siècle, des formes abstraites n’apparaissaient que dans les motifs ornementaux. Il est facile pourtant de constater que les motifs ornementaux ne sont ni abs- traits ni fi guratifs a priori. On pourrait citer de nombreux exemples, notamment issus de traditions artistiques non européennes, où l’ornementation peut être interprétée dans 8. Worringer 1986, p. 83. 9. Riegl (1927) 1964 ; Worringer (1907) 1993 ; Worringer (1927) 1967. 10. On pourrait ajouter le nom d’Aby Warburg, qu’on n’associe pas immédiatement au thème de l’ornement, alors que celui-ci joue un rôle non moins important dans sa théorie générale de l’art que dans ses études sur la Renaissance italienne. Sur le premier aspect, voir par exemple sa lettre à Mary Hertz (1894) citée dans Gombrich 1986, p. 81. 11. Riegl (1927) 1964, p. 47 et suiv. 12. Worringer 1967, p. 41 et suiv. 13. Gell 1998, p. 73. 158 Karl von den Steinen, Les Marquisiens et leur art. L’ornementation primitive des mers du Sud. Édition française / Musée de Tahiti et des îles - Te Fare Iamanaha, 2005, vol. 1, fig. 76. L’OCCIDENT ET LES AUTRES 159 L'Ornement est-il animiste ? les deux sens. Les tatouages des Marquisiens, naguère étudiés par Karl von den Steinen, fournissent un premier cas exemplaire. À première vue, ces tatouages sont abstraits ; en fait, la plupart représentent de manière codifi ée des animaux ou des personnages : papua = enclos ; kake = arc ; kea = tortue ; mata hoata = regard ; puhi = anguille ; pohu = héros de légende. Il s’agit d’une écriture corporelle, pictographique et ornementale à la fois 14. Plus familier à l’œil occidental, l’art islamique est réputé aniconique, à cause de l’in- terdit religieux de la fi gure vivante, donc abstrait, donc ornemental. Or beaucoup d’exemples montrent que les artistes en terre d’Islam ont su jouer sur la frontière fragile uploads/s3/ thomas-golsenne-lornement-est-il-animiste-pdf.pdf
Documents similaires






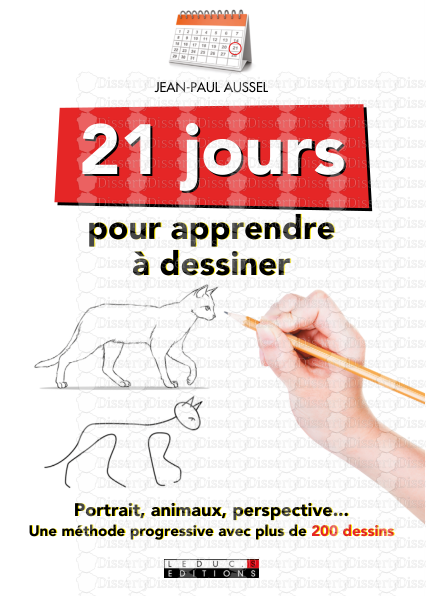



-
84
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 08, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3234MB


