1- DETERMINONS LES FORMES D’HUMOUR À PARTIR DE CHACUN DES DOCUMENTS PUIS ILLUST
1- DETERMINONS LES FORMES D’HUMOUR À PARTIR DE CHACUN DES DOCUMENTS PUIS ILLUSTREZ LES 2- INTERPRETEZ CHACUNE DES FORMES HUMORISTIQUE ? Relevés Textuel Analyse Interprétation << meilleur des mondes>>. <<Après avoir assouvi les besoins de quelques euros>> << boucherie héroïque>>, << des héros avares>>. -Un humour noir. -Périphrase et euphémisation du viol L’humour et l’ironie dans Candide et dans la littérature signifie humour grotesque, utilisé pour exprimer l’absurdité et l’insensibilité de la geurre dans le monde. -<<bon exemple de cette technique dans Candide vient ce chapitre ,peu de temps après le tremblement de terre qui a détérioré Lisbonne que Candide et Pangloss arrivent là.>> -Un humour noir Il est présenté ici une scène de carnage et de mort dans la ville en ruines ; <<Du fenouil, de l’aneth, de la marjolaine, des roses » < Notez que les chapeaux sont les uns ras, les autres velus, les autres veloutés, les autres en taffetas, les autres satinés. Le meilleur de tous est celui de fourrure. Car il enlève très bien la matière fécale.>>. Terme comique l nous fait rire avec un sujet trivial, un humour bouffon et scatologique qui touche aussi à l’absurde 3- PROPOSEZ UN PLAN Dans notre étude, nous étudierons d’abord l’humour dans << CANDIDE, QUI TREMBLAIT COMME UN PHILOSOPHE, SE CACHA DU MIEUX QU’IL PUT PENDANT CETTE BOUCHERIE HÉROÏQUE>> et ensuite nous présenterons l’humour dans << IL N’Y A EN MATIÈRE DE TORCHE CUL RIEN DE TEL QU’UN OISON BIEN DUVETEUX>> nous présenterons l’humour utilisé dans << VOUS ETES CAPABLE DE TOUT, MÊME D’UNE BONNE ACTION>> et enfin dans << IL N’Y EN A PAS UN QUE JE N’AI PAS COUVERT DE HONTE>> INTRODUCTION Pour célébrer le début de ce troisième millénaire, la partie thématique de la revue du XVIIIe siècle est consacrée à l’humour ( au rire) . Au-delà du symbole, il s’agit surtout de rendre compte du dynamisme et de l’important renouvellement des travaux sur l’humour qui se sont effectués depuis une dizaine d’années, et de poser des jalons pour des recherches ultérieures. La question de l’humour a déjà été abordée par RIVAROL dans Les Actes des Apôtres, par RABELAIS dans Gargantua,et par VOLTAIRE dans Candide ou l’optimisme. Dans notre étude, nous étudierons d'abord l’humour utilisé par Voltaire et ensuite nous présenterons l’humour utilisé par Rabelais et enfin nous présenterons l’humour utilisé par Rivarol. I- FORME ET CARACTÉRISTIQUES DE L’HUMOUR 1-CARACTERISTIQUE DE L’HUMOUR L'humour est un état d'esprit, une manière d'utiliser le langage, un moyen d’expression. L’humour peut être employé dans différents buts et peut, par exemple, se révéler pédagogique ou militant. Protéiforme, il se retrouve dans un nombre abondant de discours et de situations. Sa forme, plus que sa définition, est diversement appréciée d'une culture à l'autre, d'une région à une autre, d'un point de vue à un autre, à tel point que ce qui est considéré par certains comme de l'humour peut être considéré par d'autres comme une méchante moquerie, une insulte ou un blasphème. Toutefois, rire est bon pour la santé .L’humour permet aux humains de prendre du recul sur ce qu’ils vivent, comme le remarque Joseph Klatzmann dans son ouvrage L’Humour juifen souhaitant « rire pour ne pas pleurer ». Beaumarchais écrivit « Je me presse de rire de tout de peur d’être obligé d’en pleurer » Plus pessimiste, Nietzsche affirme « L’homme souffre si profondément qu’il a dû inventer le rire », se rapprochant du cynisme. Comprendre le statut de l’humour dans ces différentes réalités du rire rend nécessaire de définir au préalable leurs divers champs sémantiques et de revenir à leur sens restreint et plus précis Voir et comprendre les différentes formes du rire implique de rappeler brièvement les fondements du rire . Le rire est social. C’est un mode de communication permettant l’affirmation de soi et ayant une fonction de sociabilité. Il est aussi bien agressivité que refuge, facteur d’union que d’exclusion. Comme l’exprime Éric Smadja , « le rire peut témoigner de tendances multiples (bienveillance, autosuffisance, hostilité, dérision) ». Il est aussi un phénomène culturel qui fonctionne différemment selon les sociétés. En effet, le rire est prescrit, autorisé ou prohibé selon les sujets (en fonction de l’âge, du sexe, du statut social), le cadre socioculturel, l’objet du message, les émetteurs. De ce fait, Il est polymorphe, polyfonctionnel et polysémique. Socrate, Platon, Aristote, Descartes, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Bergson, Freud, des auteurs contemporains, tous ont perçu l’importance du phénomène du rire et ont essayé d’en comprendre le sens et les mécanismes. Ils défendent le caractère exclusivement humain du rire, affirment qu’il est le propre de l’homme et une expression de la vie et estiment que maintes formes du rire célèbrent le lien social. Aussi, par exemple, Nietzsche exprime dans son ouvrage Par-delà le bien et le mal une violente aversion pour les philosophes qui « ont cherché à donner mauvaise réputation au rire » et affirme « j’irais jusqu’à risquer un classement des philosophes suivant le rang de leur rire ». Recourons à quelques exemples. Kant a mis à nu les principes du comique. Bergson affirmant : « ce n’est plus de la vie, c’est de l’automatisme installé dans la vie et imitant la vie. C’est du comique », a résumé l’effet comique dans la formule « du mécanique plaqué sur du vivant », rencontre de deux types hétérogènes. Il offre une analyse précise de ce qui fait rire, en définit plusieurs conditions, démonte les effets comiques et l’explication de leur propagation. Bref, il envisage la pragmatique des modes de production du rire comme activité vitale et nécessaire au sein de la machine sociale. Quant à Freud, dans son ouvrage Le mot d’esprit et sa relation avec l’inconscient , il explique la nécessité de cette duplicité pour engendrer le comique. S’intéressant prioritairement au mot d’esprit, rattachant la théorie du mot d’esprit à la psychanalyse, il montre que dans ce processus, le langage est une manière indirecte, détournée, de satisfaire des pulsions sexuelles ou agressives qui ne peuvent se satisfaire comme telles dans la société en raison des interdits qu’elle véhicule. Le rire est une façon de prendre un plaisir interdit, en passant par un détour, c’est pourquoi il est proprement humain. Jean Fourastié dépasse les thèses de Bergson et Freud qu’il juge partielles et partiales dans son ouvrage Le rire, suite, et montre que fondamentalement le rire survient quand l’esprit de « cohérence » entre en contradiction avec l’esprit de « pertinence », quand se produit une rupture de « déterminisme ». Récemment, dans son ouvrage Les sens du rire et de l’humour , Daniel Sibony, au-delà de son analyse des positions de Bergson et de Freud, pose également ses réflexions sur des dimensions plus vastes. Pour lui, le rire est un « entre-choc ou événement entre deux niveaux d’être, de pensée, d’expression » (p. 10). Il est « une secousse d’identité où l’on se perd et se retrouve » (p. 22). Qualifié de « rire signifiant, rire de présence ; rire entre les forces de pulsion et celles de raison » (p. 50), défini comme « une recharge du symbolique » (p. 88), le rire « mobilise ou fait vibrer une coupure intérieure qui nous travaille ; entre l’intime, et le social, le visible et le caché, la loi normale et la parole inspirée qui risque de la subvertir. » (p. 107). Cependant à côté de ces réflexions fondamentales, il faut noter une certaine évolution formatée du rire. Par exemple, le rire est de plus en plus renvoyé aux humoristes de la télévision. Celle-ci pèse désormais sur les formes et contenus du rire. Comme le dit Olivier Mongin, elle dégénère le rire et le jeu des comédiens, formate un type de comportement, alors qu’il s’agit pour le rire de « le lever au sens de l’éduquer et d’éviter qu’il ne sombre dans l’ordurier ». De plus, « La France se convertit aux écoles du rire » comme l’écrit le journal Le Monde et beaucoup d’institutions embauchent des animateurs de rire pour une thérapeutique majeure antistress réalisant un « jogging » du corps et de l’esprit. Nous avons le comique. Il se définit comme ce qui fait rire. Le comique englobe ce qui fait rire mais de manière involontaire et c’est cet aspect involontaire qui le différencie de l’humour. Par rapport au comique, l’humour a « moins pour objet de provoquer le rire que de suggérer une réflexion originale ou enjouée. L’humour fait sourire plus souvent qu’il ne fait rire ». La notion de « comique » touche aussi bien à l’esthétique qu’à la sociologie, l’histoire, la psychologie, la psychanalyse, l’anthropologie et la philosophie. Aujourd’hui vulgarisé, le comique se trouve dans les situations burlesques et les quiproquos de la vie quotidienne. Plusieurs formes de comique sont distinguées notamment au théâtre ; elles ont été observées et peuvent se combiner entre elles : le comique de gestes dont l’effet est produit par l’interprétation (par exemple : mimiques, grimaces, coups, vêtements, accessoires) ; le comique de situation (surprises, rebondissements, coïncidences, retournements) ; le comique de mots (jeux de mots, répétitions, grossièretés, prononciation) uploads/s3/ torche-cul.pdf
Documents similaires







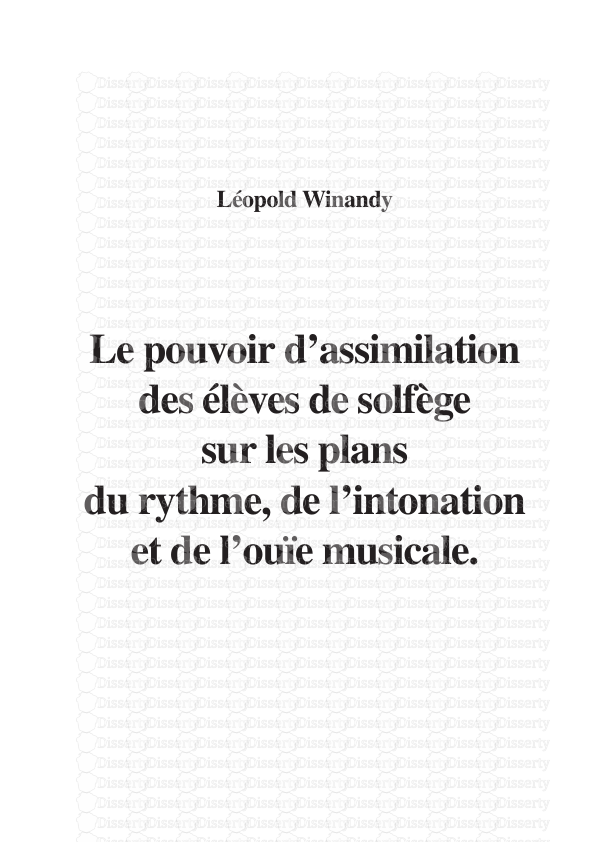


-
53
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 26, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1096MB


