See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://ww
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/257763032 Esthétique de la Technique Article in Revue de Synthèse · December 2012 DOI: 10.1007/s11873-012-0198-z CITATIONS 0 READS 141 2 authors: Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Colloque "La préhistoire au présent. Médiations, écritures, images" 15-17 mai 2019, Paris View project DEX_TER : Lascaux au cœur d’un réseau culturel inédit à la fin du Pléniglaciaire ? (LabEx LaScArBx) View project Sophie A. de Beaune Université Jean Moulin Lyon 3 136 PUBLICATIONS 476 CITATIONS SEE PROFILE Liliane Hilaire-Pérez Paris Diderot University 58 PUBLICATIONS 165 CITATIONS SEE PROFILE All content following this page was uploaded by Sophie A. de Beaune on 04 August 2015. The user has requested enhancement of the downloaded file. Revue de synthèse : tome 133, 6e série, n° 4, 2012, p. 471-476. DOI 10.1007/s11873-012-0198-z PRÉSENTATION Esthétique de la technique Sophie A. de Beaune et Liliane Hilaire-Pérez A ristote se posait déjà la question des rapports entre le beau, l’utile et le nécessaire : la beauté a-t-elle à voir avec la technique ? La technique est-elle forcément laide ? La beauté est-elle nécessairement inutile ? Il reprenait là le dialogue engagé à ce sujet dans le Grand Hippias de Platon. Socrate y pose tour à tour la plupart des questions qui agitent les théoriciens de l’art jusqu’à aujourd’hui : peut-on dire que « ce qui sied est plus beau que ce qui ne sied pas » ? Est-ce que « ce qui pour nous est beau [serait] ce qui éventuellement est utilisable » ? Cette question, une tradition philosophique qui court depuis l’Antiquité, et qu’on voit s’exprimer encore chez Kant, Hegel ou Heidegger, l’a tranchée en dissociant nette- ment esthétique et technique. Une dissociation qui ne va cependant pas toujours de soi. Pendant des siècles, la richesse sémantique du terme « art » et le rôle unificateur qu’il a joué dans l’espace académique et savant à l’époque moderne a porté des innova- tions, telles les sociétés des arts, animée d’un idéal de conception unitaire des objets et d’un rêve d’harmonie entre les sciences et les arts, unis au nom d’une compréhension synthétique de l’invention – et finalement de tout acte opératoire – comme relevant d’un art des liaisons selon Diderot 1. Insistons sur cet art des rapports. Au milieu du siècle, William Hogarth conçoit le plaisir esthétique comme goût des correspondances (“exactness of counterparts”). Dans les années 1790, Joshua Reynolds, chantre de la beauté néo-classique, définit l’originalité comme la combinaison de modèles connus 2. Entre-temps, comme on le reprécisera, Adam Smith, dans l’Essai sur la nature de l’imi- tation dans les arts, voit dans « l’écart entre l’objet qui imite et l’objet imité le fonde- ment de la beauté de l’imitation » et de l’art, érigeant la « maîtrise de la disparité » en 1. Hilaire-Pérez, 2002. 2. Reynolds, 1797. * Sophie Archambault de Beaune est professeur à l’université Lyon 3 et chercheur à l’UMR 7041 « Archéologies et sciences de l’Antiquité ». Ses recherches portent sur les comportements techniques et les aptitudes cognitives de l’homme préhistorique. Elle a notamment publié L’Homme et l’outil (Paris, CNRS Éditions, 2008). Adresse : UMR 7041 ArScAn, 21, allée de l’université, F-92023 Nanterre cedex (sophie.de-beaune@mae.cnrs.fr). Liliane Hilaire-Pérez est professeur à l’université Paris 7 (laboratoire « Identités, cultures, territoires », EA 337) et directrice d’études à l’EHESS (Centre Alexandre-Koyré). Ses travaux concernent l’histoire de l’invention et des cultures opératoires en Europe à l’époque moderne. Elle a notamment publié L’Invention technique au siècle des Lumières (Paris, Albin Michel, 2000). Adresse : Université Paris 7, ICT, 5, rue Thomas Mann, F-75013 Paris (liliane.perez@wanadoo.fr). 472 Revue de synthèse : TOME 133, 6 e SÉRIE, N° 4, 2012 canon artistique 3. Cette conception structuraliste de la beauté fait écho au principe de réduction, comme le soulignait Didier Deleule : « L’artifice du créateur, comme celui du technicien, du savant, du philosophe, effectue le système comme œuvre de l’art : une réduction de la diversité à certains principes d’intelligibilité qui ont pour mission de respecter l’hétérogénéité tout en surmontant […] la difficulté inhérente à la disparité des objets considérés 4. » Ainsi, « tout système a valeur esthétique 5 ». Cette utopie ne résiste pas à la dissociation entre les arts et les beaux-arts à partir du xviiie siècle. La conception du dessin – longtemps associé au dessein, à l’art du projet, à l’ingenium – en est transformée. Comme l’a montré Frédéric Morvan 6, alors que l’enseignement du dessin progresse dans des écoles où se forme un milieu artisanal et technicien rôdé à la copie, à la transposition, au dimensionnement – clés de voûte d’une recomposition technologique des métiers, en termes de compétences transverses et sectorielles –, en même temps s’affirme le prestige des Beaux-Arts et d’une création artistique dégagée des conditions techniques et matérielles de production des œuvres d’art dans les ateliers 7. Les historiens et les sociologues de l’art ont souligné les enjeux sociaux culturels et politiques que recouvrent cette émancipation de l’artiste, alors que les interférences avec le monde des métiers, avec le milieu des experts et des marchands étaient encore très fortes au siècle des Lumières et jusque sous la Révolution. Un témoin de ces tensions est l’architecture. Dans De architectura, Vitruve plaçait cet art – au sens d’artifice – à l’articulation entre commodité, solidité et beauté. Mais du fait de son utilité, l’architecture a été considérée bien souvent comme un art mineur. Estelle Thibault nous fait ainsi découvrir les réflexions qui se tissent à la fin du xixe siècle entre architectes et philosophes sur la place que l’architecture doit prendre parmi les arts : alors qu’en 1860 les membres de l’Institut, pour qui le Beau était un idéal détaché des nécessités matérielles, rejetaient hautainement l’architecture du côté de l’industriel, elle commence au début du xxe siècle à revendiquer sans honte un statut d’art appliqué visant à une « beauté rationnelle ». C’est qu’entretemps les relations entre le beau et l’utile se sont quasiment inversées. Les travaux récents sur les expositions universelles 3. Le texte d’Adam Smith, On the Nature of that Imitation which takes Place in what are called the Imitative Arts, commencé en 1777 et paru dans l’édition posthume de son œuvre établie par Dugald Stewart (1795), a été republié dans Thierry, dir., 1997 (ici p. 50 et 53). Le thème participe de l’esthétique de la machine et de l’œuvre d’art comme assemblage et système : voir Becq, 1983 ; Démoris, 1983 ; Damisch, 1983 ; Scott, 1999. 4. Deleule, 1997, p. 31. Le verbe « surmonter » fait écho à la citation de l’abbé Jean-Baptiste Dubos en 1733, s’insurgeant contre la formalisation excessive des règles de l’art en poésie : « rien n’aide un poete françois à surmonter les difficultez, que son genie, son oreille et sa perseverance. Aucune methode reduite en art ne vient à son secours », dans Dubourg Glatigny et Vérin, 2008, p. 74. 5. On rapprochera cette formule de celle d’Hélène Vérin commentant le sens que revêt l’œuvre d’art pour Herbert Simon, et l’ancienneté de cette vision, qui place l’économie au cœur de l’esthétique : « En quelque sorte l’œuvre d’art est réussie dans la mesure où, entre les résultats et le processus qui y a conduit, on découvre une relation réussie » (Vérin, 1998, p. 127). 6. Morvan, 2011. 7. Voir également Millet, 2011 et les travaux à paraître dans Lembré (Stéphane) et Millet (Audrey), L’Enseignement du dessin entre art et industrie (xviiie-xixe siècles). Renouvellements historiographiques et pistes de recherche. On peut aussi faire référence à la journée d’étude organisée par Lembré et Millet, Entre art et industrie : les enjeux de la formation technique (xviiie-xixe siècles), 11 juin 2012, IDHE, UMR-8533, Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis. 473 PRÉSENTATION mettent en valeur les revendications esthétiques – et non pas techniques – des fabri- cants dans bien des domaines, au nom de la qualité des produits 8. Eugénie Briot, dans son analyse des mises en scène de la parfumerie aux expositions de 1889 et de 1900, révèle que « la dimension technique des produits de parfumerie est presque entièrement absente 9 ». De même pour les papiers peints, Bernard Jacqué explique que « les papiers peints imprimés mécaniquement […] ne retiennent l’intérêt ni des manufacturiers, ni des jurys, encore moins des publics, sinon pour les dénigrer, brièvement, jusqu’aux années 1870 », non sans nationalisme. La création d’une catégorie des beaux-arts, en 1855, a été l’occasion de rivaliser par l’exposition de « tableaux » (réalisés à la planche), dessinés par des artistes. Les exemples foisonnent. Citons encore les tensions autour de la classification des vitraux 10 (certains peintres-verriers réclamant le statut de beaux-arts pour leurs œuvres) ou encore les conflits autour de la photographie après 1878, à l’heure de l’instantané au gélatino-bromure d’argent : « L’instantané […] est accusé de tous les maux, mais d’abord comme une pratique inesthétique, la nouveauté technique et le progrès n’étant pas synonymes de beauté 11. » Plus généralement, dès 1855, l’utopie technologique encyclopédique, héritière de l’union des uploads/s3/ beaune-2012rsesthetiquedelatechnique.pdf
Documents similaires

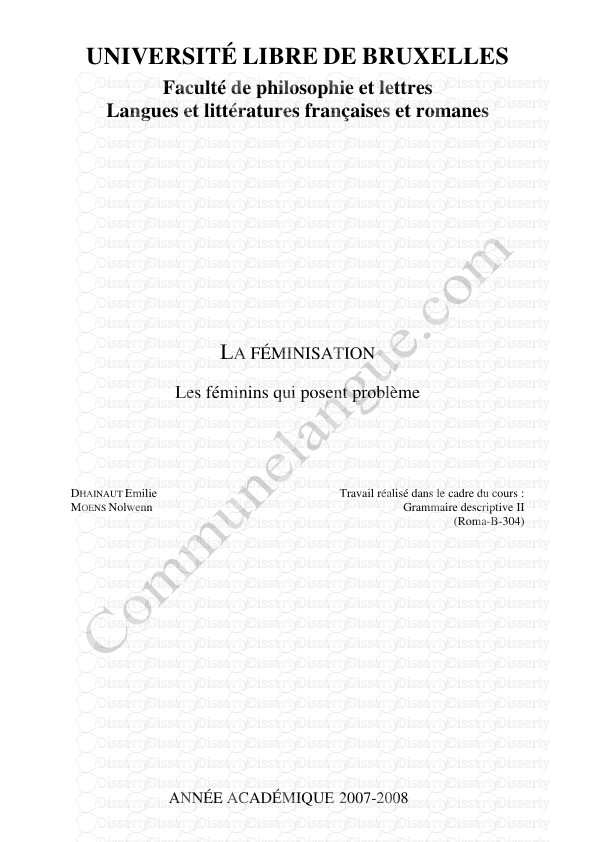








-
97
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 20, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.0165MB


