02/06/13 22:34 Imprimer : Henri Maldiney et Gilles Deleuze. La station rythmiqu
02/06/13 22:34 Imprimer : Henri Maldiney et Gilles Deleuze. La station rythmique de l'œuvre d'art Page 1 sur 8 http://rhuthmos.eu/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=896 Rhuthmos http://rhuthmos.eu/spip.php?article896 Henri Maldiney et Gilles Deleuze. La station rythmique de l’œuvre d’art vendredi, 17 mai 2013 / Jean-Christophe Goddard Ce texte a déjà paru sur Deleuze International en février 2009. Nous remercions Jean-Christophe Goddard de nous avoir autorisé à le reproduire ici. En introduction à L’art, l’éclair de l’être, paru en 1993, Maldiney consacre un texte à un article d’Oskar Becker initialement publié en 1929 et traduit et annoté en 1986 par Jacques Colette dans le n° 9 de la revue Philosophie. Le titre de l’article de Becker est « La fragilité du beau et la nature aventurière de l’artiste. Une recherche ontologique dans le champ des phénomènes esthétiques ». La traduction française est précédée d’un article de Colette intitulé « une phénoménologie à double foyer », d’où Maldiney tire une citation extraite d’un article de Lukacs paru en 1917 sous le titre « Die subjekt-objekt Beziehung in der Aesthetik ». La citation de Lukacs, que Maldiney met en résonance avec l’affirmation de Becker selon laquelle « la temporalité donne la clé à la question de l’existence esthétique », est la suivante : « l’esthétique a une structure véritablement héraclitéenne, en lui personne ne descend deux fois dans le même fleuve » (49a) [1]. « Il est d’un seul instant », de son instant, qui s’excepte de tout autre, précise Maldiney. Cette dimension monadique de tout acte ou figure de la sphère esthétique, qui la soustrait à tout rapport avec une autre monade de même espèce, Maldiney l’assume pleinement, mais en un autre sens que Lukacs, qui oblige à comprendre autrement ce qu’il faut entendre par « structure héraclitéenne » de l’œuvre d’art. Le désaccord avec Lukacs porte sur la nature de l’invariant qui, pour Lukacs, demeure toutefois, et qui, pour Maldiney, précise le sens de l’héraclitéisme de l’œuvre d’art au-delà du simple « tout s’écoule ». L’invariant ou l’identité, ce qui se conserve dans l’œuvre d’art n’est pas plus pour Lukacs que pour Maldiney l’identité d’un substrat, mais l’identité d’une forme. Or, si Lukacs comprend cette dimension formelle de l’œuvre d’art à travers la catégorie husserlienne d’un schème de remplissement en attente de son contenu, offert à tous et qui laisse l’œuvre ouverte à chacun ; pour Maldiney, ramener la dimension formelle de l’œuvre à un tel schème, revient à « passer outre » au phainestai, et trahir qu’on ne comprend pas ce que l’on dit quand on dit de l’œuvre d’art qu’elle est d’un seul instant, de son instant. La dimension formelle de l’œuvre d’art, son identité, son invariant, ne consiste pas dans un schème intentionnel en attente d’incarnation : elle est n’est pas Gestalt mais Gestaltung, et cette Gestaltung est identique à l’œuvre elle-même qui n’existe pas dans le temps, dans l’écoulement du temps, ne s’explique pas en lui, mais l’implique, comme un temps monadique et discontinu qui est sa propre transformation et qui se conquiert à travers les crises en lesquelles l’œuvre est constamment mise en demeure d’exister à partir de rien. Bref, l’invariance, l’identité, la forme ne vient pas contredire et nuancer la structure héraclitéenne de l’œuvre d’art : elle se confond avec cette forme et oblige bien à en repenser la signification. Sous l’expression de « temporalité héraclitéenne » on n’entendra pas une suite transitive d’instants, et par « structure héraclitéenne », le fait d’occuper un point temporel dans l’écoulement du temps, mais plutôt la manière même dont l’œuvre est son propre instant en se portant à l’avant de soi, en soi – la manière dont sa tension de durée constitue son instant. En ce sens, est héraclitéen la forme capable de la dimension suivant laquelle elle se forme et se porte à elle-même en apportant et en emportant son espace et son temps propre. 02/06/13 22:34 Imprimer : Henri Maldiney et Gilles Deleuze. La station rythmique de l'œuvre d'art Page 2 sur 8 http://rhuthmos.eu/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=896 C’est sur ce préalable que s’ouvre le septième et dernier chapitre de Qu’est-ce que la philosophie ? de Deleuze et Guattari : « l’art conserve et c’est la seule chose au monde qui se conserve. Il conserve et se conserve en soi » [2]. Les premières pages du chapitre consacré à l’art sous le titre « Percept, affect et concept » sont saturés d’une même affirmation : l’œuvre d’art est un « bloc » de sensations, un composé de percepts et d’affects qui « valent par eux-mêmes et excèdent tout vécu », et ce composé, qui « existe en soi », doit avant tout, pour que l’on puisse proprement parler d’œuvre d’art, « tenir tout seul », « tenir debout tout seul », « avoir la force d’être d’aplomb », être – à la différence des blocs friables incapables d’autoconservation que sont les composés sous drogues – « solides et durables » comme Cézanne l’exige de ses œuvres et comme ne le sont pas suffisamment à son goût les œuvres impressionnistes. Bref l’œuvre d’art pour être ce qu’elle doit être doit être un « monument » (Ibid., p. 155). Insistons – puisqu’il faut rapprocher l’exigence deleuzienne du monumental, qui est aussi cézanienne, de l’exigence maldineysienne pour l’œuvre d’art de se former et de se porter en elle- même – : ce monumental et ce gigantesque de l’œuvre, sa solidité, sa stature et sa station d’un bloc, renvoient très exactement à sa structure héraclitéenne. Ce qu’il faut donc expliquer, c’est précisément en quoi une telle station debout en bloc est proprement héraclitéenne. Se tenir seul debout et se conserver en soi-même d’un bloc, c’est renier et dépasser l’organisation, la composition en bloc friables c’est-à-dire en objets partiels pour affirmer l’identité massive d’un objet total. Cette station est celle du corps sans organes tel que le découvre Artaud et tel que le conçoivent Deleuze et Guattari dans L’Anti-Œdipe. Elle est aussi la station même de la substance spinoziste [3]. Mais si Derrida comprend d’abord la station artaldienne du corps sans organes à travers la dialectique de la perte et de la réserve chez Bataille (c’est-à-dire dans l’hégélianisme), Deleuze aborde le corps sans organes à travers les catégories de l’esthétique de Maldiney, dont il fut le collègue et l’ami à Lyon avant 1968. L’œuvre d’art est monument, mais le monument, écrivent Deleuze et Guattari, « peut tenir en quelques traits ou quelques lignes » [4]. Ce qui est presque une citation de « L’art et le pouvoir du fond », qui dans Regard, Parole, Espace, prolonge les analyses déterminantes d’une conférence prononcée par Maldiney à Lyon en 1967 intitulée « L’esthétique des rythmes ». Le « Mal » (du latin macula = tache, qui donne en allemand le verbe malen = peindre) est pour Maldiney « la forme originelle et originaire du monumental » [5] – le monument étant Denkmal –, et cela, précise t-il, qu’il soit « bloc, tache, trait ou point » (Ibid., p. 181). « Le surgissement du Mal est celui d’un absolu ; il est libre de toute autre condition d’existence et de signifiance que l’abrupt de son apparaître » (Ibid., p. 178), écrit Maldiney. Il réalise en soi cette présence unique et une de l’œuvre, sans partition, son immobilité et sa durée monadique ; en un mot : il est la forme même de l’œuvre en tant qu’elle est auto-position, auto-genèse et autoconservation. Or, cette dimension formelle de l’œuvre d’art, son existence en soi, en bloc, Maldiney la comprend précisément comme sa dimension rythmique. Car, le rhuthmos, comme l’atteste Benveniste dans les Problèmes de linguistique générale sur lesquels Maldiney prend appui, « ne désigne pas un phénomène d’écoulement, de flux, mais la configuration assumée à chaque instant déterminé par un mouvement » (Ibid., p. 157). Rhuthmos veut dire forme. Au sens précis de cette forme en formation, en transformation perpétuelle dans le retour du même que Maldiney oppose à la forme comme schème. Alors que le schème définit, en effet, une forme fixe posée comme un objet, le rythme désigne au contraire la forme dans l’instant qu’elle est assumée par ce qui est mouvant, fluide. Plus précisément : à cette configuration instantanée, la forme rythmique ajoute la continuité interne d’une durée, de telle sorte qu’en elle l’opposition de l’instant et du temps se supprime. Ce que Maldiney exprime en citant le fragment 50 d’Héraclite : « Tout est en Un et Un toutes choses ». Car la structure héraclitéenne de l’œuvre d’art n’est pas à chercher uniquement dans le « tout s’écoule », mais dans « l’alliance surprise du “temps enfant qui joue” et du « gouvernement de tout à travers tout » du fragment 41. Le destin du rythme – et donc la forme de l’œuvre ou l’œuvre comme forme, comme Mal – se jouant entre les deux extrêmes de la limite et de l’illimité. Ainsi Deleuze dans la Logique de la sensation use t-il à propos de la Figure de la peinture de 02/06/13 22:34 Imprimer : Henri Maldiney et Gilles Deleuze. La station uploads/s3/ henri-maldiney-et-gilles-deleuze-la-station-rythmique-de-loeuvre-dart 1 .pdf
Documents similaires
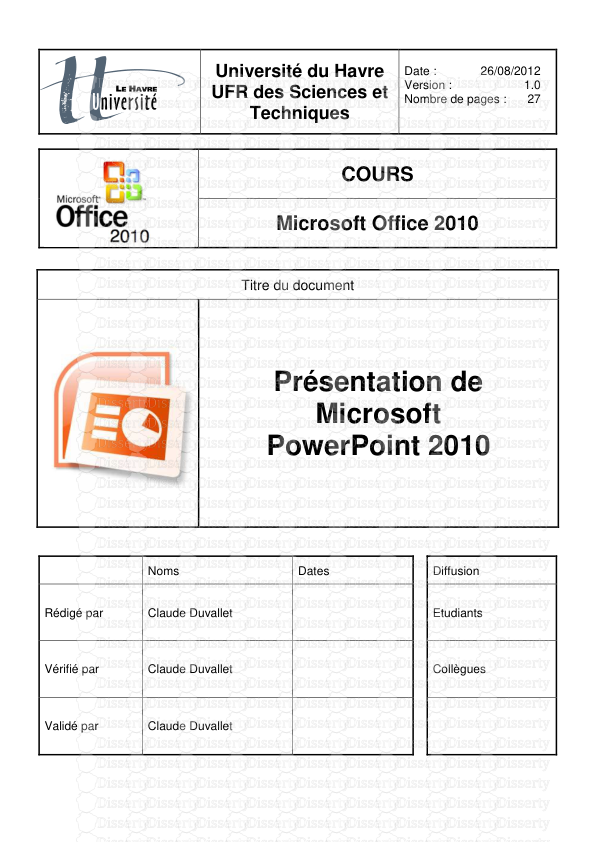









-
62
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 08, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0841MB


