173 Joëlle Aden Université de Cergy-Pontoise - Laboratoire ALDIDAC/CICC (EA2529
173 Joëlle Aden Université de Cergy-Pontoise - Laboratoire ALDIDAC/CICC (EA2529) IUFM de Créteil/Université Paris Est j.aden@numericable.com Keywords : Artistic creativity, cognitive neurosciences Comment définir la créativité ? Une capacité, une attitude, un positionnement ? L’étymologie latine du verbe créer nous met sur la piste d’une action par laquelle on pourrait donner naissance à quelque chose à partir de rien : tirer du néant… C’est une conception de la création du monde et du vivant que les sciences ont mise à mal. Aucun humain ne produit quelque chose à partir de rien, nous sommes des êtres culturels en interaction avec notre environnement et nous nous inscrivons dans la mémoire de notre phylogenèse. Si pendant des siècles, l’idée de création a été associée à un concept religieux, elle a aussi été attribuée aux artistes « traversés » par des génies créateurs. Ce n’est que plus récemment que la psychologie cognitive a, en quelque sorte, démocratisé la notion de créativité en observant sa trace chez tous les humains. Etre créatif c’est avoir la capacité d’imaginer et de donner forme à des idées, des choses, c’est trouver des solutions inédites, originales, efficaces à des problèmes. Mais le Vivant, en s’adaptant à son environnement est créatif. La créativité proprement humaine est artistique car elle vise le dépassement de soi. C’est une énergie d’action qui combine intuition et réflexion sur soi, qui met en synergie nos trois cerveaux : le reptilien, le limbique et le néocortex. Synergies Europe n° 4 - 2009 pp. 173-180 La créativité artistique à l’école : refonder l’acte d’apprendre Résumé: Cet article met en avant les liens qui unissent créativité langagière et artistique et plaide pour introduire la notion de créatvité à l’école. Les neurosciences cognitives lèvent le voile sur le mystère qui entourait cette capacité et ouvrent la voie à une pédagogie qui repose sur l’exprience et l’autonomie des élèves. Introduire la créativité artistique à l’école c’est nécessairement changer la façon d’enseigner les autres disciplines. Mots-clés: créativité artistique, neurosciences cogntitives Abstract: This paper highlights the links between language and artistic creativity and advocates the introduction of creativity in education. The cognitive neurosciences unveil the mystery that surrounded this capacity and pave the way for a pedagogy that relies on the students experience and autonomy. Introducing artistic creativity in education means changing the way all subjets are taught. 174 La créativité est une capacité qui est peu, voire pas du tout, prise en compte dans les référentiels disciplinaires de compétences des élèves et des enseignants. Les programmes de langues vivantes s’intéressent quasi exclusivement au néocortex : aux connaissances et aux savoir-faire dont la finalité principale est de commenter, comparer, reproduire, produire, communiquer selon des schémas de pensée canoniques et culturellement marqués. Dans le socle commun des connaissances et des compétences (décret 830 du 11 juillet 2006) qui ouvre une perspective éducative élargie, le mot créativité n’apparaît que 2 fois, dont une sous le chapitre 7 « autonomie et initiative » comme une « attitude » à développer. Une attitude créative invite à ne pas reprendre systématiquement les mêmes chemins ou reproduire les réponses déjà données, à se mettre en questionnement et en recherche pour répondre à un défi, trouver des réponses personnelles, originales et adaptées à un problème en combinant les matériaux que nous avons à notre disposition : nos savoirs, nos expériences et notre imaginaire. Bien sûr, il n’est pas question de demander aux élèves de réinventer le silex, la fission de l’atome ou la métrique des alexandrins mais bien, à partir de ces avancées humaines que l’école a pour mission de transmettre, de poser des questions susceptibles d’éclairer le 21e siècle. Une école créatrice serait une école dans laquelle les enfants se prépareraient à inventer des réponses aux défis planétaires car si l’une des missions principales de l’école est bien de transmettre le patrimoine gigantesque de l’humanité, elle peut et devrait le faire en développant chez les élèves le désir de chercher et d’innover, elle devrait prévoir des espaces pour exercer et développer une attitude créative. Ceci est devenu un impératif humaniste car personne ne peut prédire avec certitude les problèmes que devront résoudre en 2050 les enfants qui entrent en primaire aujourd’hui. La créativité s’exprime dans la langue Parler est en soi un acte créatif puisque nous varions à l’infini notre discours au moyen d’un nombre fini de mots et de structures dans des situations jamais identiques. Pour donner forme à nos intentions et nos idées, nous combinons des stratégies verbales, non verbales, nous imaginons des métaphores, des images, des analogies, nous utilisons l’humour et surtout des histoires. Nous avons tous, un jour ou l’autre, fait cette expérience paralysante et frustrante de ne pas pouvoir inventer, improviser, jouer avec nos idées dans une langue que nous ne parlons pas assez bien. Maîtriser de mieux en mieux une langue c’est devenir de plus en plus créatif dans cette langue, l’un n’étant pas la conséquence de l’autre, mais les deux se renforçant dans une boucle rétroactive. Il existe des conditions indispensables pour que cette boucle produise de l’apprentissage, j’en citerai deux ici : - il est nécessaire que l’objet du discours ait un enjeu authentique. Cet enjeu est l’ancrage des élèves dans leur monde présent, les langues qu’ils apprennent doivent leur parler d’eux et leur permettre de parler d’eux et de leur environnement par la médiation de l’imaginaire. Or, dans les classes de langue, les enjeux de parole sont trop souvent absents. Les enseignants sont à la recherche du sens dans les tâches scolaires que le CECRL1 propose de mettre en œuvre au moyen d’une pédagogie de Synergies Europe n° 4 - 2009 pp. 173-180 Joëlle Aden 175 projet. Le piège consiste à faire du projet lui-même l’enjeu de l’apprentissage par l’action alors qu’il n’est que le contenant formel. Ce qui fait sens pour les élèves c’est de pouvoir ancrer leurs propres questions dans leurs expériences, leurs désirs, leur imaginaire et de les projeter dans l’action. C’est précisément ce que permet de faire un projet artistique. - La seconde condition, c’est que le projet corresponde aux questions des apprenants, or pour Hélène Trocmé-Fabre2, dans les dispositifs pédagogiques, « L’apprenant est davantage questionné qu’il ne questionne lui-même et ses réponses sont évaluées par rapport à une norme, «la» norme. Pourtant, les recherches en sciences cognitives nous précisent qu’apprendre ne consiste pas, comme on l’a cru trop longtemps, à «acquérir» des connaissances, mais à réorganiser ce que l’on sait déjà en y intégrant des éléments nouveaux ». Créativité et communication Depuis plusieurs décennies les programmes de langues mettent l’accent sur la capacité des apprenants à communiquer. C’est ainsi que le CECRL a institué « l’interaction » en domaine de compétence langagière à part entière. Interagir, c’est beaucoup plus que « parler avec », c’est s’adapter à quelqu’un d’autre dans une situation toujours nouvelle, cela constitue ce que Bruner (2002) appelle un « scenario ». L’interaction se construit sur de l’imprévisible auquel il faut pouvoir réagir avec toute sa personne, et tout d’abord avec ses affects. Cela amène à prendre en compte des attitudes particulières, notamment la confiance en soi, la prise de risque et l’indépendance de jugement. Il est très intéressant de noter que de nombreuses recherches en psychologie cognitive, et ceci depuis les années 50, ont montré que la créativité était liée à ces même traits de personnalité indispensables à une bonne maîtrise de la communication orale. Nous pouvons dire que les tâches qui favorisent la prise de risque et la confiance en soi développent parallèlement l’apprentissage d’une langue. Les tenants d’une certaine doxa, aiment à penser qu’il faut d’abord « acquérir les bases de la langue » et qu’on devient créatif plus tard. Ceci n’a pas de sens, les intentions, les émotions que nous formulons avec des mots, émergent par l’interaction et la langue en est le résultat. Francisco Varela3 rappelle que « le langage est fondamentalement une manière de coupler des individus à l’intérieur d’une espèce pour la coordination de l’action ». La dimension de l’émotion est très importante dans l’interaction alors qu’elle n’est pas non plus prise en charge dans la classe de langue. Pour Boris Cyrulink, « avant de parler, il faut aimer. Pour apprendre une langue, il ne faut pas seulement assimiler les sons, les mots, les règles, il faut acquérir la manière d’y traduire des sentiments. » (2000, p.44), ce qui nous ramène, en boucle, à la question de l’authenticité de la parole mentionnée plus haut. Et la créativité artistique ? La créativité artistique a un statut particulier qui tient surtout à sa finalité. En effet, en règle générale un artiste, lorsqu’il créé, ne suit pas de but précis autre que le dépassement de soi ou le désir souvent irrépressible de faire et d’expérimenter. Il se sent souvent « inspiré » ou « traversé » par l’expression La créativité artistique à l’école : refonder l’acte d’apprendre 176 qui émerge dans ses productions mais il fait aussi l’expérience de l’angoisse du vide, celle du silence intérieur. Au premier abord, la création artistique n’a pas grand chose à uploads/s3/ article-creativite-pdf.pdf
Documents similaires









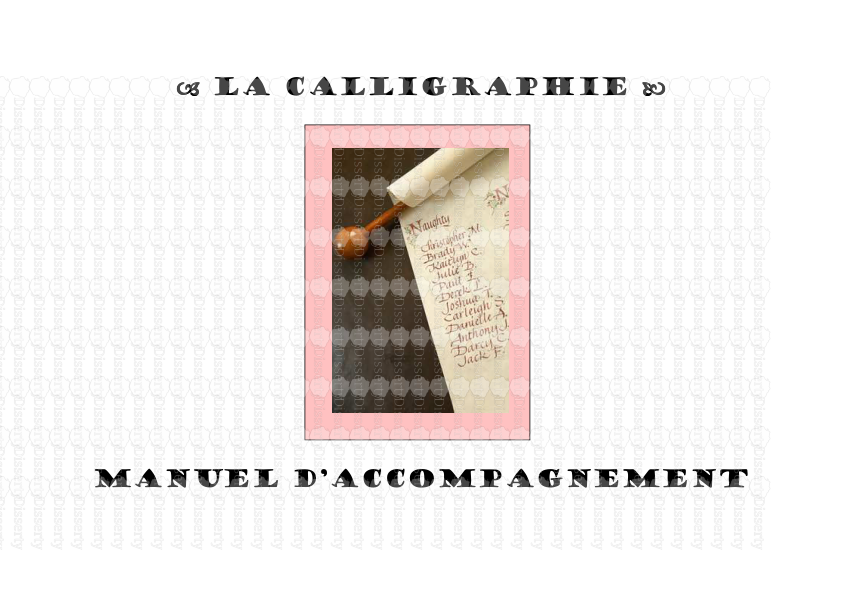
-
237
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 20, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1483MB


