L'Essai et le cinéma, dir. S. Liandrat-Guigues et M. Gagnebin, Seyssel, 2004, C
L'Essai et le cinéma, dir. S. Liandrat-Guigues et M. Gagnebin, Seyssel, 2004, Champ Vallon, coll. L'Or d'Atalante, pp. 171-181 1 Les Arabesques sur le thème de Pirosmani de Paradjanov : Autoportrait d'un cinéaste en peintre ? Sylvie Rollet Depuis Montaigne, l'essai est, semble-t-il, indissociablement lié à la construction du sujet. Pour décrire la puissance encore inédite de ce qu'il nomme "caméra-stylo", Alexandre Astruc n'évoque pas par hasard Descartes et le projet d'un Discours de la méthode que "seul aujourd'hui le cinéma pourrait convenablement exprimer".1 Toutefois, si le cogito contemporain peut, dit-il, "s'écrire directement sur la pellicule"2, encore faut-il se demander de quelle "pensée" il s'agit et de quel "je". Cette double question, le film consacré par Paradjanov à la peinture de Pirosmani me semble la poser avec une vigueur particulière. Essai et autoportrait L'essai sur le peintre autodidacte de la Tiflis du début du siècle se transforme, en effet, en autoportrait du cinéaste, tandis que la façon dont pense la peinture et dont pense le spectateur d'un tableau, d'être dépliée dans le temps de la projection et d'être explicitée dans son travail de liaison, devient proprement un "théorème cinématographique".3 En d'autres termes, ce "documentaire"4 – pour reprendre le terme usuel – n'est pas un documentaire sur un peintre. "Son langage n'est ni celui de la fiction, ni celui des reportages" mais devient, comme le souhaitait Astruc, le "lieu de passage de l'abstrait".5 Le lieu de passage, c'est-à-dire le territoire, le corps même de l'abstraction ; non discours sur, mais forme sensible d'une pensée. Paradjanov renonce, en effet, à la forme la plus courante du documentaire sur un peintre – celle du Van Gogh de Resnais, du Georges de la Tour de Cavalier ou du Mystère Picasso de Clouzot, par exemple – où la parole, off ou in, tente de résorber la puissance incontrôlée des images, de la contenir dans les limites d'un discours. La raison de cette 1 Alexandre Astruc, « Naissance d'une nouvelle avant-garde : la caméra-stylo » in Du stylo à la caméra et de la caméra au stylo. Ecrits (1942-1984), L'Archipel, Paris, 1992, p. 325. 2 Ibid., p. 326. 3 "Tout film, parce que […] se déroulant dans le temps, est un théorème", dit Astruc (ibid., p. 326). 4 Lorsqu'il a pu échapper aux commandes des studios soviétiques, après 1964, et hors des périodes où il était 'interné dans un camp à régime sévère, le cinéaste arménien de Tiflis a pu réaliser deux "documentaires" consacrés à des peintres, Hagop Hovnatanian (1965) et Arabesques sur le thème de Pirosmani (1986) ainsi que quatre films de fiction, Les Chevaux de feu (1964), Sayat Nova (1968-1969), la Légende de la forteresse de Souram (1984), Achik Kérib (1988). 5 « L'avenir du cinéma », op. cit., p. 532. L'Essai et le cinéma, dir. S. Liandrat-Guigues et M. Gagnebin, Seyssel, 2004, Champ Vallon, coll. L'Or d'Atalante, pp. 171-181 2 prolifération du verbal est sans doute celle que suggère Pascal Bonitzer : "parce que la peinture est un discours qui se tait, elle appelle un commentaire en droit interminable".6 On comprend mieux alors ce qui se joue dans l'essai sans paroles de Paradjanov. Dans l'un des commentaires qu'il donne de ses films, le cinéaste affirme, en effet : "dans mes films, les gens ne se parlent pas. […] C'est vrai, mais dans la peinture aussi les gens se regardent mais ne se parlent pas. […] La peinture est muette, mes films aussi".7 Se faisant le corps d'une question adressée à la peinture de Pirosmani, les Arabesques de Paradjanov semblent donc pouvoir éclairer toute l'œuvre du cinéaste, à la manière d'un "art poétique". Les toiles du peintre y sont, en effet, moins reproduites qu'interrogées et cette question adressée à la peinture devient l'occasion d'une théorie en acte du cinéma. L'essai sur un peintre devient mise à l'essai, à l'épreuve, du langage cinématographique. "Je suis moi- même la matière de mon livre", disait Montaigne. Le pari que je voudrais faire est que le cinéma de Paradjanov est lui-même la matière de cet essai sur la peinture de Pirosmani. Le scénario intime de cette confrontation du cinéaste et du peintre apparaîtrait alors comme l'un des épisodes de ce "roman des origines" du cinéma, élaboré et repris de film en film par Paradjanov. Serge Daney disait, en effet, de Sayat Nova : "Paradjanov est de ceux qui font comme si personne, avant eux, n'avait filmé." 8 Le rôle spéculaire conféré ici à la peinture évoque, en effet, cette fiction des "commencements" que résume la question de Jean- Louis Déotte : "est-ce qu'un art peut commencer […] sans cette immédiate dimension de l'exposition, sans la différence à soi qu'ouvre la réflexion ?"9 Encore faut-il préciser que l'essai sur Pirosmani ne joue pas seulement le rôle d'un masque sous lequel se lirait un autoportrait déguisé. Les toiles du peintre géorgien occupent, au contraire, la fonction essentielle d'un interlocuteur indispensable à l'élaboration d'une réflexion du cinéma sur la peinture et sur lui-même. En d'autres termes, il n'est d'autoportrait que dialogique, la construction d'un "je" supposant toujours l'institution d'un "autre". Cette construction à deux faces est précisément celle qu'analyse Walter Benjamin dans La Tâche du traducteur10, modèle probable du texte d'Adorno, l'Art et les arts11. Selon 6 Pascal Bonitzer, Peinture et cinéma. Décadrages, Cahiers du cinéma – éd. de l'Etoile, Paris, 1995, p. 33. 7 Entretien avec Charles Tesson, Cahiers du cinéma, N° 410, cité par Patrick Cazals in Serguei Paradjanov, éd. Cahiers du cinéma, Paris, 1993, p. 95. 8 « Sayat Nova », article paru dans Libération, le 29 janvier 1982, repris dans Ciné journal 1981-1986, Cahiers du Cinéma, Paris, 1986, p. 72-75. 9 Jean-Louis Déotte, « Du bon enchaînement d'un art sur l'autre » in De la différence des arts (dir. J. Lauxerois et P. Szendy), L'Harmattan/IRCAM/Centre Georges Pompidou, Paris, 1997, p. 91. 10 Walter Benjamin , « La tâche du traducteur », 1923, in Œuvres , tome 1, Gallimard-Folio, Paris, 2000, p. 244- 262. 11 Theodor W. Adorno, L'art et les arts, Desclée de Brouwer, Paris, 2002. J'emprunte l'idée d'un rapprochement des textes de Benjamin et d'Adorno à Jean-Louis Déotte, op. cit. L'Essai et le cinéma, dir. S. Liandrat-Guigues et M. Gagnebin, Seyssel, 2004, Champ Vallon, coll. L'Or d'Atalante, pp. 171-181 3 Benjamin, la traduction vise, en effet, à importer à l'intérieur de la langue d'accueil l'étrangeté de la langue étrangère jusqu'à ce que la langue-hôte en devienne différente d'elle-même. C'est l'enjeu de cette "différence" que je voudrais m'attacher à cerner. En effet, d'entrée de jeu, le processus d'altération du cinéma par la peinture et de la peinture par le cinéma peut être compris comme un double mouvement de dénaturalisation du cinéma et de dénarrativisation de la peinture. Le dialogue du peintre et du cinéaste a donc tout d'un manifeste. Puissance du cinéma Dénarrativiser la peinture, c'est d'abord mettre au jour ces "détails" qui disloquent la scène comme "ensemble" et ramènent la représentation à ses matériaux, aux pigments et aux formes. Or cette "découverte" passe par la découpe du cadrage et par l'assemblage des plans. Plus exactement, c'est par le découpage et le montage opérés dans le film que devient visible le travail de montage effectué par la peinture. De ces opérations mentales, de ces enchaînements auxquels nous contraignent les toiles, le corps même du film "dessine la trace tangible"12, pour reprendre les termes d'Astruc. L'ouverture du film est particulièrement éloquente si on la confronte avec la toile qu'elle "découpe" et "remonte". Il s'agit de la plus grande toile de Pirosmani, du moins parmi les œuvres qui ont été retrouvées : pour l'essentiel, des toiles cirées peintes, ainsi que de quelques enseignes en fer blanc. On ne sait rien, en revanche, des fresques qui ont toutes disparu. Cette Epopée de Kakhétie, dont les proportions (87 cm de haut sur 530 cm de large) évoquent le format du cinémascope, se prêtait évidemment au panoramique ou au travelling latéral. Mais ces deux mouvements de caméra auraient narrativisé l'espace scénique sur le modèle de la peinture occidentale de l'après-Renaissance. Le temps requis par le parcours du regard aurait, en effet, introduit entre les différentes saynètes un ordre chronologique. Or, cette conversion de l'espace en temps, à laquelle s'est évertuée la peinture occidentale, est précisément de que refuse Paradjanov. Le cinéaste renchérit de la sorte sur le principe de composition à l'œuvre chez le peintre : l'étagement vertical des scènes sur le plan du tableau (l'espace semble "basculer" vers nous) et la juxtaposition de saynètes indépendantes, temporellement insituables, quasiment éternisées dans les anecdotes qu'elles figurent respectivement. 12 Alexandre Astruc, « Naissance d'une nouvelle avant-garde : la caméra-stylo », op. cit., p. 327. L'Essai et le cinéma, dir. S. Liandrat-Guigues et M. Gagnebin, Seyssel, 2004, Champ Vallon, coll. L'Or d'Atalante, pp. 171-181 4 A quoi assiste-t-on, en effet, dans cette ouverture ? Le premier fragment de peinture filmée (c'est-à-dire le deuxième plan, si l'on ne tient pas compte des cartons) procède, d'entrée de jeu à une dissolution totale du motif et même de la couleur, absorbés par la surface noire de la toile uploads/s3/ les-arabesques-sur-le-theme-de-pirosmani.pdf
Documents similaires








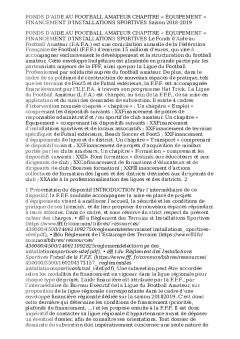

-
46
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 28, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0919MB


