CÉZANNE ET MIRBEAU Une lettre inédite de Cézanne à Mirbeau Lors de la vente aux
CÉZANNE ET MIRBEAU Une lettre inédite de Cézanne à Mirbeau Lors de la vente aux enchères qui a eu lieu dans l’Opernpalais de Berlin, les 21 et 22 mars 2006, par les soins de l’expert Stargardt, a été vendue, pour la modique somme de 1 600 euros, une lettre apparemment inédite de Paul Cézanne à Octave Mirbeau. Autant qu’on le sache, le peintre et le critique ne se sont, semble-t-il, rencontrés qu’une seule fois1. Ce fut à Giverny, le 28 novembre 1894, chez Claude Monet, en présence d’Auguste Rodin, de Georges Clemenceau et de Gustave Geffroy, alors que Cézanne séjournait à l’auberge du village. À l’invitation, non retrouvée, de Monet, qui a pris l’initiative de la rencontre, Mirbeau répond avec enthousiasme, mais non sans une certaine crainte, car il connaît de réputation le caractère sauvage du peintre provençal: « Nous irons mercredi, c’est entendu. [...] Mais, sapristi, que Cézanne n’oublie pas de venir, car j’ai un violent désir de le connaître2. » Geffroy nous a laissé le seul récit que nous ayons de cette journée, où le timide et innocent Aixois a souvent étonné ses admirateurs par la cocasserie de son comportement. Le comble a été atteint lorsque, « les larmes aux yeux », tellement il était bouleversé de l’honneur que lui avait fait, en lui serrant la main, un homme décoré mais « pas fier » comme l’illustre sculpteur, il s’est carrément agenouillé « devant Rodin, au milieu d’une allée », pour l’en remercier encore3... Sophie Monneret considère que, dans son « récit grotesque et faux », Geffroy a mal interprété ce qui, selon elle, révèle « le goût de la farce d’atelier toujours cher à Cézanne4 ». Quoi qu’il en soit, face à ce qui a dû lui apparaître comme une innocente ferveur, l’admiratif Mirbeau ne pouvait faire moins que de tenter, nonobstant son horreur pour les déshonorantes breloques, que d’aller solliciter, près de son ancien compagnon de bohème Henry Roujon, devenu un puissant administrateur des beaux-arts, la croix de la Légion dite “d’Honneur” pour « le plus peintre des peintres5 ». Théodore Duret raconte ainsi l’épisode, qu’il situe en 19026 : En l'année 1902, Cézanne qui avait supporté avec une grande philosophie le long mépris, se voyant enfin relativement apprécié, laissa entendre que, sans penser à faire lui-même aucune démarche, il accepterait volontiers la décoration qu'on pourrait lui décerner, comme reconnaissance officielle de son mérite. M. Octave Mirbeau se chargea, après cela, de faire appel en sa faveur à M. Roujon, le directeur des Beaux-Arts. Voilà donc Mirbeau qui, accueilli par Roujon, lui dit qu'il vient lui demander la Légion d'honneur pour un peintre de ses amis et Roujon, qui assure Mirbeau de sa bienveillance et du plaisir qu'il aurait à lui donner satisfaction. Mirbeau désigne alors Cézanne. À ce nom Roujon sentit son sang se glacer. Décorer Cézanne ! mais c'est lui demander de fouler aux pieds tous les principes remis à sa garde. Il répond donc par un refus péremptoire. D'ailleurs, il serait prêt à décorer tout autre Impressionniste , Claude Monet en particulier, mais qui précisément ne consentait pas à l'être. Mirbeau se retira dédaigneux et Cézanne dut comprendre, que le fait d'être apprécié par une 1 Précisons : une seule fois attestée. Car, comme Mirbeau raconte sur Cézanne des anecdotes et cite de lui des propos oraux qu’il est supposé avoir entendus, on est en droit d’imaginer qu’il a dû le rencontrer au moins une autre fois, à une date indéterminée. Á moins, bien sûr, qu’il n’ait tout inventé, ou qu’il se soit contenté de récits de seconde main : vu sa façon de “faire l’histoire”, qui est bien évidemment celle d’un polémiste et/ou d’un apologiste, et non celle d’un historien, on n’est certes pas obligé de prendre ses propos au pied de la lettre. 2 Lettre inédite de Mirbeau à Claude Monet, catalogue de la vente du 13 décembre 2006 à l’Hôtel Dassault. Cette lettre se substitue à la lettre-fantôme n° 1295, dans le tome II de la Correspondance générale. 3 Gustave Geffroy, Monet, sa vie, son œuvre, Macula, 1986, p. 326. 4 Sophie Monneret, L’Impressionnisme et son époque, Robert Laffont, collection Bouquins, 1987, t. I, p. 121. 5 Préface au catalogue de l’exposition Cézanne, Bernheim-Jeune, 1914 (Combats esthétiques, Séguier, 1993, t. II, p. 526). 6 D’après Ambroise Vollard, c’est en septembre 1902 que Mirbeau est allé voir Roujon, qui lui aurait déclaré : « “Monet, si vous voulez ! Monet n’en veut pas ? Prenons alors Sisley ! Quoi, il est mort ! Voulez-vous Pissarro ?” Se méprenant sur le silence de Mirbeau : “Il est mort aussi ? Alors choisissez vous-même n’importe qui, si vous prenez l’engagement de ne plus me parler de ce Cézanne !” » (En écoutant Cézanne, Degas, Renoir, Grasset, 1938, p. 81). minorité d'artistes et de connaisseurs n'empêchait pas qu'il ne fût toujours tenu pour un monstre, dans les sphères de l'art officiel et de la correction administrative.7 Ce que Sophie Monneret transcrit ainsi : « Choisissez vous-même n’importe qui, mais ne me parlez plus de Cézanne8. » Pour en revenir à cette unique rencontre de novembre 1894, Cézanne en conservera toujours un « souvenir fervent », selon le témoignage de son confident Joachim Gasquet9. Un mois plus tard, fin décembre 1894, il écrit à Mirbeau, un peu plus tôt qu’il ne l’envisageait, pour le remercier de l’élogieuse mention de son nom dans son article sur le legs Caillebotte10 : J’attendais le renouvellement de l’année pour me rappeler à votre excellent souvenir, mais devant cette récente marque de sympathie que vous me donnez dans Le Journal, je ne puis tarder plus longtemps à vous remercier. Je compte que j’aurai l’honneur de vous revoir et pouvoir manifester d’une façon moins éphémère que par de simples paroles la gratitude qui [...]11 et s’impose. Je vous prierai de vouloir bien faire agréer à Madame Mirbeau mes hommages respectueux et de me croire bien cordialement à vous. P. Cézanne12 Un mois plus tard, il reprend les mêmes termes de « sympathie » et d’« honneur » pour remercier Gustave Geffroy de sa dédicace de son recueil de nouvelles Le Cœur et l’esprit13. Doutant de lui-même et fort éloigné du petit monde parisien où se font et se défont les réputations, il se sent probablement fort “inférieur” aux deux influents journalistes, qui l’honorent de leur respectueuse attention14. En ce qui concerne Mirbeau, il se pourrait que le mot « honneur » soit également lié à l’admiration soudaine, et un peu surprenante de la part d’un bon bourgeois traditionaliste par ailleurs, que le peintre prétend avoir pour lui : selon Joachim Gasquet, il le considérait désormais comme « le meilleur écrivain de son temps15 ». Il ressort aussi d’un brouillon de lettre, conservé dans un carnet à dessins, qu’il oppose Mirbeau à Huysmans : « Écrivez pour les intelligences moyennes. Je ne crois pas que vous soyez un Huysmans16 ». Pour Christian Limousin, cette opposition signifie que Mirbeau n’est pas un critique aux opinions changeantes17. Mais la phrase précédente implique aussi que Cézanne a compris que Mirbeau s’adresse à un large public, et qu’il peut donc façonner l’opinion, alors que Huysmans ne touche qu’un lectorat restreint d’initiés. L’appui de Mirbeau n’en est que plus précieux à ses yeux : aussi bien lui demande-t-il, dans ce 7 Théodore Duret, Histoire des peintres impressionnistes, Paris, Floury, 1939. 8 Sophie Monneret, op. cit., t. I, p. 799. Quant à Mirbeau lui-même, il fait tenir à Roujon, trois ans après, ces propos hénaurmes, histoire de le tourner en dérision : « ... J’aimerais mieux... vous entendez bien... j’aimerais mieux décorer l’assassin de Bourg-la-Reine... si je le connaissais... Et comme je regrette... en ce moment... de ne pas le connaître !... Cézanne ! Ah ! ah ! ah ! Cézanne !... Et puis quoi encore ? Allons, dites-le donc tout de suite... ne vous gênez point... Brûler le Louvre, n’est-ce pas ?... » (« L’Art, l’Institut et l’État », La Revue, 15 avril 1905 ; Combats esthétiques, t. II, p. 413). 9 Joachim Gasquet, Cézanne, Bernheim, 1969, p. 69 (cité par Christian Limousin, dans sa préface à Gustave Geffroy, Paul Cézanne, Séguier, 1995, p. 38).. 10 « Le Legs Caillebotte et l’État », 24 décembre 1894 (recueilli dans Combats esthétiques, Séguier, 1993, t. II, pp. 69-72). Le nom de Cézanne y est juste mentionné, aux côtés de ceux de Manet, Degas, Renoir, Berthe Morisot et Pissarro, dont Caillebotte possédait des toiles qu’il entendait léguer à l’État. Cézanne doute tellement de lui-même que cette simple mention suffit à le combler. Mais, en même temps, elle semble l’embrigader parmi les impressionnistes, lors même que son art s’en éloigne de plus en plus. 11 Mot illisible. 12 Paul Cézanne, Correspondance, Grasset, 1937, p. 270. Dans la seconde édition de 1978, revue et augmentée, John Rewald précise qu’il s’agit du texte d’un brouillon (p. 241) : il n’est donc pas certain que la lettre ait été expédiée. 13 Lettre du 31 janvier 1895, citée par Gustave Geffroy, Paul Cézanne, Séguier, 1995, uploads/s3/ pierre-michel-cezanne-et-mirbeau-une-lettre-inedite-de-cezanne.pdf
Documents similaires





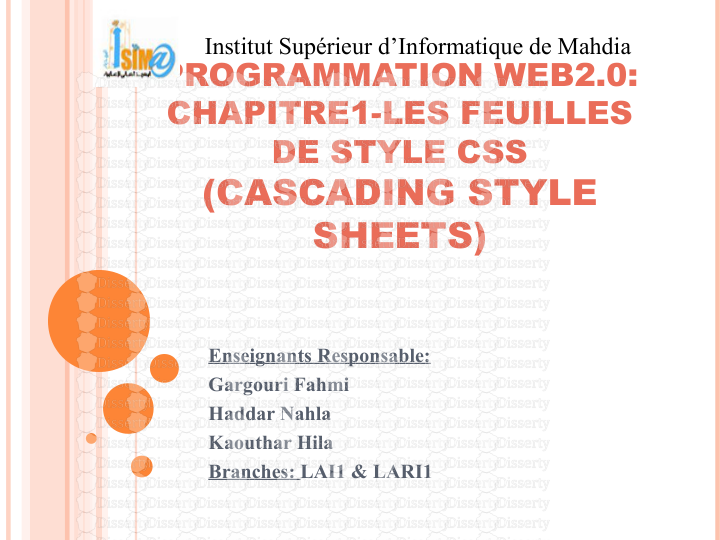




-
31
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 22, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1262MB


