See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://ww
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/332971199 Neuropsychologie de la musique : Perception, mémoire et thérapie Conference Paper · September 2006 CITATIONS 0 READS 1,034 1 author: Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Music effects on aging-related cognitive decline in rats View project Herve Platel Université de Caen Normandie 81 PUBLICATIONS 1,675 CITATIONS SEE PROFILE All content following this page was uploaded by Herve Platel on 09 May 2019. The user has requested enhancement of the downloaded file. *Innover pour mieux soigner * L’étude neuropsychologique de la perception musicale présente deux facettes complémentaires qui rendent ce thème de recherche particulièrement productif et passionnant. Tout d’abord, d’un point de vue fondamental, l’étude de la musique pour elle-même (y compris ses particularités neuroanatomiques) nous permet de mieux saisir la nature même de cet objet de culture. Il s’agit d’un vaste domaine d’étude, passant par la description des processus perceptifs de bas niveaux jusqu’à l’intégration cognitive des systèmes de représentations propres à la musique. Dans l’exploration neuropsychologique de la perception musicale, se croisent un certain nombre de questions essentielles du fonction- nement de la cognition humaine: indépendance fonctionnelle de ce domaine par rapport à d’autres comme le langage, poids des facteurs d’expertises et existence de prédispositions génétiques (ENCADRÉ 1). De plus, la musique se présente également comme un formidable outil d’investigation des fonctions cognitives (perception, mémoire, attention, émotion) et représente une alterna- tive souvent intéressante et complémentaire aux tâches verbales ou visuo- imagées proposées habituellement aux patients cérébrolésés. La perception de la musique est aussi un secteur de recherche clinique et appli- qué: clinique, car, même s’ils sont rares, des patients porteurs de lésions cérébra- les présentent parfois des troubles dans ce domaine qu’il faut pouvoir objectiver à l’aide d’outils d’évaluation adaptés, puis prendre en charge. De plus, en dehors de toute plainte spécifique portant sur la perception musicale, l’utilisation de la musique dans une visée rééducative et parfois thérapeutique a été depuis Neuropsychologie de la musique : Perception, mémoire et thérapie N E U R O E D I T O R I A L 2006 : l’année Mozart….Quoi de plus logique que de consacrer un Décryptage à la musique ? C’est tout naturellement que nous avons fait appel à Hervé Platel, l’un des spécialistes français de la neuropsychologie musicale, pour le rédiger ; il nous rappelle ici que la musique est non seulement un merveilleux outil d’investigation des fonctions cognitives mais qu’elle a aussi des vertus thérapeutiques pour bon nombre de patients comme les cérébrolésés, les déments etc. Bonne lecture à tous ! Docteur Inès CAZALA-TELINGE (Ipsen, Paris) ÉGALEMENT DANS CE NUMÉRO I Le statut de la musique dans la cognition humaine I La musique est-elle héréditaire ? I L’homme a-t-il chanté avant de parler ? I Neuropsychologie clinique de la perception musicale I L’apport des méthodes de neuropsychologie expérimentale I Musique et mémoire I Références bibliographiques Hervé Platel (Professeur de Neuropsychologie) - Inserm E0218 - EPHE - Université de Caen - herve.platel@unicaen.fr longtemps envisagée. Ce sont les avancées des recherches fonda- mentales dans ce domaine qui per- mettent aujourd’hui d’envisager de nouvelles approches musico- thérapeutiques sur des bases toujours plus objectives. I Le statut de la musique dans la cognition humaine D’un point de vue purement biolo- gique, on pourrait penser que la musique est totalement inutile à l’évolution de l’Homme, car assuré- ment pas indispensable à la survie de l’espèce, et qu’elle pourrait bien ne pas exister sans que notre évolu- tion en soit perturbée. Mais si la musique ne sert à rien, pourquoi la retrouve-t-on présente dans toutes les civilisations humaines sans exception? (ENCADRÉ 2) De nom- breuses études tendent à montrer que, du point de vue cognitif, la musique exerce une influence sur le comportement qui va au-delà des simples aspects esthétiques et/ou affectifs qu’elle est supposée transmettre (Huron, 2001). Y a-t-il une conception universelle de la musique? Dans l’esprit du musicien, du musicologue et même du citoyen non spécialiste, le terme «musique» renvoie le plus souvent à une réalité bien établie et accep- tée. Ce «confort intellectuel» est * L’aspect développemental de «l’intelligence musicale» fait réapparaître la controverse bien connue entre l’inte- raction de l’hérédité et du milieu. La question posée est la suivante: quelle est l’importance respective du facteur héréditaire et du facteur environnemental sur les compé- tences musicales? La réponse fournie diverge selon les théories psychologiques, les époques, et actuellement une position tranchée n’est plus envisageable, car l’influence des deux facteurs n’est plus contestée, ainsi le dialogue s’axe essentiellement sur le degré d’implication de l’un ou de l’autre facteur. L’américain Seashore a été le premier psychologue de la musique à souhaiter donner des bases scientifiques à l’éducation musicale. Il a mis au point des tests musicaux (1919) pour mesurer avec précision les capacités sensoriel- les, parmi lesquelles la capacité à discriminer des hauteurs, intensités, durées et agencements rythmiques des sons. Seashore avait construit sa batterie de tests dans un but bien précis: la découverte d’enfants doués musica- lement, car il n’acceptait pas l’idée de développement musical. Pour lui, le rôle de l’apprentissage était restreint. À l’heure actuelle, on sait qu’environ 5 % de la popula- tion «tout venant» est complètement insensible à la musique, ces personnes sont incapables de reconnaître, mémoriser ou discriminer la moindre mélodie alors que leurs capacités linguistiques (perceptions des mots et des voix) sont parfaitement normales. Cette absence de sensibilité à la musique, qui ne s’explique pas par des facteurs environnementaux, ni par une anomalie neuro- logique a été dénommée «Amusie congénitale» par Isabelle Peretz (Peretz et coll., 2002). Une hypothèse génétique est envisagée pour rendre compte de cette particularité, dont les conséquences seraient caractérisée par l’incapacité de pouvoir juger de la hauteur des sons musicaux, ce déficit entraînant en cascade l’impossibilité d’un développement des compétences musicales. L’étude faite par Vandenberg (1962), portant sur trentre- trois couples de vrais jumeaux et quarante-trois couples de faux jumeaux ayant passé certains tests de la batterie de Seashore et d’autres de la batterie de Wing, montre des résultats sensiblement différents entre ces deux types de populations, sauf aux tests de hauteur de sons. En 1965, Stafford rajoute qu’il a trouvé des différences significatives entre les vrais et les faux jumeaux pour le test du rythme de Seashore. En 1970, il teste cent-treize couples de vrais jumeaux et quatre-vingt-huit couples de faux jumeaux au test de mémoire mélodique. Il ne trouve guère de différence chez les vrais jumeaux ayant la même formation musicale, tandis que chez les faux jumeaux, la variabilité était plus grande chez ceux qui n’avaient pas reçu la même éducation musicale. Il conclut que la différence entre faux jumeaux s’expliquerait en partie par l’interaction avec le milieu. Shuter (1964) a fait passer l’épreuve de Wing à 6 couples de jumeaux séparés depuis la naissance. Là encore une différence ressort, et montre une certaine influence de l’hérédité, mais on ne peut tirer de conclusions nettes. Les études généalogiques ont été un autre moyen d’aborder la question. Galton (1869) compara cent-vingt musiciens, dont vingt-six avaient eu des parents éminents dans le domaine musical. Il trouva que les vingt-six personnes en question se répartissaient entre quatorze familles seulement. Ceci suggère donc une transmission héréditaire du talent musical. Les études comparatives entre les générations de musiciens trouvent des corrélations, et concluent que la tradition musicale oriente et facilite le développement musical. II faut noter que ces études ne permettent pas de dissocier l’influence du milieu et/ou de l’hérédité. Pour les familles de musiciens, celle de Bach par exemple, il est impossible de savoir ce qui peut être attribué à l’un ou à l’autre de ces facteurs. 1. LA MUSIQUE EST-ELLE HÉRÉDITAIRE ? 2 remis en question dès lors que l’on élargit son champ d’investigation dans l’espace et dans le temps. En Occident, nous donnons au terme une signification plus étroite qu’il en eut à l’origine puisque, comme nous le montre l’étymologie, il s’agissait d’abord en Grèce antique, de l’ensemble des activités gouvernées par les muses. Par ailleurs, l’acceptation globali- sante du mot est loin d’être univer- sellement partagée. Au Tibet, par exemple, le terme « n’ga-ro » désignera toute émission sonore, qu’elle soit « musicale » ou non (Canzio, 1985) et aucun terme n’existe pour cerner le champ que l’on associe en Occident à la musique. Simha Arom (1985) signa- le que, à sa connaissance, il n’y a pas de terme dans de nombreuses langues africaines pour dire «musique». Il y a bien des mots pour dire «chant», pour désigner certaines catégories de chants, pour les répertorier, mais le mot « musique » n’existe pas ; ou encore, il n’existe pas de terme générique pour « mélodie » ni «rythme». Le mot «musique» n’a pas d’équivalent non plus en arabe yéménite de même qu’en arabe classique, du moins pas avant le XXe siècle (Lambert, 1997). L’ethnomusicologie nous montre donc l’impossibilité d’arriver à une définition universellement satisfai- sante de la musique. Il ressort néanmoins de ces travaux que du point de vue du caractère uploads/s3/ plaquette-ipsen-2006.pdf
Documents similaires





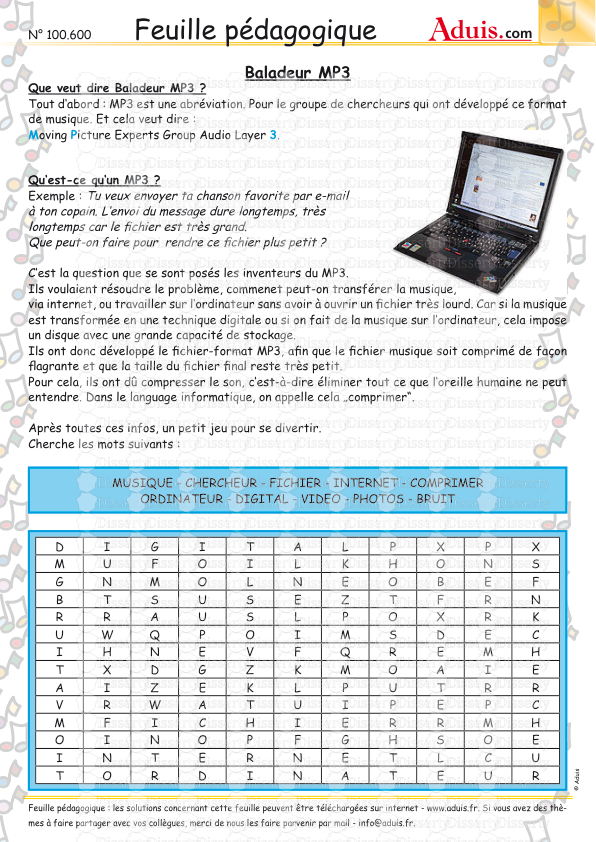




-
148
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 08, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.9103MB


