L’IMPRESSIONNISME CHEZ OCTAVE MIRBEAU : UNE ESTHÉTIQUE DE LA FLUIDITÉ IMPRESSIO
L’IMPRESSIONNISME CHEZ OCTAVE MIRBEAU : UNE ESTHÉTIQUE DE LA FLUIDITÉ IMPRESSIONNISME LITTÉRAIRE ? La question de savoir si on est en droit d'utiliser un même terme, l'impressionnisme, pour caractériser un groupe de peintres hétérogène est tout à fait légitime. Ils n'ont, tout bien pesé, que peu de points communs et, sauf à les faire entrer de force dans un cadre simplificateur à outrance, ils sont réfractaires à toute entreprise classificatrice et, par voie de conséquence, réductrice. Ajoutons que ce groupe est dépourvu d'un centre de gravité, à la différence du naturalisme littéraire, par exemple, qu'il est allergique à toute doctrine et à toute théorie esthétique, et que deux de ses membres les plus connus, Manet et Degas, sont en fait en-dehors du mouvement : l'un est un devancier, l'autre se situe volontairement au-delà, comme le dit Virginie Pouzet1. L'impressionnisme n'existerait-il donc, en peinture, que par ses marges ? En littérature, le problème est encore plus complexe et le maniement du qualificatif d'impressionniste est encore plus délicat, d’autant qu’il a engendré plusieurs malentendus . Il n’en reste pas moins que cette expression controversée d’impressionnisme littéraire a du moins le mérite de mettre en lumière le lien étroit qui unit la création littéraire et la critique d’art, comme le révèle en particulier l’œuvre d’un écrivain qui a été trop longtemps, après sa mort, relégué, à tort, parmi les mineurs : Octave Mirbeau. Nous allons précisément essayer d’analyser l’influence que son expérience de la critique d’art a pu avoir dans son écriture romanesque. Il convient, pour commencer, de définir ce que nous entendons par critique d’art : un genre littéraire englobant tout discours sur l’art, ce qui va du traité esthétique àux comptes rendus des expositions d’art. Pour nous, elle ne se réduit pas aux professionnels de la critique journalistique, mais comprend aussi, plus généralement, tous ceux qui s’expriment sur l’art. À cette pratique protéiforme se sont adonnés nombre d’écrivains du XIXe siècle, notamment Baudelaire et Zola : l’un prônait une critique « partiale, passionnée et politique » (Salon de 1846), cependant que l’autre faisait de ses comptes rendus un point de départ privilégié pour mener à bien son combat pour le Naturalisme. La critique d’art reflète les changements intervenus dans le champ artistique à l’époque et, au premier chef, témoignent du déclin du système académique, de la dégradation du Salon et de la prolifération consécutive d’expositions alternatives2, ce qui permit l’avènement de ce qu’on a appelé le « système marchand-critique ». Dans une phase où le débat artistique se fait particulièrement fervent, les critiques d’art jouent un rôle de plus en plus important dans le processus de légitimation des artistes et de leurs travaux. Moyen pour exercer son hégémonie dans le champ artistique, tremplin de lancement pour les jeunes littérateurs débutant, la critique artistique est intensément exploitée à l’époque des expositions des impressionnistes, qui divisèrent indéniablement l’opinion publique. Le jeune Mirbeau, fort de son expérience dans la presse, dans les années 1880, 1 Virginie Pouzet-Duzer, L’Impressionnisme littéraire, Paris, PUV, 2013. L’interprétation de l’impressionnisme fut multiforme. Rappelons celle d’Émile Zola, qui en fit un équivalent du réalisme. Sur les malentendus critiques de l’impressionnisme, voir les études de Bernard Vouilloux. 2 En 1863 on organisa le premier Salon des refusés et en 1881 l’État quitta l’organisation du Salon annuel, remplacé par un Salon triennal, dont l’organisation fut confiée à une société d’artistes. Les expositions s’intensifient à la fin du siècle : celles des impressionnistes, celles de la Société des artistes français, celles, sans Jury, du Salon des Indépendants, ou bien encore les expositions privées dans les galeries de Georges Petit ou dans celle de Durand-Ruel. quitte l’anonymat et la négritude et, en tant qu’homme politiquement engagé en lutte contre les institutions, se fait le défenseur de ces artistes révolutionnaires, désireux de s’affranchir de la tradition académique. Est-ce suffisant pour qu’on puisse le qualifier d’impressionniste ? Pour répondre à cette question, nous allons nous pencher sur l’écriture d’Octave Mirbeau, qui se caractérise notamment par un fécond va-et-vient entre sa critique d’art et sa production narrative. Son exemple permettra de confirmer la pertinence de l’idée de Virginie Pouzet, pour qui c’est à partir de la critique d’art que l’on peut saisir comment une catégorie, qui était limitée initialement aux arts plastiques, a pu être étendue à la littérature. De fait, admirateur des impressionnistes, qu’il appuie sans réserves à partir de 1884, ami de Claude Monet et de Camille Pissarro, Mirbeau nous révèle, à travers ses pages de critique d’art recueillies par Pierre Michel et Jean-François Nivet dans les deux tomes de ses Combats esthétiques, le fonctionnement du système marchand-critique et nous permet de suivre l’évolution de ses idées esthétiques. Plutôt que de parler, comme Brunetière, d’« une transposition systématique des moyens d’expression d’un art, qui est l’art de peindre, dans le domaine d’un autre art, qui est l’art d’écrire3 », il nous semble qu’on peut établir un parallélisme entre impressionnisme pictural et impressionnisme littéraire, qui partagent le même fond émotionne4 et la même volonté de suggérer au lieu de fixer une image du monde. En épousant ainsi le point de vue de Bernard Vouilloux5, nous éviterons de nous pencher sur les effets stylistiques et ferons plutôt référence à des catégories plus amples, telles que les axes cognitifs et émotifs de l’époque en question. Il est indéniable en effet qu’au dix-neuvième siècle littérature et peinture puisent aux mêmes sources d’inspiration, comme en témoigne notamment la camaraderie entre peintres et écrivains6. Tout d’abord, nous observons que la critique d’art de Mirbeau constitue un véritable laboratoire où il exerce son style et élabore sa poétique, faisant siens les principes esthétiques de l’impressionnisme. Il en découle qu’un très propice va-et-vient s’instaure entre critique d’art et construction romanesque : en effet, la seconde emprunte à la première des matériaux et des formes, puisque, d’une part, les commentaires d’art influencent les modalités descriptives des romans et que, d’autre part, bien des pages de critiques d’art sont réutilisées dans les romans. IMPRESSIONNISME ET DISSOLUTION DE LA MATIÈRE Pour en revenir à l’interprétation et à l’évaluation de l’impressionnisme pictural de la part de Mirbeau, la question qu’il faudra maintenant se poser est la suivante : quels sont les repères esthétiques typiquement impressionnistes mis en lumière par l’auteur dans son évaluation des tableaux ? Dans cette démarche, nous nous appuierons sur les observations de 3 Ferdinand Brunetière, L’Impressionnisme dans le roman. 4 Selon Virginie Pouzet, il y a un évident témoignage du partage entre peintres et écrivains 5 Voir à ce propos l’article de Bernard Vouilloux « L’impressionnisme littéraire : une révision », dans Poétique, n°121, février 2000, pp. 61-92. D’après le critique, la définition traditionnelle de l’impressionnisme littéraire serait un artefact critique reposant sur la théorie de l’œil innocent. Les présupposés phénocentristes (le peintre peint ce qu’il voit) et perceptivistes (le peintre voit ce qu’il sent) sont dépassés par la Gestalttheorie et par les théories perceptives suivantes. Vouilloux observe encore que le mythe de l’œil innocent confond la vision avec la sensation visuelle, excluant ainsi le rôle des mécanismes cognitifs, ce qui ne serait pas admissible de la part de l’associationnisme, dont il se sert comme base savante. En vérité, les traits qualifiant l’impressionnisme littéraire seraient, selon lui, « des constantes discursives transhistoriques, liées à une tendance psychologique permanente ». 6 Comme le souligne Virginie Pouzet, les portraits d’écrivains sont des témoignages culturels d’un partage esthétique. Citons les portraits que Manet fit d’Astruc, de Zola et de Mallarmé. Félix Vallotton, pour sa part, a réalisé deux portraits de Mirbeau, et Cézanne un portrait de Gustave Geffroy. René Huyghe, qui, au vingtième siècle, caractérise la peinture impressionniste par la dissolution de la matière en tant que poids, solidité et masse : Un sens nouveau de la nature apparaît alors: tout ce qui en elle évoquait l’immobilité, la stabilité, s’efface ; elle est sollicitée de plus en plus par le fluide et l’impalpable ; elle perd ses qualités de poids, de densité, de fermeté; à la fois son contenu, sa forme et sa tangibilité pour se dissoudre en une apparence impondérable.7 Mirbeau paraît anticiper les intuitions de René Huyghe quand, se référant à l’œuvre de Claude Monet, dont il exalte la magnifique éloquence dans l’interprétation de la nature, il décèle, dans ses paysages, la dissolution des contours et l’estompage des formes. On peut citer à ce propos un passage où les référents réels, c’est-à-dire les cieux, les collines et les plaines, les villages et leurs clochers, sont plongés dans une atmosphère vaporeuse et évanescente : Les cieux se voilent de nuages, les collines sortent de l’ombre matinale, les plaines s’étirent, réveillées par l’ardent soleil qui dissipe leurs rêves en brouillards lumineux. Des végétations énormes, avec la force des sèves qui montent, tordent leurs branches vigoureuses et emmêlent leurs âcres et puissantes chevelures. Les mers vibrent, comme des cordes tendues par un arc invisible. Les villages et leur clocher léger, vaporeux, apparaissent dans la brume ensoleillée des jeunes matins ; les pelouses s’étalent, les prairies s’étendent avec mollesse, les fleurs vivantes respirent, remuent, boivent la lumière.8 Claude uploads/s3/ raffaella-tedeschi-l-x27-impressionnisme-chez-octave-mirbeau-une-esthetique-de-la-fluidite.pdf
Documents similaires








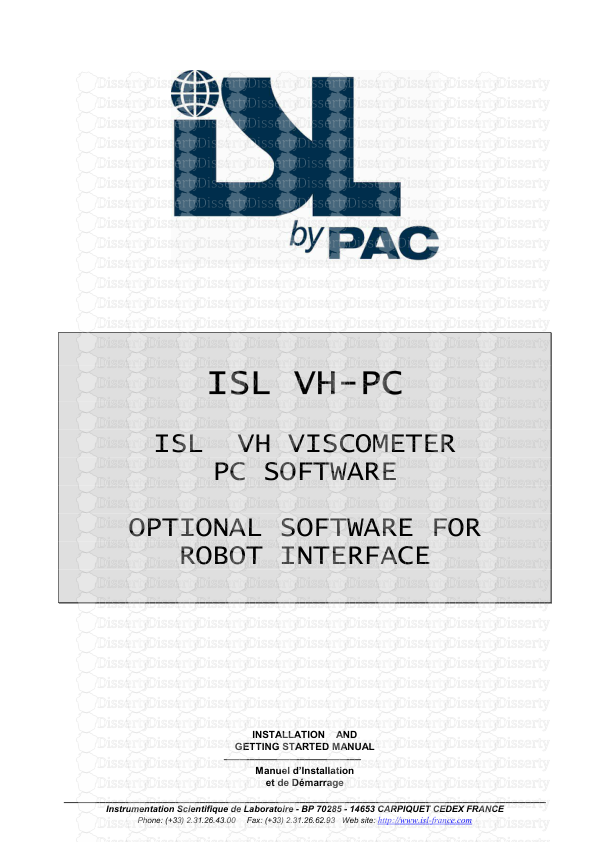

-
35
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 09, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.5115MB


