CONSEIL SUPERIEUR DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE RAPPORT DE LA MISSIO
CONSEIL SUPERIEUR DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE RAPPORT DE LA MISSION SUR LA REALITE VIRTUELLE ET LA REALITE AUGMENTEE Président de la mission : Jean Martin Rapporteur : Alexandre Koutchouk Rapport présenté à la réunion plénière du CSPLA du 23 septembre 2020 Son contenu n’engage que ses auteurs Juin 2020 Synthèse L’expression « réalité virtuelle », traduction approximative de l’anglais virtual reality, ou ses homologues françaises, réalité de synthèse ou réalité artificielle, se réfèrent aux techniques permettant à l’utilisateur d’avoir le sentiment de pénétrer dans un univers synthétique, réel ou imaginaire, au sein duquel il pourra se déplacer et interagir avec lui. La réalité augmentée permet d’enrichir visuellement la perception de la réalité par des informations ou des images générées par un accessoire dédié. La réalité mixte combine ces deux techniques, qui ont en commun deux caractéristiques essentielles : l’immersion dans un monde artificiel et l’interaction en temps réel avec celui-ci. Les techniques immersives permettent la création d’objets immersifs. Ceux-ci sont-ils des œuvres susceptibles d’être protégées par le droit de la propriété intellectuelle et si oui, par lequel des régimes légaux existants et avec quelle pertinence ? C’est l’objet du présent rapport, qui tend à démontrer que le droit de la propriété intellectuelle ne peut pas se désintéresser de l’essor des objets immersifs qui se diffusent aujourd’hui largement, dans le grand public comme dans le monde professionnel. La première partie du rapport s’attache tout d’abord à décrire l’émergence des techniques immersives depuis les années 1950, leur diffusion progressive au sein du monde professionnel et leur affirmation dans le grand public à compter des années 2010 grâce à la baisse des prix rendant abordables des outils devenus par ailleurs enfin efficaces (les casques notamment), le tout étant rendu possible à la fois par les progrès de l’optique et des écrans (sous l’influence de l’avancée des smartphones) et par la nette augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs. Elle illustre ensuite la diffusion de ces techniques, d’abord dans le domaine professionnel et notamment en matière de réalité augmentée : applications militaires (simulateurs de vol aujourd’hui utilisés dans les parcs d’attraction ou simulateurs d’expériences de combat), larges utilisations industrielles en matière automobile, ferroviaire ou pharmaceutique permettant des gains de productivité impressionnants, médecine (formation initiale des étudiants, apprentissage de techniques opératoires voire opérations elles-mêmes), enseignement et formation professionnelle, commerce et logistique, immobilier, architecture et design ou patrimoine. C’est ensuite auprès du grand public que les techniques immersives ont opéré leur percée : c’est le cas des jeux vidéo mais, plus largement, des industries culturelles et de l’entertainment : audiovisuel (avec en France le rôle moteur de Arte et du CNC), cinéma (avec des festivals dédiés à la VR à Cannes, Tribeca ou Venise), institutions culturelles (visites virtuelles des musées et des expositions), parcs d’attraction, salles d’arcade dédiées ou escape games en réalité virtuelle. Pour autant, malgré des potentialités remarquables, les techniques immersives ne semblent pas encore largement adoptées par le grand public et les prévisions de couverture de la population, souvent optimistes, sont régulièrement déjouées. Le prix des outils reste bien sûr un obstacle important, même si ce facteur s’atténue à mesure de la diffusion des progrès techniques ; le nombre insuffisant de contenus de qualité est aussi un élément explicatif, alors même que le coût de production des œuvres reste élevé et que le secteur productif est encore, en France, relativement peu structuré. Il manquerait surtout la « killer ap », c’est-à-dire l’outil ou l’usage permettant le déclic d’achat pour une utilisation massive de ces techniques par le grand public. La deuxième partie du rapport montre que, alors que le régime juridique des objets immersifs n’est pas encore stabilisé, en particulier la nature de la protection offerte par le droit de la propriété intellectuelle, ce qui peut freiner le développement de ce secteur prometteur, un consensus n’émerge pas pour le faire évoluer dans un sens déterminé, dans un contexte d’absence de contentieux sur la qualification et la protection des œuvres. La reconnaissance du statut d’œuvre protégée par le droit de la propriété littéraire et artistique, que l’objet immersif soit créé ex nihilo ou qu’il émane d’une captation du réel, fait peu de doute, selon la Mission. Plus délicate en revanche est la question du moment où l’œuvre naît, tant la multiplicité des acteurs et la segmentation, matérielle comme temporelle, du processus créatif diffère des procédés classiques. Un objet immersif voit souvent coexister en son sein des éléments de nature différente bénéficiant chacun d’un régime juridique propre : œuvres littéraires, musicales, graphiques et / ou audiovisuelles liées ensemble par des logiciels et des bases de données pour assurer leur interaction réciproque mais aussi par la mise en œuvre de techniques de géolocalisation et l’utilisation d’outils technologiques (casques et gants par exemple) éventuellement protégés par le droit des brevets. La présence simultanée de plusieurs œuvres à la nature juridique différente entraîne a minima la protection concurrente, distributive, de plusieurs droits, selon la jurisprudence Cryo de 2009 de la cour de cassation : à chaque facette de l’objet immersif, s’applique le régime juridique propre qui la régit. Faut-il aller plus loin et reconnaître que l’objet immersif lui-même est une œuvre à part entière à protéger de façon unitaire ? c’est en tout cas la position de la cour de justice de l’Union européenne en ce qui concerne les jeux vidéo. Il est par ailleurs difficile de trancher entre le statut d’œuvre de collaboration ou d’œuvre collective et le juge ne sera jamais impressionné par les qualifications que les parties donnent aux œuvres, seule leur nature important. Or les incertitudes juridiques entourant la qualification de l’œuvre immersive peuvent, si ce n’est bloquer, du moins freiner le développement du secteur en France, faute de permettre toute la clarté sur les questions essentielles de la titularité des droits, de la rémunération ou de lisibilité et de la pertinence du régime légal applicable. Aussi, sur la base du modèle qui avait été recommandé par le rapport d’une commission du CSPLA pour les œuvres multimédia, la Mission propose de faciliter la reconnaissance de la qualité d’auteur et leur identification par le jeu d’une présomption reposant sur la participation aux tâches déterminantes dans la création de l’œuvre, quitte à renvoyer au secteur la définition fine de ce que sont ces tâches compte tenu du caractère évolutif de la création immersive. De même, faciliter les investissements dans le secteur tout en assurant aux auteurs les fruits de leur travail créatif peut passer par l’institution d’une présomption, non de titularité initiale des droits mais de cession automatique des droits d’exploitation au studio ou à l’éditeur. La cession pourrait dans certaines conditions s’accompagner d’une rémunération forfaitaire. Une phase de concertation permettrait aux parties de s’accorder sur un guide de bonne pratique décrivant les tâches des intervenants dans le processus de création des œuvres immersives, facilitant la reconnaissance de ceux qui seront investis de la titularité des droits en vertu de la présomption de la qualité d’auteur. Les professionnels, par une grille consensuelle, seraient en charge de définir la nature des contributions suffisamment déterminantes pour bénéficier d’un régime de protection adapté, ainsi que les aménagements aux modes traditionnels de rémunération que les réalités économiques du secteur pourraient rendre opportunes. Il est ensuite aisé de prévoir, par le contrat, la cession automatique des droits patrimoniaux au profit de l’investisseur. Il s’agit ainsi de renforcer et de sécuriser les investisseurs ou les entrepreneurs par la reconnaissance d’un droit propre sur l’œuvre, « augmentée » du bénéfice d’une présomption de cession des droits des auteurs présumés, mais aussi des autres qui, le cas échéant, se révéleraient. Lorsque la pratique aura atteint un degré suffisant de maturité, une évaluation permettra de déterminer s’il est opportun de passer à une seconde étape, cette fois législative, pour confirmer définitivement ce que les professionnels auront eux-mêmes créés. Table des matières Synthèse .................................................................................................................................................. 2 Introduction ............................................................................................................................................. 9 1. Les techniques immersives sont appelées à submerger la vie, quotidienne comme professionnelle… mais elles peinent encore à trouver leur public ........................................................ 12 1.1. Des techniques qui semblent appelées à submerger notre quotidien .................................. 13 1.1.1. Une brève histoire de l’immersion et de ses techniques ............................................... 13 1.1.1.1. Depuis la première peinture et le premier plan d’architecte jusqu’aux salles de réalité virtuelle et au-delà .......................................................................................................... 13 1.1.1.2. Le bénéfice de ces techniques repose encore aujourd’hui sur des outils, accessoires indispensables de leur utilisation ............................................................................................... 15 1.1.2. Une présence aujourd’hui massive dans tous les domaines, de la science jusqu’à l’immobilier, en passant par la culture........................................................................................... 17 1.1.2.1. Le domaine professionnel reste aujourd’hui encore le secteur privilégié de l’utilisation de ces techniques .................................................................................................... 18 1.1.2.2. La percée récente de ces techniques auprès du grand public, notamment dans les industries culturelles et en particulier dans le jeu vidéo ............................................................. 23 1.2. Mais qui peinent encore à trouver leur public et un débouché commercial satisfaisant ...... 27 1.2.1. A la recherche de la « Killer Ap ? » ................................................................................. 27 1.2.1.1. Malgré un potentiel indéniable, l’utilisation grand public peine à éclore ............... 27 1.2.1.2. Les facteurs explicatifs de l’intérêt uploads/s3/ rapport-cspla-mission-rvra.pdf
Documents similaires






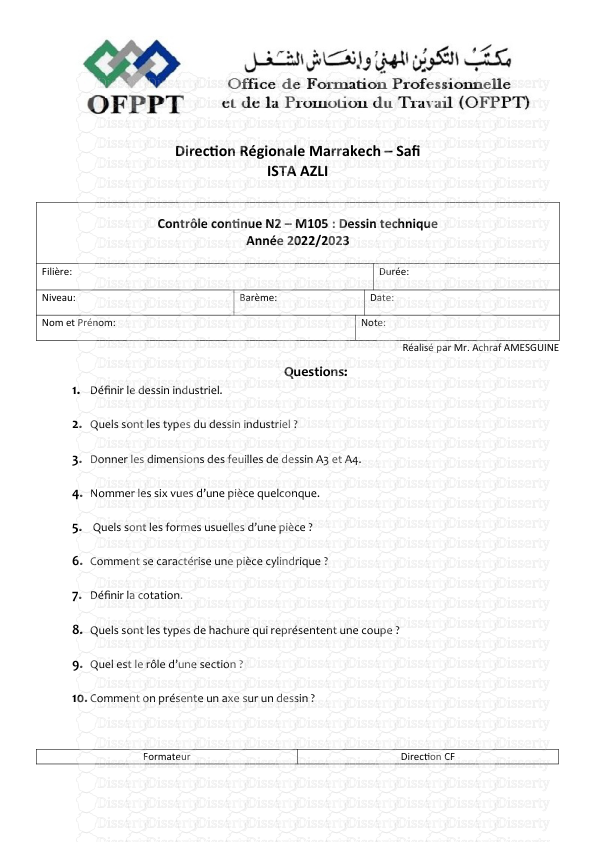



-
77
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 28, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.0965MB


