© Présence d’André Malraux sur la Toile / www.malraux.org / 23.12.2011 Régis De
© Présence d’André Malraux sur la Toile / www.malraux.org / 23.12.2011 Régis Debray L’art à l’estomac, ou l’anti-Malraux On trouvera ici la transcription d’une intervention orale, dans le cadre d’un séminaire mensuel de médiologie. Elle enchaîne sur les réflexions déjà publiées de Michel Melot, ancien directeur de l’Inventaire de France, louant la lucidité esthétique d’André Malraux. Relire Malraux est-il pertinent pour comprendre l’actualité artistique ? La réponse de Michel Melot est oui (voir Médium 2, « Malraux le prémonitoire »). J’irai dans son sens, mais qu’il me permette d’ajouter une deuxième question à la sienne : qu’est-ce que « l’art contemporain » peut changer à notre compréhension de ses ébouriffants Écrits sur l’art ? Quelle métamorphose impose au chantre des métamorphoses l’entrée de millier de « non-œuvres » sur la scène de l’art que nul n’aurait pensé à admirer en 1950, et sans doute pas Malraux lui-même, qui récusa en son temps l’art brut ? Qu’ont à nous apprendre sur cette religion de la création le land art, l’arte povera, les arts de l’abject, etc. ? L’apothéose des divas de la scène artistique d’aujourd’hui invalide-t-elle ou non cette divination de l’acte artistique ? Les raisons d’un rejet Une précision, d’abord. Relire les Écrits sur l’art est un euphémisme. Parce que au fond on ne les a jamais lus, ou si peu. C’est devenu possible grâce à l’exploit éditorial de Gallimard, qui a transformé une série indéfinie d’in-quarto introuvables en deux in- octavo illustrés en couleurs, ainsi qu’un minutieux et remarquable encadrement critique. On avait jusqu’ici des lambeaux, des raretés, un bras par-ci, une jambe par-là. On a maintenant, par le génie du papier bible, le Malraux imaginaire, comme on avait eu, par le génie de la photo, Le Musée imaginaire. Régis Debray : «L’art à l’estomac, ou l’anti-Malraux» 2 © Présence d’André Malraux sur la Toile / www.malraux.org / 23.12.2011 La malédiction qui pèse sur cette somme ne sera cependant pas levée de sitôt par le tour de force technique de la Pléiade. À preuve, dans les comptes rendus de presse, superficiellement élogieux, l’absence de lecture attentive, de tout examen au fond – et le maintien de la tradition assassine (Gombrich, Duthuit, etc.) dans nos journaux dits sérieux. L’éreintement a sa part de légitimité. Malraux ne l’a pas volé. On peut même se demander s’il ne l’a pas cherché, si l’émetteur n’a pas tout fait pour mettre en échec sa réception. Du jeune auteur de La Tentation de l’Occident, son ami Drieu disait, dans les années 1920 : « Des éclairs et de la fumée. » Il a fait de l’énigme un style, y compris un style de vie (le moi fabulateur effaçant toute distanciation entre le romancier et sa créature). Le Musée imaginaire a porté à son comble l’art des points de suspension, les mots valant moins pour ce qu’ils désignent que pour ce qu’ils suggèrent. D’où un va-et-vient chez le lecteur entre le coup de foudre (par l’éclair) et l’asphyxie (par la fumée). L’Université n’a vu que le fumeux, et donc rien retenu du tout. Nos départements « Esthétique et théorie de l’art » l’ignorent (où fleurissent à l’envi Adorno, Horkheimer, Deleuze, Benjamin). L’Université, on le sait, n’est pas un lieu d’invention mais une machine de répétition : ça ne crée rien, mais ça reproduit bien. Donc, côté étudiants, panne de transmission. Quant au public cultivé… Malraux est trop érudit pour les littéraires, trop littéraire pour les érudits. Il ne parle pas le philosophe, tout en alignant les philosophèmes. Le chaman tempère, mais en fait aggrave, un certain kitsch cosmo- lyrique (la main tremblante dans le crépuscule, le chant des constellations, etc.) par l’ellipse mallarméenne, en sorte qu’un grincheux peut lui reprocher à la fois l’emphatique et l’abscons, télescopage propre aux incantations du sorcier comme du prophète. Comment un médiologue peut-il expliquer ce long rejet, par les diablotins de la critique comme par les spécialistes de l’histoire de l’art ? Quelques pistes, en passant. D’abord, cet Argonaute pratique le tour du monde en quatre-vingt mots. Ce qui donne le tournis. Ce goût aujourd’hui démodé du panoramique et de l’histoire philosophique (genre Spengler ou Toynbee) produit l’équivalent littéraire des grandes machines à la Cecil B. De Mille, à la Abel Gance. Elles n’ont plus cours à l’ère de « l’idiotie Régis Debray : «L’art à l’estomac, ou l’anti-Malraux» 3 © Présence d’André Malraux sur la Toile / www.malraux.org / 23.12.2011 dispersive » et du Nobel analphabète. Cela dit, sa monographique méticuleuse et fouillée sur Vermeer ne cadre nullement avec l’accusation classique des spécialistes : « pensée de survol ». Ensuite, le style constamment allusif qui ne respecte pas la déontologie critique (sans notes, sans dates, sans noms d’auteurs) s’aggrave avec la tactique connue de l’autopromotion : ne jamais citer ses contemporains (et, en ce qui le concerne, les classiques non plus). Élie Faure et Benjamin : il gomme autant qu’on peut les sources. Malraux est un critique perçant, mais sans scrupules. Il ne joue pas le jeu des travailleurs de la preuve. Enfin, son génie du collage et du montage a pour envers une rhétorique de l’asyndète généralisée qui, télescopant trois millénaires et deux continents en une phrase, laisse le lecteur ébahi, étourdi et, à la fin, estourbi. André la Sibylle a 39 de fièvre. Perpétuellement survolté, sans plage de repos, c’est le tir tendu. Trop de hauteur de ton garantit l’essoufflement chez l’homme des vallées qui tente de suivre le guide. D’où le côté hors-la-loi de cet officiel (ministre d’État, donc mauvais sujet), et le too much de l’œuvre. Sa lecture fatigue autant qu’elle ravit. Et, sur le fond, un philosophe professionnel ajoutera que non, trop facile. Il ne suffit pas de renoncer au pia-pia Diafoirus et à la note en bas de page pour être à l’esthétique ce que Zarathoustra est au prof de philo. « L’art relève la tête quand la religion perd du terrain » : Nietzsche l’avait pronostiqué, Malraux l’a pratiqué. Car quoi de plus nietzschéen, en effet que le procès de la vision réaliste de l’art, qui sert de point de départ au Musée imaginaire et de leitmotiv à La Métamorphose des dieux, tout au long du triptyque ? J’en rappelle les trois titres, qui illustrent à la fois des époques et des états d’esprit : Le Surnaturel, quand l’art rend sensible les puissances surnaturelles (le mystère des grandes forces cosmiques), par la mise au jour d’un sacré latent. L’Irréel, qui est le temps de l’idéalisation, quand l’art figure un homme et un monde plus beaux que nature (mais dont nous portons l’idée en nous). C’est le divin dédivinisé. Et L’Intemporel, enfin, qui est le temps de la création libre, où s’affirme la volonté humaine toute nue, pour la plus grande gloire de l’homme. Régis Debray : «L’art à l’estomac, ou l’anti-Malraux» 4 © Présence d’André Malraux sur la Toile / www.malraux.org / 23.12.2011 À l’embarras du style, l’avocat du diable (puisque je joue ce rôle, provisoirement) ajoutera le flou du vocabulaire. Les notions de base sont mal cernées, les pilotis donnent l’impression de flotter. Le mot art, par exemple : on aurait pu s’attendre à ce que Malraux, là-dessus, abatte son jeu. « Il faudrait quand même commencer par définir ce dont nous voulons parler », note à ce propos Michel Melot. De la création, de l’œuvre d’art, de la production volontaire ? Ou bien du patrimoine, des traces, de l’inventaire des vestiges d’un territoire ? Chez ce maître de l’équivoque, le malentendu ne manque jamais de fécondité. Le mot art a deux sens dans ces Écrits, et on saute sans préavis de l’un à l’autre. Comme dans cette phrase : « Aucune civilisation avant la nôtre n’a connu le monde de l’art créé par les artistes pour qui l’idée d’art n’existait pas » : juste notation, si l’on pense aux primitifs. Mais on joue sur le mot. L’art relève tantôt d’une histoire, tantôt d’une spiritualité. Dans ce dernier sens, l’art, l’éternel témoin de notre dignité, sera la seule chose qui nous permet de nier notre mort ; mais on n’écarte pas non plus le premier, à savoir : ce qui surgit à la Renaissance, quand l’art s’émancipe du sacré et devient lui- même sa propre référence. Au sens épisode, l’art correspond au moment de « l’irréel ». Et au sens éternité, il sert d’accolade aux trois époques et aux trois volumes comme dénominateur commun, l’englobant des métamorphoses où s’affirme la parenté secrète de toutes les œuvres plastiques, unies souterrainement par leur victoire commune sur le temps. Ce qui rend possible le « je suis entré en art comme on entre en religion ». En ce sens-là, qui est l’apport propre de Malraux, l’art recèle quelque chose de plus profond que l’enchaînement des styles et des périodes. L’art, c’est ce qui échappe à l’histoire de l’art. « L’histoire proclame que les styles passent, et dédaigne que le style demeure… » L’histoire de l’art ne rend pas compte du monde de l’art, pas plus, dirais-je, que l’histoire des religions ne rend compte de uploads/s3/ regis-debray-de-malraux.pdf
Documents similaires








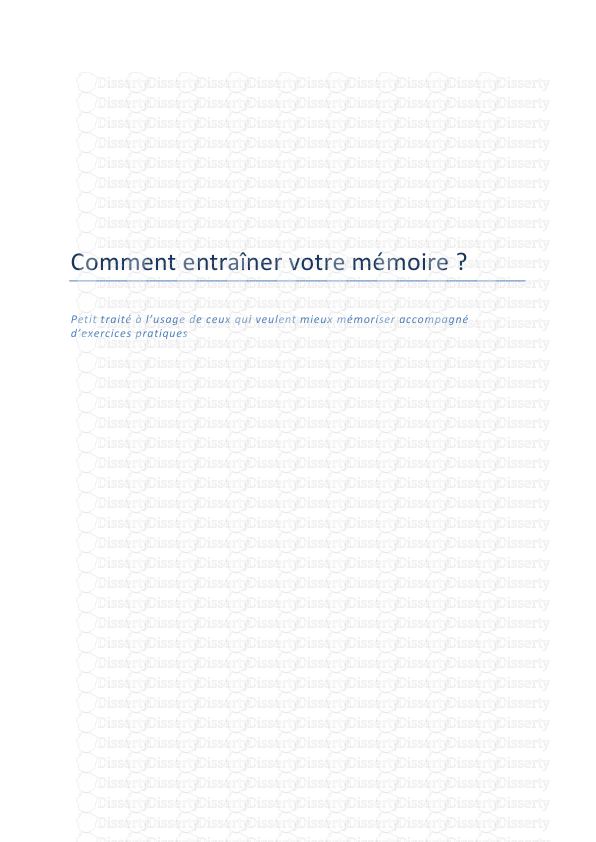

-
88
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 23, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1928MB


