« MIRBEAU BATAILLE POUR MOI »1 ARISTIDE MAILLOL ET OCTAVE MIRBEAU « Mirbeau bat
« MIRBEAU BATAILLE POUR MOI »1 ARISTIDE MAILLOL ET OCTAVE MIRBEAU « Mirbeau bataille pour moi2 » Le critique d’art Octave Mirbeau est considéré comme le découvreur d’Aristide Maillol (1861-1944), ou au moins comme l’un d’entre eux. Maillol vient de Banyuls-sur-Mer, village de pêcheurs situé à proximité de la frontière espagnole, sur la côte méditerranéenne. Il étudie la peinture à Paris, et, dans les années 1890, expose dans la section Objets d’Art du Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts (SNBA). Il devient sculpteur peu après, et est considéré comme le représentant le plus significatif de sa génération en France et dans le monde. L’exposition Maillol à la galerie Vollard C’est certainement grâce à cette manifestation que Mirbeau découvre le travail de Maillol. Première exposition monographique de l’artiste, elle a lieu du 16 au 30 juin 1902, et regroupe 33 œuvres : des tapisseries, des objets d’art, et, pour la première fois, un nombre notable de sculptures, environ une vingtaine. La seule sculpture citée dans le catalogue est Léda, la plus célèbre des petites sculptures de Maillol. C’est justement celle dont Mirbeau fait l’acquisition. En 1919, à la vente aux enchères de la succession Mirbeau, le bronze est acheté par le collectionneur suisse Oskar Reinhart3 (ill.1). Cette Léda est le premier bronze documenté de Maillol, c’est-à-dire dans la chronologie de son œuvre, le plus ancien connu avec certitude. A la suite de ce premier achat, Mirbeau acquiert de quelques autres œuvres de Maillol. Aristide Maillol, Léda, vers 1900, Collection Oskar Reinhart am Römerholz, Winterthur (ancienne collection Mirbeau) 1 François Bassères, Maillol mon ami, Perpignan, 1979, p. 90. 2 François Bassères, Maillol mon ami, Perpignan, 1979, p. 90. 3 Maria-Antonia Reinhard-Felice (Ed.),: Sammlung Oskar Reinhart ‘Am Römerholz’, Winterthur, Gesamtkatalog, Basel 2003, n°183 (Emmanuelle Héran). 1 Octave Mirbeau s’intéresse également à la jeune génération de créateurs, par exemple aux peintres du groupe Nabi, auquel Maillol n’est que faiblement lié4. Il est possible que l’un d’entre eux ait indiqué à Mirbeau l’exposition de ce sculpteur jusqu’alors inconnu. Est-ce ÉEdouard Vuillard, Ambroise Vollard, ou Auguste Rodin, qui a signalé l’exposition à Mirbeau ? Cela reste difficile à déterminer, mais il est évident qu’un artiste, exposé dans l’une des galeries les plus importantes de Paris, pouvait être découvert par plus d’un. La Léda est l’un des premiers chefs-d’œuvre de Maillol, et Mirbeau rapporte les paroles élogieuses de Rodin à son sujet : « Maillol est un sculpteur aussi grand que les plus grands… Il y a là, voyez-vous, dans ce petit bronze, de l’exemple pour tout le monde […]. Je suis heureux de l’avoir vu5 ». La bataille pour le monument à Zola Mirbeau a dû être très impressionné par sa visite de l’exposition Maillol et par la présence de la Léda dans son appartement. Il conçoit alors une idée tout à fait étonnante : celle d’obtenir pour Maillol, sculpteur du petit format, la commande d’un grand monument à Zola. L’auteur de « J’accuse ! » meurt le 29 septembre 1902. Tout de suite, à l’initiative de la Ligue des Droits de l’Homme, un comité de 14 membres est créé afin d’ériger un monument et de collecter des fonds. Il se réunit pour la première fois le 28 octobre 1902, quatre semaines après le décès de Zola, et Mirbeau est l’un de ses trois vice-présidents. ÀA ses yeux, Rodin est le sculpteur qui doit créer un tel monument, mais celui-ci décline l’offre. C’est pourquoi Mirbeau propose soudain Maillol. ÀA partir des discussions de la première réunion du comité, Mirbeau crée un texte satirique, aussi palpitant que piquant, qu’il n’a pas publié à l’époque. Il paraît pour la première fois de manière posthume6. Quelques extraits de ce texte permettent de sentir l’atmosphère tendue des échanges entre ses membres : . « Je proposai Aristide Maillol. […]. Aucune pensée de camaraderie ne m’avait incité à ce choix. […] Je ne trouvais pas, à défaut de Rodin, un statuaire plus digne de cette mission que Maillol […]. / On me regarda avec étonnement, d’abord, avec méfiance, ensuite. Dans ce milieu technique, on connaissait peu Maillol, autant dire, bravement, qu’on ne le connaissait pas du tout. Il ne faut pas en être surpris. C’est […] le traditionnel privilège des commissions dites techniques, exécutives ou d’étude, qu’elles ignorent à peu près tout des questions soumises à leur incompétence […]. Il me semblait pourtant que c’eût été d’un bon exemple et d’une pensée délicate de confier à un homme jeune, d’un talent admirable, un monument qui célébrât, avec beauté, la gloire du grand écrivain, lequel, toute sa vie, avait été l’ennemi de la routine7 ». Mirbeau note scrupuleusement les arguments de ses opposants : 4 Paul-Henri Bourrelier, « Octave Mirbeau et l’art au début du XXe siècle », in Cahiers Octave Mirbeau, n° 10, mars 2003, pp. 167-188. 5 Octave Mirbeau, Aristide Maillol, Paris, Société des dilettantes, 1921, p. 29. 6 Le texte est écrit en novembre 1904. Octave Mirbeau, « Sur la statue de Zola », in Combats esthétiques, vol. 2, Paris, Séguier, 19931, pp. 357–366. 7 Mirbeau, 19931, pp. 357/358. 2 « – Mais si j’ai bien compris, M. Aristide Maillol n’est pas un moderne. C’est un Éégyptien… un Ggrec […]. M. Maillol saura-t-il faire une redingote ? 8 ? » C’est là la question qui semble cruciale, et sur laquelle Mirbeau revient à plusieurs reprises. Les membres de la commission ne semblent pas tous connaître Maillol, certains le connaissent seulement par ouï-dire. L’un d’entre eux demande : « Qu’est-ce qu’il fait, ce Maillol ? … On me dit qu’il fait des petites bonnes femmes nues… Des petites bonnes femmes gréco-latines… Mais quel rapport ces petites bonnes femmes nues ont-elles avec Zola ? ». Mirbeau réplique que ces détails caractéristiques ne doivent pas être surestimés : « Je pense d’ailleurs que nous devons laisser à l’artiste le libre choix des ses arrangements… ». Quelqu’un lui rétorque : « Il ne s’agit pas de l’art de Maillol […]. Votre Maillol nous fera du Maillol, n’est-ce pas ? … Il ne nous fera pas du Zola. Eh bien, ce que nous voulons c’est que l’artiste que nous allons nommer nous fasse du Zola, s’engage, solennellement, à nous faire du Zola »9 ». Enfin, quelqu’un souligne : « “Monsieur … Mailllol … n’a encore modelé que de toutes petites statues – bibelots charmants, soit, mais bibelots 10. ». AÀ ce reproche, Mirbeau répond en forçant certainement la vérité : « Maillol a modelé de grandes statues. Mais cela n’a aucune importance… Une statue, quand elle est belle, n’est ni petite, ni grande … Elle est, voilà tout ! » 11 ! ». Malgré le caractère frustrant de cette première réunion du comité, Mirbeau ne se résigne pas. Avec Rodin, il se lance dans une campagne acharnée en faveur de Maillol. C’est ce que noten en date du 4 janvier 1903 dans son journal intime12, le comte Harry Graf Kessler, futur grand mécène de Maillol. Claude Monet se rallie aussi à la cause de Maillol : dans une lettre13 du 15 janvier 1903, il note à dessein que, ’à l’exception de Rodin, « seul Maillol est évoqué dans les débats ». Pourtant, Kessler émet des doutes sur les chances de succès de la campagne : il craint la jalousie des autres artistes, surtout avec 50. 000 francs à gagner. Mirbeau ajoute d’ailleurs qu’il s’agit en fait de 90 .000 francs14. Après plusieurs réunions, à la fin février 1903, le comité décide de confier au sculpteur belge Constantin Meunier le monument à Zola15. Maillol n’obtient que quatre voix16, et relate les événements concernant cette commande dans des courriers. Il écrit à son ami le peintre hongrois Rippl-Rónai : « Cette année on parle beaucoup de moi à Paris. J’ai failli avoir à faire le monument à Émile Zola. J’ai été choisi dans les trois, et dans ces trois on a choisi Constantin Meunier. Ce serait trop long à vous raconter, mais Mirbeau a beaucoup discuté pour moi »17 ». Le 27 mars 1903, il raconte à un autre ami : « J’ai été à deux doigts de l’avoir. 8 Mirbeau, 1991, p. 358. 9 Mirbeau, 19931, pp. 362/363. 10 Mirbeau, 19931, pp. 357–366, v. p. 362. 11 Mirbeau, 19931, p. 364. 12 Harry Graf Kessler, Das Tagebuch 1880–1937, Stuttgart, Cotta, 2004, vol. 3, p. 530. 13 Lettre du 15 janvier 1903 à Théodore Duret, Musée du Louvre, département des arts graphiques, A 3237. 14 Mirbeau, 1921, p. 11. 15 Linda Konheim Kramer, Aristide Maillol. Pioneer of Modern Sculpture, Ann Arbor, UMI Dissertation Services, 2000, p. 93. 16 Mirbeau, 19931, p. 365. 17 Rippl-Rónai et Maillol, catalogue d’exposition, Budapest, Galerie Nationale Hongroise, 2015, p. 347. 3 […]. En ce moment il n’y a presque plus d’espoir, mais on ne sait jamais. Mirbeau bataille pour moi18 ». Dans ces deux lettres, tout comme dans sa réaction vis-à-vis de Mirbeau, Maillol ne paraît pas déçu19, il pense que cette « publicité » est bénéfique pour son art. Le troisième sculpteur présélectionné aux côtés de Meunier et Maillol uploads/s3/ ursel-berger-aristide-maillol-et-octave-mirbeau-quot-mirbeau-travaille-pour-moi-quot.pdf
Documents similaires






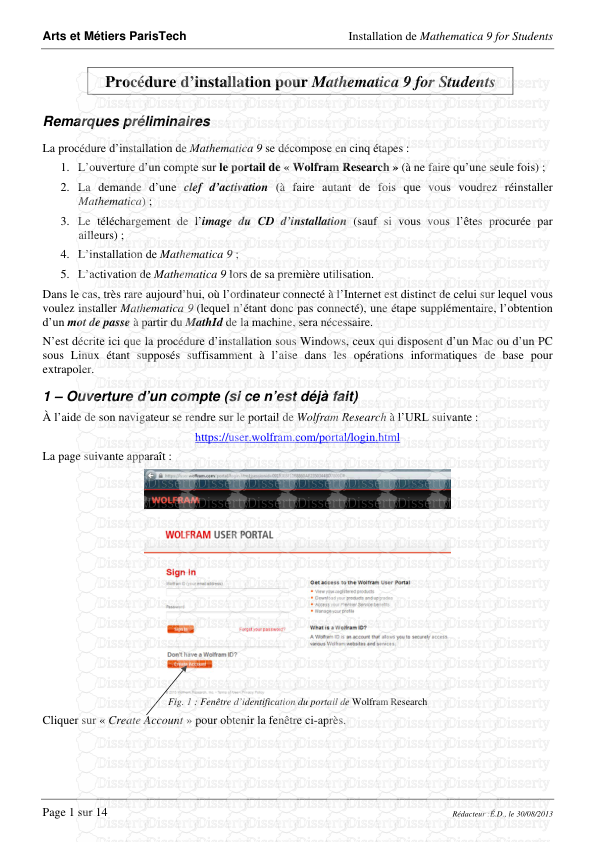



-
31
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 15, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3292MB


