SOCIOLOGIE DE L’ART Daniel Vander Gucht Faculté des sciences sociales, politiqu
SOCIOLOGIE DE L’ART Daniel Vander Gucht Faculté des sciences sociales, politiques et économiques Faculté de Philosophie et Lettres Université libre de Bruxelles Année académique - CHAPITRE L’AUTONOMISATION DE L’ART ET LA SOCIALISATION DE L’ARTISTE Libéralisation et professionnalisation de l’art Dès la chute de l’Empire romain, et jusqu’au XVe siècle, les artistes-peintres étaient caté- goriellement considérés comme des simples artisans, et à ce titre regroupés au sein de corporations ou guildes, encore appelées « Arti » en Italie (à Londres, par exemple, la guilde des peintres était une branche des selliers), créées au XIIe et XIIIe siècles, et où ils étaient rémunérés en fonction de la quantité de travail fournie et aussi de la valeur des matériaux utilisés (cf. V. W. Egbert, The Medieval Artist at Work, Princeton, ; A. Martindale, The Rise of the Artist in the Middle Ages and Early Renaissance, Londres, ; Michael Baxandall, L’Œil du quattrocento, trad. franç., Paris, Gallimard, ). Arti- sans pratiquant un « art mécanique », ils étaient relégués au rang d’exécutants manuels, par opposition à l’ensemble des connaissances théoriques réservées à l’homme libre dans la Rome antique, conservées dans l’éducation chrétienne où elles sont réunies sous le vocable d’« arts libéraux » : grammaire, logique, rhétorique, géométrie, arithmétique, astronomie et musique. Rudolf et Margot Wittkower précisent que « Seuls les maîtres qui étaient citoyens de leur ville par naissance ou par octroi spécial pouvaient être membres des guildes locales et avaient le droit d’ouvrir un atelier et d’y instruire des apprentis. Les guildes prenaient en charge l’homme tout entier : elles surveillaient les obligations reli- gieuses de leurs membres, contrôlaient l’éducation des apprentis, supervisaient les contrats, réglaient les relations avec les commanditaires et, parfois même, rendaient justice. » (Rudolf et Margot Wittkower, Les Enfants de Saturne. Psychologie et comportement des artistes de l’Antiquité à la Révolution française, trad. franç., Paris, Macula, , p. .) Toutefois, le climat moral des cités aux XIVe et XVe siècles exacerba dans l’esprit des arti- sans les plus distingués des velléités individualistes et l’on assista à des conflits de plus en plus nombreux entre les corporations et les artistes désireux de s’en émanciper. Quelques- uns bénéficiaient d’un statut particulier en qualité de protégés d’un prince-mécène qui leur accordait une relative liberté de création en échange de portraits de commande et d’agrément. Rembrandt se constitua quant à lui une clientèle à laquelle il parvint à imposer sa production, assurée du reste par un véritable atelier qu’il dirigeait comme un chef d’entreprise : son atelier faisait en effet autant office de boutique que d’école payante. L’individualité de l’artiste se conjugue alors chez cet « entrepreneur du moi », comme le désigne Svetlana Alpers, avec sa mercatique pour imposer un goût indépendant à ses clients, inversant ainsi la relation traditionnelle avec la clientèle dans le monde des arts patronnés (cf. Svetlana Alpers, « Rembrandt, un maître dans son atelier », Annales ESC, , p. -, et L’Atelier de Rembrandt. La liberté, la peinture et l’argent, trad. franç., Paris, Gallimard, ). Mais ces cas demeuraient exceptionnels et tenaient à la situation socio- économique particulière de la Hollande du XVIIe siècle qui préfigurait la société démocra- tique bourgeoise. « […] à partir du XVIe siècle, tous les grands artistes tenaient à faire une nette différence entre l’art et l’activité manuelle, mais de nombreux commanditaires, surtout dans le Nord, se montraient réticents à le reconnaître — moins en théorie peut- être qu’en pratique. Au Moyen Âge, les peintres avaient, à la cour de France, un rang à peine plus élevé que les serviteurs et les marmitons ; au XVIe siècle, ils n’avaient pas dépassé le titre de “valets de chambre”, titre qu’ils partageaient avec les poètes, les musiciens et les bouffons et qui les mettait en-dessous du personnel militaire, ecclésiastique et laïc de la maison royale. » (Rudolf et Margot Wittkower, op. cit., p. .) L’émancipation des règles et des astreintes corporatives, puis de la commande de la ville, passera par l’octroi de libéralités qui consacrent un art libéral non plus rétribué au prorata de la quantité de travail ni de la valeur des composants, et évaluent l’« œuvre » à l’aune du « génie » de son « créateur ». Cette émancipation de l’artiste de la Renaissance accédant au statut d’« intellectuel », dès lors que les arts visuels sont reconnus parmi les arts libé- raux, sera le fait de l’académisation du monde artistique, corrélatif à la promotion d’un idéal courtisan de l’artiste, homme de bonne composition, de bonnes manières, de grande culture et de goût supérieur, bref d’une grande civilité et pourvu d’une « noblesse d’es- prit » (idéal exemplifié par le De Pictura d’Alberti). Toutefois, cet avènement eut pour corollaire l’assujetissement de l’artiste au goût de la cour et à la politique du prince (ou du cardinal). L’enjeu politique de l’art remonte ainsi au moins à la Renaissance, lorsqu’une reconnaissance statutaire fut accordée à certains artistes très prisés et très sollicités, dans le jeu des rivalités entre Cités en Italie, entre villes et cours, puis plus tard entre mécènes. Le désir d’accroître son prestige par rapport aux villes rivales conduisit à l’établissement du poste de « Peintre de la Ville » (à Venise surtout) et à la nomination d’artistes renommés à une fonction de prestige, comme la nomination de Giotto, en , en qualité d’archi- tecte de la Ville de Florence : « Comme il n’est de par le vaste monde personne de mieux qualifié […] que maître Giotto de Bondone, le peintre de Florence, il sera dès lors nommé dans sa cité natale Magnus Magister et publiquement considéré comme tel, de sorte qu’il puisse, le cas échéant, y demeurer ; car par sa présence, nombreux sont ceux qui pourront bénéficier de sa sagesse et de son savoir, et la cité en retirera un grand prestige. » (cité par Francis Haskell, « L’art et la société », in D. Vander Gucht (s.l.d.), Art et Société, Bruxelles, Les Éperonniers, , p. .) Ces actions firent beaucoup pour installer un climat plus déférent à l’égard des artistes, même s’il ne s’agissait encore que de personnalités isolées. Même au XVIIIe siècle, il n’était pas rare qu’un commanditaire traitât encore un artiste en artisan, lui imposant tel sujet bien précis et exigeant tel emploi de couleurs. Au XVe siècle, parallèlement à leur politique de construction et de décoration d’édifices et de monu- ments publics, des souverains, tel Laurent de Médicis, prirent conscience du prestige qu’ils pouvaient escompter de leur rôle de protecteur des arts et s’adonnèrent au mécénat privé, anticipant, comme le note Francis Haskell, « sur cette pratique moderne qui consiste à faire valoir à l’étranger la suprématie des artistes de son pays afin d’accroître son prestige » (loc. cit., p. ). Remarquons au passage que la manie collectionneuse qui se répandit rapidement à travers toute l’Europe stimula la diffusion et la vente de l’art contemporain de l’époque, dont les œuvres ainsi acquises demeuraient accessibles aux autres artistes et aux amateurs — car le bénéfice de ces richesses en termes de prestige dépendait bien entendu de leur visibilité ostentatoire. Il n’est dès lors pas surprenant que, comme l’écrit Haskell, « Ces collections princières donnèrent naissance à la plupart des grands musées nationaux, à l’instar d’Anna Maria Ludovica, la dernière des Médicis, qui légua, en , à la ville de Florence, les trésors accumulés par sa famille. Ailleurs, la décollation ou l’exil se révélèrent des moyens autrement efficaces d’acquérir des trésors artistiques. » (loc. cit., p. .) Ainsi, la loi de l’offre et de la demande, mais plus encore celle de la concurrence économique et politique entre communautés, cités, cours, villes et Princes, auront joué un rôle déterminant pour l’élévation de la position sociale de l’artiste — comme on peut encore en juger de nos jours par la politique culturelle menée au plan des nations et des régions, comme du reste par l’attitude des grands collectionneurs privés (particuliers ou entreprises) soucieux de publicité, avides de notoriété ou de pouvoir. Ce phénomène a été relancé avec les grandes expositions internationales du XIXe siècle, incitant les gouvernements à encourager et à soutenir la production artistique nationale. Ce mouvement nullement désintéressé en faveur des arts exacerbera par ailleurs les mani- festations d’individualisme de la part des artistes qui souhaitaient s’émanciper du statut d’artisan pour accéder à celui de profession libérale, processus qui ira jusqu’à forger le type de l’artiste « névrosé », si répandu au XVIe siècle (cf. Rudolf et Margot Wittkower, op. cit.), version exaltée de la figure de l’artiste de génie — dont les attributs sont la virtuosité et la « fureur divine » de l’invention / imagination supplantant l’imitation comme doxa esthé- tique —, c’est-à-dire être d’exception aussi bien qu’« original », et annonciatrice de l’ar- tiste romantique tourmenté. L’artiste est devenu le « divino artista » dans la « légende des artistes » qui actualise sa mue héroïque à partir de motifs biographiques stéréotypés à caractère emblématique (cf. Ernst Kris et Otto Kurz, L’Image de l’artiste. Légende, mythe et magie, uploads/s3/cours-sociologie-de-l-x27-art.pdf
Documents similaires








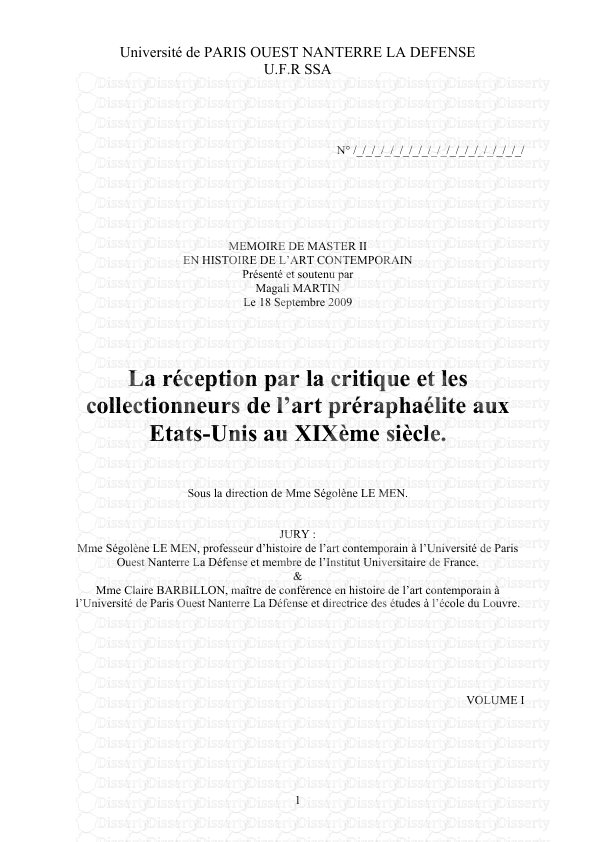

-
27
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 09, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.3320MB


