Département Philosophie Année Universitaire 2014 – 2015 Master : Religions et s
Département Philosophie Année Universitaire 2014 – 2015 Master : Religions et sociétés Année de master : 1ère année Semestre : 1er semestre Code de l’UE : M1ERU2 Imaginaire, mythe et représentations Cours assuré en présentiel par M Benoit Eric Auteur : Gérard PEYLET Année de création et de mise à jour : 2010 2011 Les cours sont strictement réservés à l’usage privé des étudiants inscrits à l’UFR Humanités de l’Université Michel de Montaigne de Bordeaux 3. Toute personne qui utiliserait ce document à d’autres usages ou qui en ferait une reproduction intégrale ou partielle sans le consentement de l’UFR Humanités de l’Université s’exposerait aux poursuites judiciaires et sanctions prévues par la loi. Gérard PEYLET 1 I / Imaginaire 1) Définition et histoire Dans l’usage courant du vocabulaire, le mot renvoie à un ensemble assez lâche : fantasme, souvenir, rêverie, croyance invérifiable, mythe, roman, fiction, etc.… Par certains aspects le mot imaginaire peu donner l’impression d’être une auberge espagnole. Pour certains même, le mot a une connotation négative, il s’oppose à la notion de réel et devient synonyme de chimérique. La définition que nous allons proposer est évidemment tout autre. Définition : l’imaginaire est un ensemble de productions mental ou matérialisé dans des œuvres, à base d’images visuelles (tableau, dessin, photographie) et langagières (métaphore, symbole, récit), formant des ensembles cohérents et dynamiques qui relèvent d’une fonction symbolique au sens d’un emboîtement de sens propres et de figures. Imaginaire suppose un dynamisme organisateur des images, il n’est donc pas une collection d’images additionnées, mais un réseau où le sens est dans la relation. Critères d’analyse : l’imaginaire comporte un versant représentatif et donc verbalisé et un versant émotionnel, affectif qui touche le sujet. L’étude de l’imaginaire comme mondes de l’imaginaire complexes doit donc porter sur le système des images-textes, sur la dynamique créatrice et leur prégnance sémantique, et enfin sur leur efficace pratique et leur participation à la vie individuelle et collective. Les deux conceptions : La définition de l’imaginaire prend une acception différente selon l’importance que l’on apporte à chaque type d’imagination qui le sous-tend. Imagination seulement reproductrice (mémoire qui donne lieu à de l’imagerie), imagination qui fomente des fantaisies et une activité vraiment symbolique. En fait l’imaginaire oscille entre deux conceptions principales : Master 1 Semestre 1 UE MRS02 M1ERU2 APPROCHES THÉORIQUES DES RELIGIONS IMAGINAIRE, MYTHE ET REPRESENTATIONS Cours de monsieur Peylet Gérard PEYLET 2 - L’une, restreinte, désigne l’ensemble statique des contenus produits par une imagination. L’imaginaire désigne ici le produit, il est compris comme un tissu d’images passives et neutres. - L’autre, élargie, intégrant en quelques sortes l’activité de l’imagination elle-même, désigne les groupements systémiques d’images en tant qu’ils comportent une sorte de principes d’auto-organisation, permettant s’ouvrir l’imaginaire sans cesse à de l’innovation, à des transformations, à des recréations. Dans cette conception, il s’agit d’un système dynamique ouvert. L’imaginaire est en effet dans le psychisme humain l’expérience même de l’ouverture. Histoire des théories contemporaines de l’imaginaire : On constate une avancée décisive de ces théories dans la seconde moitié du XXème. On peut citer l’école phénoménologique (M. Ponty) soucieuse de restaurer la primauté du sensible à travers la perception, la phénoménologie issue de Husserl qui consacre l’imagination comme intentionnalité, l’herméneutique qui attribue aux images une fonction expressive de sens (Ricoeur) et de nombreuses autres contributions philosophiques : Sartre, Levi-Strauss, Corbin, Deleuze, Serres, etc.… Nous nous arrêterons en particulier sur deux auteurs : a) Gaston Bachelard : pour Bachelard le psychisme humain se caractérise par la préexistence de représentations imagées, qui, fortement chargées d’affectivité, vont d’emblée organiser son rapport au monte extérieur. La puissance de l’imagination s’enracine dans le psychisme de l’être. Bachelard situe les matrices de l’imagination dans des matrices inconscientes, les archétypes. Loin d’être refoulées, ces images sont ensuite transformées par une conscience perceptive en images nouvelles au contact des éléments matériels du monde extérieur. Ensuite les images se chargent de significations nouvelles au contact des substances matérielles du cosmos qui leur servent de contenu. b) Gilbert Durand : en se situant au niveau d’une anthropologie générale, il va systématiser une véritable science de l’imaginaire. Il montre comment les images se greffent sur un trajet anthropologique qui commence au plan neuro-biologique pour s’étendre au plan culturel. Il impose aux images une logique, une structuration qui fait de l’imaginaire un « monde » de représentations. L’étude de l’imaginaire permet de dégager une logique dynamique de composition d’images selon deux régimes nocturne ou diurne qui donnent naissance à trois structures polarisantes : mystique, héroïque, cyclique. La « mythocritique » vise d’abord à dégager dans les oeuvres, les décors, les thèmes redondants, les mythèmes caractéristiques afin de cerner le mythe directeur sous-jacent. Gérard PEYLET 3 La « mythanalyse » élargit l’enquête à l’ensemble des productions culturelles pour en opérer une sorte de psychanalyse des images dominantes afin d’établir une topique spatio- temporelle de l’imaginaire. Selon la typologie durandienne, on parle e deux catégories d’herméneutiques : les herméneutiques instauratrices (Bachelard, Ricoeur) et les herméneutiques réductrices (Freud et la psychanalyse, G.Dumézil et le fonctionnalisme, C.L Strauss et le structuralisme). Résumons les grandes lignes de cette nouvelle théorie de l’imaginaire au XXème : - Les représentations imagées ne se ramènent pas toujours à des agrégations de représentations d’origine empirique. L’imaginaire obéit à une logique et s’organise en structures dont on peut formuler des lois. - L’imaginaire, tout en se greffant sur es infrastructures (le corps) et superstructures (les significations intellectuelles) est l’œuvre d’une imagination transcendantale qui est indépendante des contenus accidentels de la perception empirique. - Les œuvres de l’imagination produisent aussi des représentations symboliques. - L’imaginaire est inséparable d’œuvres qui servent à chaque conscience pour construire le sens de sa vie. L’imaginaire contribue à élaborer l’identité du moi. - L’imaginaire se présente comme une sphère de représentations et d’affects profondément ambivalente : il peut aussi bien être source d’erreurs et d’illusions que forme de révélation d’une vérité métaphysique. 2-Méthodes et structures L’imaginaire d’une œuvre, d’une création, d’un peuple, d’une époque, loin d’être un ensemble anarchique, obéit à des structures et connaît une histoire marquée par un jeu subtil de constantes et de variations dans le temps. C’est ce que démontrent les différentes méthodes d’étude de l’imaginaire mises au point dans diverses disciplines (critique littéraire, anthropologie, psychanalyse, philosophie, sciences religieuses, etc.). La plupart entremêlent plusieurs types d’approche qui oscillent entre deux pôles : a) la sémiotique structurale qui explique la mise en œuvre des images dan le roman, la poésie ou le théâtre avec deux options : - l’une –subjective- qui développe une esthétique de la réception accordant au lecteur une fonction décisive d’interprétation recréatrice des images. Gérard PEYLET 4 - La seconde a hérité des acquis de la linguistique et du structuralisme. Elle considère l’imaginaire littéraire comme déterminé par les signes linguistiques, par leurs propriétés combinatoires. Dans sa forme extrême, le structuralisme veut expliquer l’imaginaire à partir de jeux combinatoires plus ou moins formalisables et clos, intra ou intertextuels. C.Lévi Strauss a étendu cette méthode à l’étude des mythologies amérindiennes. L’approche formaliste, par ailleurs réductrice, a comme intérêt de produire des modèles positifs, voire scientistes de l’imaginaire mais inversement elle fait disparaître les contenus existentiels des référents des images et la part d’appropriation personnelle qui sont au cœur de l’approche herméneutique. b) l’herméneutique symbolique L’herméneutique a des affinités avec un esprit d’initiation qui conçoit l’accès à la vérité comme un cheminement progressif du plus exotérique au plus ésotérique. Cette herméneutique culmine dans l’interprétation des symboles. Elle fait du symbole, selon P. Ricoeur, une « structure de signification où un sens dérivé, primaire, littéral, désigne par surcroît un autre sens indirect, secondaire, figuré, qui ne peut être appréhendé que par le premier ». Le symbole recèle une dimension de révélation et de mystère et s’expose, du fait de sa plurivocité à une interprétation sans fin. Le symbole ouvre donc sur un plan métalinguistique du sens. Les noyaux de signification des symboles renvoient à une certaine universalité particulièrement attestée par les archétypes, sortes de matrices de sens à partir desquelles se forment les symboles. c) entre ces deux pôles méthodologiques, on peut détacher le courant inspiré de la psychanalyse qui s’intéresse aussi bien à la dimension singulière des images qu’à leur horizon d’universalité (Jung). La psychanalyse freudienne a opté pour un refoulement des déterminants de l’imaginaire, ce qui lui permet avant tout de décrire des procédures de transformations de l’imaginaire inconscient en imaginaire conscient (C.Mauron). Une logique spécifique Quelle que soit la méthode employée, l’imaginaire peut être appréhendé en tant que sphère organisée de représentations, où fond et forme, parties et tout s’entrelacent. (Idée d’une totalité ordonnée par un principe organisateur). Un imaginaire peut être comparé à une sorte d‘organisme Gérard PEYLET 5 doté d’un principe de croissance et d’organisation. Les théories les plus riches sont celles qui décèlent dans l’imaginaire une organisation. Les images obéissent à une logique ou plus exactement à une dialectique et une rythmique qui n’ont rien à envier à celles du concept. Bachelard le premier a dégagé des lois : -lois syntaxiques : - les images ne pouvant rester uploads/s3/m1eru2-peylet-g-imaginaire-mythe-et-representations.pdf
Documents similaires







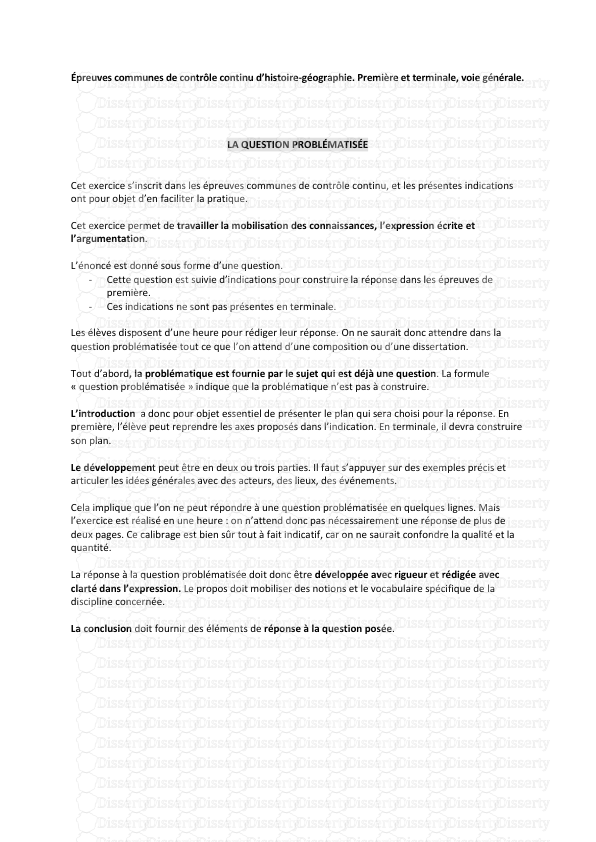


-
225
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 02, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2967MB


