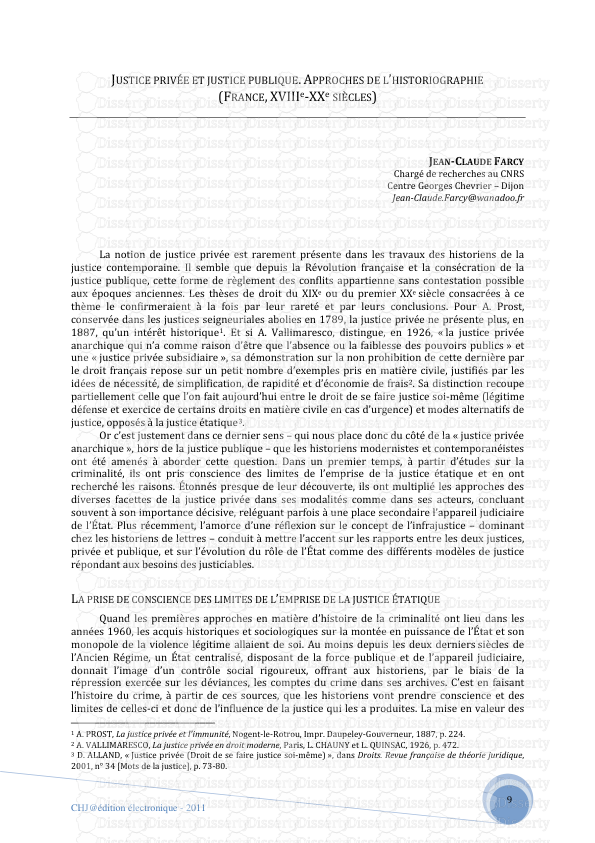CHJ@édition électronique - 2011 9 JUSTICE PRIVÉE ET JUSTICE PUBLIQUE. APPROCHES
CHJ@édition électronique - 2011 9 JUSTICE PRIVÉE ET JUSTICE PUBLIQUE. APPROCHES DE L’HISTORIOGRAPHIE (FRANCE, XVIIIe-XXe SIÈCLES) JEAN-CLAUDE FARCY Chargé de recherches au CNRS Centre Georges Chevrier – Dijon Jean-Claude.Farcy@wanadoo.fr La notion de justice privée est rarement présente dans les travaux des historiens de la justice contemporaine. Il semble que depuis la Révolution française et la consécration de la justice publique, cette forme de règlement des conflits appartienne sans contestation possible aux époques anciennes. Les thèses de droit du XIXe ou du premier XXe siècle consacrées à ce thème le confirmeraient à la fois par leur rareté et par leurs conclusions. Pour A. Prost, conservée dans les justices seigneuriales abolies en 1789, la justice privée ne présente plus, en 1887, qu’un intérêt historique1. Et si A. Vallimaresco, distingue, en 1926, « la justice privée anarchique qui n’a comme raison d’être que l’absence ou la faiblesse des pouvoirs publics » et une « justice privée subsidiaire », sa démonstration sur la non prohibition de cette dernière par le droit français repose sur un petit nombre d’exemples pris en matière civile, justifiés par les idées de nécessité, de simplification, de rapidité et d’économie de frais2. Sa distinction recoupe partiellement celle que l’on fait aujourd’hui entre le droit de se faire justice soi-même (légitime défense et exercice de certains droits en matière civile en cas d’urgence) et modes alternatifs de justice, opposés à la justice étatique3 Quand les premières approches en matière d’histoire de la criminalité ont lieu dans les années 1960, les acquis historiques et sociologiques sur la montée en puissance de l’État et son monopole de la violence légitime allaient de soi. Au moins depuis les deux derniers siècles de l’Ancien Régime, un État centralisé, disposant de la force publique et de l’appareil judiciaire, donnait l’image d’un contrôle social rigoureux, offrant aux historiens, par le biais de la répression exercée sur les déviances, les comptes du crime dans ses archives. C’est en faisant l’histoire du crime, à partir de ces sources, que les historiens vont prendre conscience et des limites de celles-ci et donc de l’influence de la justice qui les a produites. La mise en valeur des . Or c’est justement dans ce dernier sens – qui nous place donc du côté de la « justice privée anarchique », hors de la justice publique – que les historiens modernistes et contemporanéistes ont été amenés à aborder cette question. Dans un premier temps, à partir d’études sur la criminalité, ils ont pris conscience des limites de l’emprise de la justice étatique et en ont recherché les raisons. Étonnés presque de leur découverte, ils ont multiplié les approches des diverses facettes de la justice privée dans ses modalités comme dans ses acteurs, concluant souvent à son importance décisive, reléguant parfois à une place secondaire l’appareil judiciaire de l’État. Plus récemment, l’amorce d’une réflexion sur le concept de l’infrajustice – dominant chez les historiens de lettres – conduit à mettre l’accent sur les rapports entre les deux justices, privée et publique, et sur l’évolution du rôle de l’État comme des différents modèles de justice répondant aux besoins des justiciables. LA PRISE DE CONSCIENCE DES LIMITES DE L’EMPRISE DE LA JUSTICE ÉTATIQUE 1 A. PROST, La justice privée et l'immunité, Nogent-le-Rotrou, Impr. Daupeley-Gouverneur, 1887, p. 224. 2 A. VALLIMARESCO, La justice privée en droit moderne, Paris, L. CHAUNY et L. QUINSAC, 1926, p. 472. 3 D. ALLAND, « Justice privée (Droit de se faire justice soi-même) », dans Droits. Revue française de théorie juridique, 2001, n° 34 [Mots de la justice], p. 73-80. J.-CL. FARCY CHJ@édition électronique - 2011 10 biais d’une lecture positiviste des chiffres du crime fait s’interroger sur les raisons du refus de la justice et conduit à nuancer dans sa chronologie le processus d’acculturation judiciaire des populations. Les mécomptes d’une lecture positiviste du crime et la découverte de l’infrajudiciaire Les premières études sur l’histoire de la criminalité s’inscrivent dans le courant de l’histoire sérielle en vogue dans les années 1960. À l’encontre d’une histoire portant intérêt aux événements et aux personnalités ayant laissé une trace dans les chroniques officielles, on est persuadé que la recherche historique doit s’intéresser à tous les hommes et prendre en compte tous les aspects de leur vie. De plus, en mesurant les phénomènes étudiés – économiques, démographiques, sociaux ou les mentalités – on garantit la représentativité des corpus analysés tout en donnant une caution scientifique à la discipline. Dans ce contexte, le regard s’est rapidement porté sur la criminalité, avec le dépouillement des jugements des tribunaux des bailliages4. L’exercice a été prolongé pour l’époque contemporaine avec l’exploitation des statistiques criminelles du Compte général de l’administration de la justice criminelle5 Pourtant, les travaux publiés ont été relativement peu nombreux – du moins pour l’époque contemporaine – car très tôt, les sociologues . Les grilles d’analyse reprenaient celle de la criminologie de la fin du XIXe siècle, avec, par exemple, la conclusion d’une évolution vers une société moins violente, le vol devenant le délit majeur. 6 et quelques historiens7 ont mis en garde contre une lecture très positiviste des archives criminelles en soulignant que celles-ci portaient témoignage de l’activité des tribunaux et non de la réalité du crime, notamment parce que toute une partie du contentieux pénal s’évapore au fil des différentes étapes du processus pénal, du constat de l’infraction au jugement. Le premier colloque organisé à Dijon, en 1991, par le Centre d’Études historiques sur la Criminalité et les Déviances, animé par Benoît Garnot, sur « Histoire et criminalité de l’Antiquité au XXe siècle. Nouvelles approches »8, même s’il s’inscrit dans les schémas classiques de l’étude de la criminalité (typologie des crimes et des peines) se fait l’écho de ces critiques des sources utilisées et de la conscience de ne pouvoir appréhender la criminalité réelle à travers l’activité des juridictions. Le bilan historiographique pour l’époque moderne se demande s’il faut « renoncer à faire l’histoire de la criminalité »9 et celui de l’époque contemporaine conclut sur la même question « convient-il d’abandonner complètement les études sérielles de la criminalité… »10 Quelques années plus tard, en 1995, le 3e colloque de Dijon allait justement placer au cœur de sa réflexion ce qui échappe à la justice, en le nommant « infrajudiciaire » . 11 4 B. BOUTELET, « Études par sondages de la criminalité du bailliage de Pont de l'Arche (XVIIe-XVIIIe siècles) », dans Annales de Normandie, n° 4, 1962, p. 235-262. 5 G. DESERT, « Aspects de la criminalité en France et en Normandie, Marginalité, Déviance, Pauvreté en France, XIVe- XIXe siècles », dans Cahier des Annales de Normandie, n° 13, 1981, p. 221-316. 6 R. LEVY, Ph. ROBERT, « Le sociologue et l'histoire pénale », dans Annales E. S. C., mars-avril 1984, n° 2, p. 400-422. 7 M. PERROT, « Criminalité et système pénitentiaire au XIXe siècle : une histoire en développement », dans Cahiers du Centre de recherches historiques, Paris, 1988, n° 1, p. 3-20. 8 Histoire et criminalité de l'Antiquité au XXe siècle. Nouvelles approches. Actes du Colloque de Dijon-Chenove 3-4-5 octobre 1991, sous la direction de B. GARNOT, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1992, p. 542. 9 « L’historiographie de la criminalité pour la période moderne », dans Histoire et criminalité de l'Antiquité au XXe siècle, sous la direction de B. GARNOT, op. cit., p. 29. 10 J.-Cl. FARCY, « L'historiographie de la criminalité en histoire contemporaine », dans Histoire et criminalité de l'Antiquité au XXe siècle, sous la direction de B. GARNOT, op. cit., p. 44. 11 L'infrajudiciaire du Moyen Âge à l'époque contemporaine. Actes du Colloque de Dijon 5-6 octobre 1995, sous la direction de B. GARNOT, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1996, p. 477. . Au-delà même des critiques sur les biais introduits par le processus pénal dans les statistiques criminelles, on s’attaquait directement au « chiffre noir » du crime en déplaçant le regard vers les populations et leur manière de résoudre leurs conflits. Du crime défini par l’instance étatique, et dont l’étude laissait insatisfait, on partait à la découverte du « contentieux » traité en dehors de la justice. Telle est la première approche de la justice privée par les historiens. Elle allait à la fois APPROCHES DE L’HISTORIOGRAPHIE… CHJ@édition électronique - 2011 11 s’interroger sur les raisons du refus de la justice officielle et sur l’ampleur de ce mode privé de résolution des conflits. Le refus de la justice et ses raisons Sur les facteurs de cette réticence à l’égard de la justice de l’État, on remarquait d’abord les insuffisances de l’appareil judiciaire et des agents chargés du constat des infractions au droit pénal. Pour l’époque moderne et jusqu’à l’amélioration du réseau routier et au développement des chemins de fer, les difficultés de transport rendent sensible l’éloignement des tribunaux par rapport au domicile des justiciables. De même, les faibles effectifs de la maréchaussée, des polices municipales rendent très aléatoire le constat des délits d’autant plus que les poursuites privilégient ce qui porte atteinte à l’ordre public et marquent une grande réticence à traiter les affaires internes aux uploads/S4/ 2-jc-farcy.pdf
Documents similaires








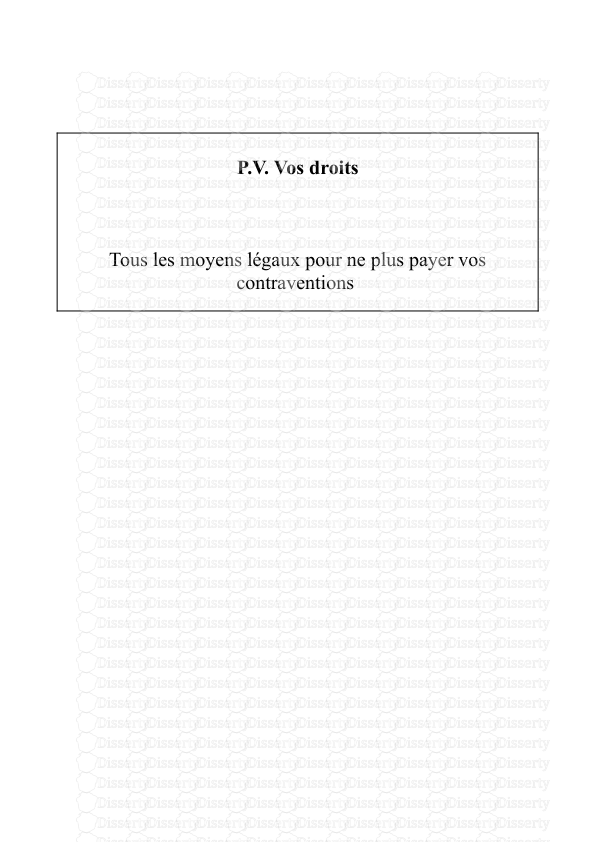

-
35
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 14, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1734MB