1 UNJF - Tous droits réservés Droit constitutionnel 1 : Théorie générale de l’E
1 UNJF - Tous droits réservés Droit constitutionnel 1 : Théorie générale de l’Etat - Histoire constitutionnelle de la France Leçon 6 : Histoire constitutionnelle française : Révolution et régime napoléonien. Michel Verpeaux Table des matières Section 1. Les révolutions constitutionnelles : 1789-1799..................................................................................... p. 2 §1. La révolution juridique de l'été 1789 ............................................................................................................................................ p. 4 A. L'Assemblée nationale constituante.............................................................................................................................................................................p. 4 B. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen................................................................................................................................................... p. 4 1. La conception de la Déclaration des droits........................................................................................................................................................................................................ p. 5 2. Le contenu de la déclaration de 1789................................................................................................................................................................................................................p. 6 §2. Le premier texte constitutionnel : la constitution du 3 septembre 1791........................................................................................p. 8 A. La consécration de la souveraineté.............................................................................................................................................................................p. 8 B. La séparation des pouvoirs..........................................................................................................................................................................................p. 9 §3. L'opposition entre le gouvernement constitutionnel et le gouvernement révolutionnaire (Septembre 1792- Août 1795)............. p. 10 A. La Constitution du 24 juin 1793 ou Constitution de l'an I......................................................................................................................................... p. 11 B. Le gouvernement révolutionnaire...............................................................................................................................................................................p. 12 §4. L'ordre républicain : la constitution de l'an III ou Directoire........................................................................................................ p. 13 A. La définition des pouvoirs.......................................................................................................................................................................................... p. 14 B. La séparation des pouvoirs........................................................................................................................................................................................p. 15 Section 2. L'ordre napoléonien (1799-1815) ..........................................................................................................p. 16 §1. L'organisation des pouvoirs dans la constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799)..................................................... p. 16 A. Le pouvoir exécutif..................................................................................................................................................................................................... p. 16 B. Un pouvoir législatif divisé......................................................................................................................................................................................... p. 16 §2. La marche vers l'empire (1804-1815)..........................................................................................................................................p. 16 2 UNJF - Tous droits réservés Ces développements visent à retracer les grandes lignes d'une évolution et les lignes de force, de montrer les constantes et les ruptures. Chaque régime politique réagit par rapport à son ou ses prédécesseurs et le système constitutionnel actuel est le résultat de cette évolution et de cette somme de « réactions », à la fois positives par l'acceptation du passé, ou l'héritage, et négatives par le rejet, la modification ou l'amélioration de ce qui précède. S'il faut montrer les évolutions, il est nécessaire aussi de respecter la chronologie depuis la fin de l'Ancien régime jusqu'au 4 octobre 1958. S'il y avait bien, en effet, une société politique sous l'Ancien Régime, et s'il existait peut-être une Constitution coutumière, avec les lois fondamentales du royaume, il n'y avait pas de droit constitutionnel conçu comme l'ensemble des règles de droit régissant les rapports entre les gouvernés et le pouvoir. Les règles coutumières concernaient l'Etat et les titulaires du pouvoir, mais en rien les sujets. Le pouvoir est limité par le droit mais cette limitation ne concerne que les règles relatives à l'exercice à la transmission du pouvoir. En outre, c'est sous la Révolution que sont nés les principes constitutionnels actuellement applicables, telles que la séparation des pouvoirs, une déclaration des droits, la primauté de la Constitution. De cette époque, datent aussi les réflexions sur la souveraineté et le suffrage et beaucoup de règles techniques, notamment celles intéressant le droit parlementaire. L'instabilité constitutionnelle française peut apparaître surprenante, notamment par rapport aux Etats-Unis, d'autant que presque tous les changements de texte constitutionnel se sont faits de manière non pacifique et sans respecter les formes prévues par les textes antérieurs ou en modifiant pour la circonstance le procédé de révision pour permettre une modification totale, comme en 1958, par exemple. Mais cette instabilité est peut- être plus apparente que réelle : d'abord les hommes ont pu rester en place si les institutions ont changé. Des personnages, comme Sieyès, ou Thiers, ont pu ainsi marquer de longues périodes. En outre, des institutions politiques ou administratives ont pu survivre aux tempêtes, comme le Conseil d'Etat, les grandes administrations et les administrations locales, à l'image des préfets. Il est fréquent de souligner la grande continuité administrative derrière l'apparente discontinuité constitutionnelle. La France a cherché à instaurer un régime de séparation des pouvoirs quia connu toutes les formes, depuis le régime d'assemblée jusqu'au présidentialisme le plus dictatorial. On constate aussi un mouvement vers la démocratie et le suffrage universel, comme dans d'autres pays et parce qu'il correspond à l'évolution des sociétés. Il y a aussi l'enracinement - fragile - de l'Etat de droit et la constitution d'une hiérarchie des normes qui connaît aussi des bouleversements, sous l'influence du droit comparé et de la construction européenne. Section 1. Les révolutions constitutionnelles : 1789-1799 Le régime politique de l'Ancien Régime est organisé autour du pouvoir royal qui a connu une stabilité de dix siècles. Le roi est héréditaire et absolu, mais ces caractères sont en réalité apparus bien tard : • L'hérédité est acquise au début du XIIIème siècle, après l'élection. • La féodalité a retardé l'évolution vers l'absolutisme : tout le mérite de la monarchie capétienne sera de se servir des institutions féodales pour asseoir l'autorité royale, en se comportant comme le suzerain des suzerains. • C'est au XIVème siècle que les légistes du roi ont développé l'idée de souveraineté, pouvoir inconditionnel et absolu. Le peuple va se rapprocher du roi pour échapper à l'emprise des seigneurs plus proches et donc plus craints. En cela, la monarchie anglaise se distingue de la monarchie française. 3 UNJF - Tous droits réservés Le pouvoir absolu est aussi caractérisé par la confusion des pouvoirs qui veut que le roi dispose de tous les pouvoirs et dans l'exercice de chaque pouvoir, le roi ne connaît pas de limites et il exerce le pouvoir législatif par voie d'ordonnances et d'édits. Le pouvoir exécutif et administratif est en grande partie concentré entre ses mains et celles de ses représentants, les intendants, même si quelques provinces conservent des libertés locales, surtout dans les pays d'Etats. La justice est rendue au nom du roi, notamment au sein des Parlements, qui sont des juridictions supérieures, mais qui cherchent à acquérir une indépendance à l'égard du roi et à jouer un rôle politique en tentant de contrôler l'enregistrement des édits et des ordonnances du roi. Mais le roi pouvait évoquer à tout moment un procès et faire appeler toute cause devant son conseil. C'est ce qu'exprime Louis XV lors de la « séance de la flagellation » en 1766 devant le Parlement de Paris, à l'occasion d'un lit de justice, en réponse aux remontrances faites par le Parlement, c'est-à-dire des observations sur les ordonnances et édits royaux : « c'est en ma personne que réside l'autorité souveraine, dont le caractère propre est l'esprit de conseil, de justice et de raison. C'est à moi seul qu'appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage. L'ordre public tout entier émane de moi ». A l'absolutisme s'ajoute le caractère divin de la monarchie française qui fait du roi le représentant de Dieu sur terre et à qui les sujets doivent la même obéissance qu'à Dieu. Le roi ne doit des comptes qu'à Dieu, comme le montre le sacre de Reims qui symbolise le caractère divin du pouvoir royal. Il n'existe pas de Constitution écrite. Il y a des lois fondamentales du royaume, surtout relatives à la dévolution du pouvoir, à l'inaliénabilité du domaine de la couronne consacrée par l'édit de Moulins de 1566, et à la nécessité pour le roi d'être de religion catholique. La loi salique, venue des Francs saliens, prévoit également que la couronne de France se transmet de mâle en mâle par ordre de primogéniture. D'une certaine façon, ces lois s'imposaient au roi : Henri IV dut abjurer la religion protestante (selon une formule restée célèbre, selon laquelle « Paris vaut bien une messe ») et le testament de Louis XIV, qui modifiait l'ordre de succession au profit de ses enfants adultérins, fut cassé par le Parlement de Paris en 1715. Mais ces lois n'étaient pas l'équivalent d'une Constitution de la nation, tout au plus une Constitution de la couronne de France. L'existence de deux ordres privilégiés, la noblesse et le clergé, domestiqués mais puissants, ne serait-ce que financièrement, et illustrée par la réaction nobiliaire à la fin de l'Ancien Régime, est un contrepoids à l'absolutisme royal. Le pouvoir judiciaire est en fait relativement indépendant du roi, comme en témoignent les révoltes des Parlements au XVIIème (La Fronde) et au XVIIIème siècles. Supprimés par le chancelier Maupeou, ils ont été rétablis par Louis XVI en 1774. Les franchises de nombreuses provinces et villes empêchent toute centralisation absolue du pouvoir administratif et interdisent toute réforme visant à introduire une rationalité dans l'organisation administrative. Elles constituent des freins à cette évolution à la fin de l'Ancien Régime. Le Tiers-Etat lui-même n'était pas homogène et ne formait pas une classe sociale. Il y avait, au sein du Tiers, des riches et des pauvres, des privilégiés fortunés et une multitude qui ne possédait rien. Le roi devait s'entourer de conseils : les plus solennels sont les Etats généraux, dont la première réunion remonte à 1302 sous Philippe Le Bel, pour lesquels les députés reçoivent un mandat impératif sous forme de cahiers de doléances. Les Etats généraux réunissent les trois ordres de la société mais ils siègent séparément. Ils n'ont que des pouvoirs consultatifs, donnant des avis au roi, que celui-ci est libre ou non de suivre. Théoriquement, les impôts nouveaux ne pouvaient être établis qu'avec le consentement des Etats généraux mais les rois sont arrivés à s'affranchir uploads/S4/ 4-republique.pdf
Documents similaires





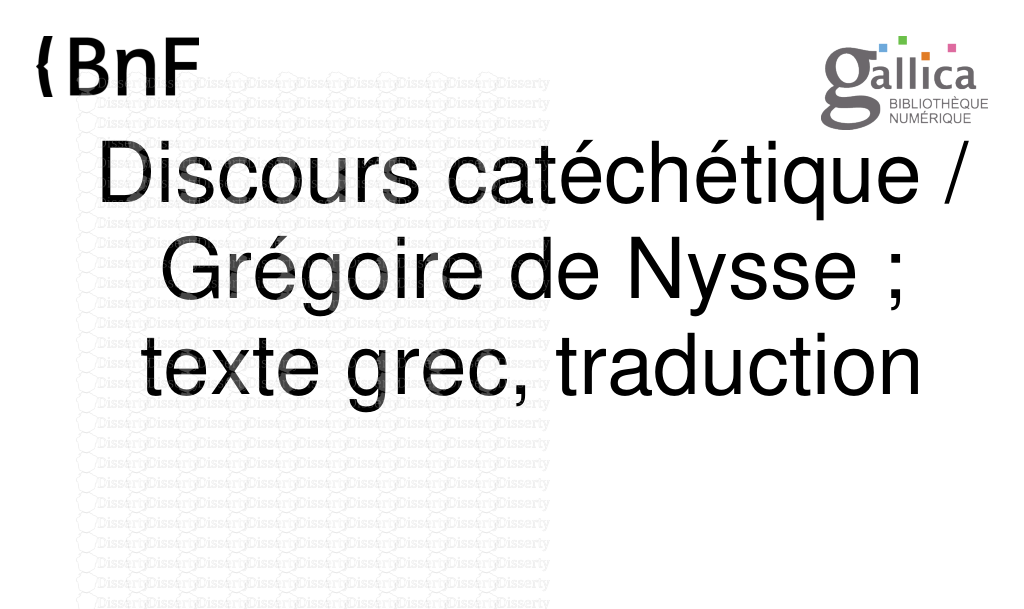




-
59
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 22, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1083MB


